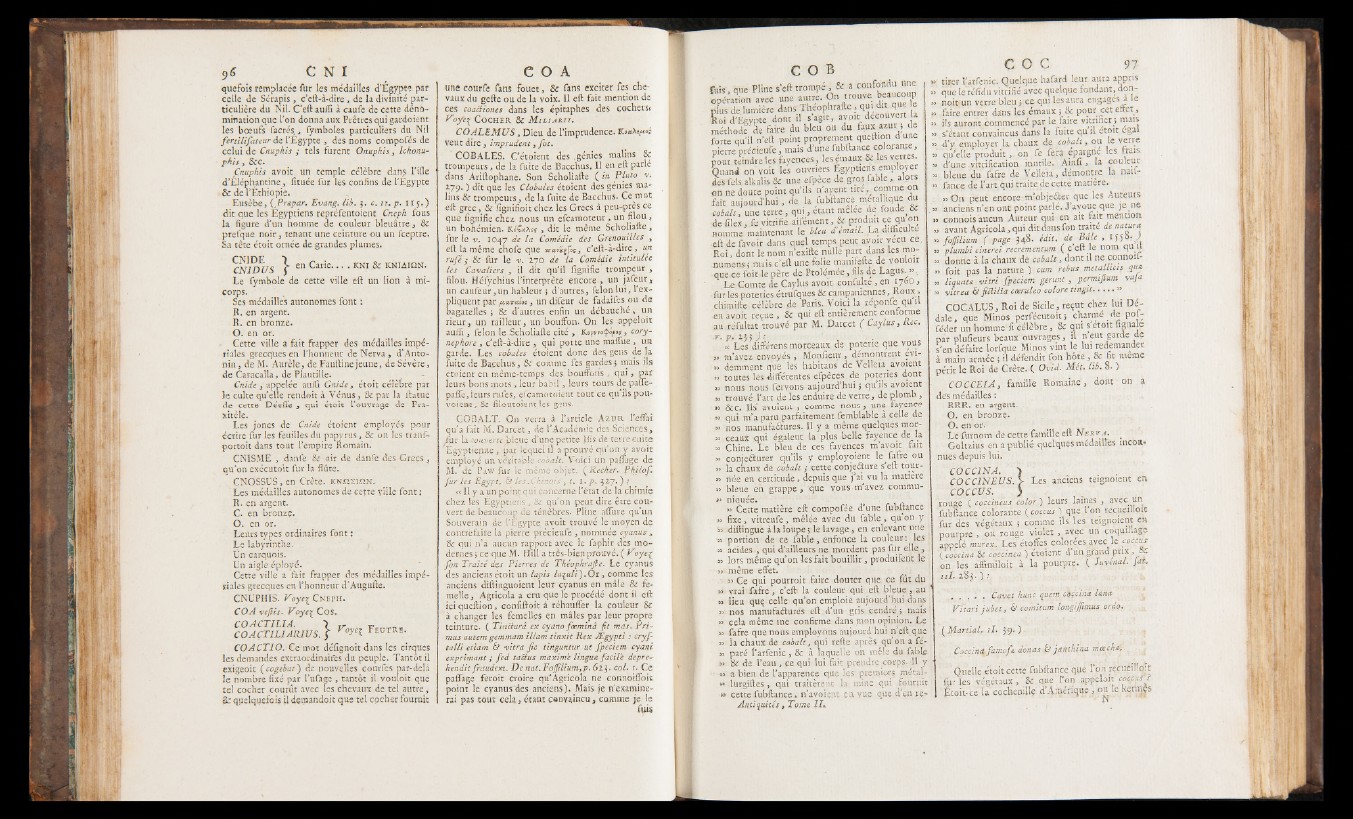
0,6 C N I
quefois remplacée fur les médailles d’Egypte par
celle de Sérapis , c’eft-à-dire, de la divinité particulière
du Nil. C’eft auffi à caufe de cette dénô-
mination que l’on donna aux Prêtres qui gardoient
les boeufs facrés,, fymboles particuliers du Nil
fertilifateur de l’Egypte, des noms compofés de
celui de Cnuphis y tels furent Onuphis, Ichonu-
pkis , 8cc.
Cnuphis avoit un temple célèbre dans Tille
d’Eléphantine , fituée fur les confins de l’Egypte
& de l’Ethiopie.
Eusèbe, ( Pr&par. Evang. lib. 3. c. 11. p. I l y .)
dit que les Egyptiens repréfentoient Cneph fous
la figure d’un homme de couleur bleuâtrè , &
prefque noir, tenant une ceinture ou un fceptre.
Sa tête étoit ornée de grandes plumes»
^ N U T U S ^ 611 ' * * KNI & KNIAIQN.
Le fymbole de cette ville eft un lion à mi-
corps.
Ses médailles autonomes font :
R. en argent.
R. en bronze.
O. en or.
Cette ville a fait frapper des médailles impériales
grecques en Thonneur de Nerva 3 d’Anto-
nin, de M. Aurèle, de Fauftinejeune, de Sévère,
de Caracalla, de Plautillé. __ _ -
Cnide 3 appelée auffi Guide, étoit célèbre par
Je culte quelle rendoit à Vénus, & par la ftatue
de cette Déelfe , qui étoit l’ouvrage de Praxitèle.
Les joncs de Cnide étoient employés pour
écrire fur les feuilles du papyrus, & on les tranf-
portoit dans tout l’empire Romain.
CNISME , danfe air de danfe des Grecs ,
qu’on exécutolt fur la flûte.
CNOSSUS, en Crète, icshzsion.
Les médailles autonomes de cette ville font :
R. en argent.
C. en bronzç.
O. en or.
Leurs types ordinaires, font :
Le labyrinthe.
Ün carquois.
Un aigle éployé.
Cette ville a fait frapper des médailles impériales
grecques en Thonneur d’Atigufte.
CNUPHIS. Voyei C n e p h .
CO A vefiis. Voye^ Cos.
COA CTIL IA .
COAÇTILIARIUS. j- Voyii F eu tr e .
COACTIO. Ce mot défignoit dans les cirques
les demandes extraordinaires du peuple. Tantôt il
exigeoit ( cogebat ) de nouvelles courfes par-delà
le nombre fixé par l’ufage, tantôt il vouîoit que
tel cocher courût avec les chevaux de tel autre,
& quelquefois il dtraandoit que tel cpcher fournît
e o a
une courfe fans fouet, & fans exciter fes chevaux
du gefte ou de la voix. Il eft fait mention de
ces coaftiones dans les épitaphes des cochers«
V | p | Cocher & M i h a r i i .
COA LEM US , Dieu de l’imprudence. Ko*xtftoè
veut dire , imprudent 3 fot.
COBALES. C’étoient des .génies malins &
trompeurs, de la fuite de Bacchus. Il en eft parle
dans Ariftophane. Son Scholiafte ( in Pluto 'v-
279. ) dit que les Clobales étoient des génies malins
&r trompeurs, de la fuite de Bacchus. Ce mot
eft grec, & fignifioit chez les Grecs à peu-pres ce
que fignifie chez nous un efcamoteur, un filou,
un bohémien. Ka&eAoj, dit le même Scholiafte,
fur le v. IO47 de la Comédie des Grenouilles ,
eft la même chofe que ■ zretvxç[oç3 c’eft-à-dire , un
rufé j & fur le v. 270 de la Comédie intitulée
les Cavaliers , il dit qu’il fignifie trompeur ,
filou. Héfychius l’interprète encore, un jafèur,
un caufeur,ün hâbleur ; d’autres, félon lui, l’expliquent
par fturctlos, un difeur de fadaifes ou de
bagatelles ; & d’autres enfin un débauché, un
rieur, un railleur, un bouffon. On les appeloit
auffi, félon le Scholiafte cité , KopwoQôpos, cory-
nephore, c’eft-à-dire , qui porte une maffue, un
garde. Les cobales étoient donc des gens de là
fuite de Bacchus, 8c comme fes gardes5 mais ils
etoient en même-temps des bouffons , q u i, par
leurs bons mots, leur babil, leurs tours de paffe-
paffe, ieurs rufes, efcamotoient tout ce qu’ils pou-
voièrn, & filoutoient les gens..
COBALT. On verra à l’article A z u r Téffai
qu’a fait M. Darcet, de l’Académie des Sciences,
fur la c o u v e r te jffeue d’une petite Ifîs de terrecuite
Égyptienne, par lequel il a prouvé qu’on y avoit
employé un véritable cobalt. Voici un paffage de
M. de Pa;w fur le même objet. ( Recher. Phi lof.
fur les Egÿpt. & l e s . C h in o is 3 t. 1. p. 327.) f .
« Il y a un point qui concerne Tétât de la chimie
chez les Égyptiens , & qu’on peut dire être couvert
de beaucoup de ténèbres. Pline affure qu’ un
Souverain de l’Ègyptq avoit trouvé le moyen de
contrefaire la pierre précieufe, nommée cyanus ,
& qui n’a aucun rapport avec le faphir dejs modernes
; ce que M. Hill a très-bien prouvé. ( Voye£
fon Traité des Pierres de Théophrafte. Le cyanus
des anciens étoit un lapis la çuli).Ox, comme les:
anciens diftinguoient leur cyanus en mâle & femelle,
Agricola a cru que le procédé dont il eft
ici queftion, confiftoit à réhauffer la couleur 8c
à changer les femelle:? çn mâles par leur propre
teinture. ( TinBurâ ex cyano foeminâ fit mas. Pri-
mus autem gemmam illam tinxit Rex Ægypti :■ cryf-
talli etiatn & vitra fie tinguntur ut fpeciem cyani
exprimant y fed taôtus maxime lingutù facile deprer
hendit fraudem. De nat.Foffilium,p. 613. col. /. Ce
paffage feroit croire qu’Agricola ne connoiffoit
point le cyanus des anciens). Mais je n’examinerai
pas tout cela j étant cenyaincu* comme je le
C O B
fuis, que Pline s’eft trompé , & a confondu «ne
opération avec une autre. On trouve beaucoup
plus de lumière dans Théophrafte ; qut d« que le
Roi d'Egypte doht il s agit, avoir découvert la
méthode de faire du bleu ou du faux azur, de
forte qu'il n'eft point proprement queftion d une
pierre précieufe, mais d'une fubftance colorante, .
pour teindre les fayences, les émaux St les verres, j
Quand on voit les ouvriers Egyptiens employer j
des fels alkalis & une efpèce de gros fable, alors j
on ne doute point qu'ils n'ayent tire.,.comme on
fait aujourd'hui, de la fubftance métallique du
■ cobalt, une terre, qui, étant melee de foude_&
•de filex, fe vitrifie aifément, & produit ce qu on
nomme maintenant le bleu d!émail. La difnçulte
eft de favoir dans quel temps peut avoir vécu ce,:
Roi, dont le nom n'exifte nulle part dans Les mo-
numens; mais c’eft une- folie mamfefte de vouloir ;
que ce «bitle père de Ptolémée, fils de L a g u s .^ j
Le Comte de Caylus avoit confulté., en 17(19, <
fur les poteries étrufques & campamennes, Roux ,
chimifte célèbre de Paris. Voici la réponfe qu 1
en avoit reçue , & qui eft entièrement conforme
au réfultat trouvé' par M. Darcet ( Çaylus, Reç.
-r. p. I3ÿli}i5;v:u-M9 « ;nds-ifféis:• -
« Les différens morceaux de poterie que vous
» m’avez envoyés , Moniîeur, démontrent evï-
» demment que les habitans de Velleïa avoient
» toutes les différentes efpèces .de poteries dont
>, nous nous fervons aujourd’hui; qu’ils avoient
» trouvé l’art de les enduire de verre, de plomb,
., & c . Us* avoient , comme nous, une fayence
» qui m’ a paru parfaitement femblable à celle de
» nos manufaàures. Il y a même quelquës mot-
» ceaux -qui égalent la plus belle fayence de la
„ Chine. Le bleu de ces fayences m’avoit fait
» conjeéturer qu’ils y employoient le^fafre ou
»» la chaux dé cobalt y cette conjecture s eft to'ir-
» née en certitude, depuis que j’ ai vu la matière
»j bleue eh grappe, que vous m’avez commu-
w niquée. V f
5» Cette matiète eft compofée d’une. fubftance
»j fixe, vitreufe, mêlée avec du fable, qu’on y
s» diftingue à la loupe;, le lavage, en enlevant une
« portion de ce fable, enfonce la couleur : les
» acides , qui d’ailleurs ne mordent pas fur elle,,
» lors même qu’on les fait bouillir, produifent le
jj même effet. ’ : . _ • ^ î
• ^ Ce qui pourroit faire douter que ce fût du
» vrai la f r e , c’eftt la couleur qui eft bleue , au
as lieu que celle qu’on emploie aujourd’hui dans
»• nos manufacturés eft d’ un gris cendré ; mais
jj cela même me confirme dans mon opinion. Le
*> fafre que nous employons aujourd’hui n’eft que
33 la chaux de cobalt, qui refte après qu’on a fé-
33 paré f’arfenic, 8c à laquelle on mêle du'fable.
:?3 & de l’eau, ce qui lui fait prendre corps.-Il y
■ -m a bien de l’apparence que les premie-rs métal-
»» lurgiftes, qui traitèrent la mine qui fournit
sa cet-te fubftance| n’avoient en vue que d’en rêr
Antiquités 3 Tome 11%
C O C 97
« tirer l’arfenic. Quelque hafard leur, aura appris
jj que le réfidu vitrifié avec quelque fondant, don-
33 noit un verre bleu j ce qui les aura engages a le
» faire entrer dans les émaux ; & pour cet errer ,
jj. ils auront commencé par le faire vitrifier ; mais
jj s’étant convaincus dans la fuite qu il etoit égal
jj d’y employer la chaux de cobalt, ou le verre
jj qu’elle produit, on fe fera épargné les irais.
jj d’une .vitrification inutile. A in fi, la couleur
jj bleue du fafre de Velleia, démontré la nail-
jj Tance de Fart, qui traite de cette matière.
33 On peut encore m’ objeCber que les Auteurs
»3 anciens n’ en ont point parle. J’avoue que je ne
33 connois aucun Auteur qui en ait fait mention
« avant Agricola, qui dit dans fon traité de natura
»j fojjilium ( page 348. édit. de Bâle , I J )
os plumbi cinerei reçrementum ( c’eft le nom qu il
jj donne à la chaux de cobalt, dont il ne connoil-
03 foit pas la nature ) cùm rebus metallicis que,
os liquats. vitri fpeciem gerunt , permiftum vaja
‘ jj vitrea & ficîilia coeruleo colore tingit.........35
COCALUS, Roi de Sicile, reçut chez lui Dédale,
que Minos perfécutoit; charme de pof-
féder un homme fi célèbre, & qui s etoit hSnaj e
par plufieurs beaux ouvrages, il n eut garde de
s en défaire lorfque Minos vint le lui redemander
à main armée ; il défendit fon hôte, & fit meme
périr le Roi de Crète. ( Ovid. Met. lib. 8. )
CO C CE IA , famille Romaine, dont-on a
des médailles :
RRR. en argent.
O. en bronze. .
O. en or.
Le furnom de cette famille eft N b1 « _
Goltzius en a publié quelques médaillés inconnues
depuis lui.
COCC1N A . )
COCCÏNEUS. > Les anciens teignaient en
COCCUS. )
rouge ( cocçineus colot ) leurs laines , avec un
- fubftance colorante ( çoccus 1 que l on recueillait
, fur des végétaux ; comme ils les teignoient eu
: pourpre , o,u rouge v io le t, avec un coquillage
appelé murex. Les étoffes coloréesavec.le cocciu
( coccina Sr coccinea ) étoient d un grand prix, ce
on les aûimiloit à la pourpre. ( Juvenal. jat.
n i . 1 8 3 . ■
Cavet hune quem coçcin.b Uha
gitan jubet, & comitum longijjimus ordo.
[Martial, i l . 39. )
Coccitld famofe. douas & janthina ma ch*)..
Quelle étoit cette fubftance que l’on recuèilloit
fti. Jes végétaux, & que fon appelait: coccas?
Étoit-ce la cochenille d’Amérique , ou le kermçs
f ï