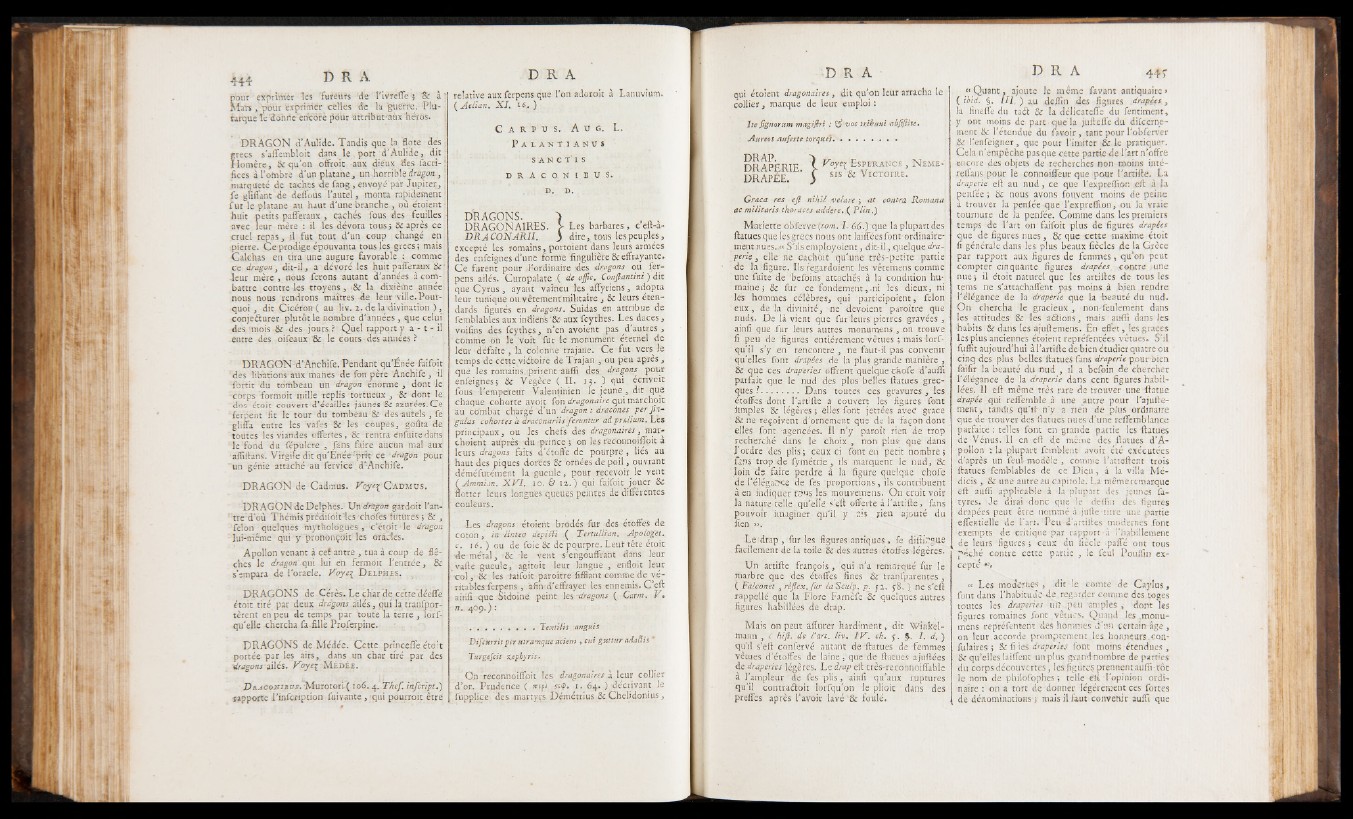
D R A.
Our exprimer les Turéufs'cîe Pivreffe^ 8c a '
fa r s , pour exprimer celles de lu giierre.'Plu-
rarque le 'dohrie'erfcorè pour artribut-aûx héros.
D R À G O N d’Aulide. Tandis que la flore des
grecs s'alTembloit dans le port d’Aulide, dit ;
Homère , 8c qu’on offroit aux dieux des iacri- :
fices à T ombre d'un platane , un horrible dragon, :
marqueté de taches de fang , envoyé par Jupiter,
fe gliffant de deffous l’autel, monta rapidement;
fu r le platane au haut d’une branche, où étoient ■
huit petits pafferaux, cachés fous des feuilles
-avec leur mère : il les dévora tous 5 & après ce
cruel repas, il fut tout d’un coup changé en
:pierre. C e prodige épouvanta tous les grecs ; mais
Calchas en tira une augure favorable : comme
ce dragon 3 dit-il , a dévoré les huit pafferaux 8c‘
-leur mère , nous ferons autant d’années à combattre
contre les troyens, •& la dixième année
nous nous rendrons maîtres de leur 'ville. Pourquoi
, dit Cicéron ( au liv. 2. de la'divination ) ,
conjecturer plutôt le nombre d’ années, que celui
des 'mois & des jours ? Quel rapport y a - 1 - il
entre dès oifeaux '& le cours des années ?
D R AG O N -d ’Anchife. Pendant qu’Énée fàifôit
des libations- aux manés de fon père Anchife, il
fortit du tombeau un dragon énorme , dont le
corps 'formoit mille replis tortueux , •& dont le.
dos étoit couvert d’écailles jaunes & azurées. Ce
ferpent fit le tour du tombeau & des autels , fe
gliffa entre les -vafes 8c les coupes, goûta de
toutes les viandes offertes, & rentra enfuitedans
le fond du fépulcre , fans faire aiicün mal aux
affiftans. Virgile dit qu’Enée'prir ce dragon pour
un génie attaché au fervicé d’Anchife.
D R A G O N de Cadmus. G;Adm ûs .
D R A G Ô N de Delphes. Un dragon gârdoit l’antre
d’où Thémis prédilôit'les chdfes fiitùrés ; 8c ,
félon quelques mythologues , c’etpit le dragon
lui-même qui y prononçait les ôrâdés.
Apollon venant à ce? antre , tua à coup de flèches
le dragon qui lui en fermoit l’entrée, &
s’empara de l’oracle. V 'o y e^ D elphes. .
D R A G O N S de Cérès. Le char de cettedéefle
étoit tiré par deux dragons ailés , qui la tranfpor-
tèrent en peu de temps par ‘toute la terre , lorf-
qu’ elle chercha fa.fille Proferpine.
DR AG O N S de Médée. Cette princeflfe étoit
portée par les airs, dans un char tiré par des
'dragons 'ailés. V°ye\ MÉDÉE.
D raôonib us. Murotori( 1 0 6 .4. Thef. infcript. )
rapporte l ’infcription fuiyante, ’qui pourroit être
D R A
relative aux ferpens que l’on a do r oit à Lanuvuim.
( Aelian. XI. 1 6,. ) .
C A R P u s. A U G. L.
P A L A N T .I A N U S
• ' S A N C t T S
D R A C O N £ B U S.
D. D.
D R A G O N S . ^
D R A G O N AIRES. > Les barbares, c'eft-a-
D R A CONARII.. ) dire tous les peuples,
excepté les romains, portoient dans leurs armees
des enfeignes d’unè forme fingulière 8ceffrayante.
C e furent pour .^ordinaire ides dragons ou ferpens
ailés. Curopalate ( de ojfic. Conftantini) dit
que C y ru s , ayant vaincu les affyriens, adopta
leur tunique ou. vêtement'militaire , 8c leurs étendards
figurés en dragons. Suidas en attribue de
femblables aux indiens '8c- aux fcythes. Les daces,
voifins des fcythes, n’en avoient pas d’autres ,
comme on le voit fur ie monument eterriel de
leur défaite , la colonne trajane. C e fut vers le
temps de cette vi&oire de Trajan , ou peu apres ,
que les romains.^prirent aufli des dragons^ pour
enfeignes5 8c Vegèce ( I I . 13. ) qui écrivcit
fous l'empereur Valentinien le jeune , dit que
chaque cohorte avoit fori dragonaire qui marchoit
au combat chargé d'un dragon : dracones per Jin-
gulas cohortes a dracûnariis feruntur ad pr&lium. Lès
principaux, ou les chefs des dragonaires, mat-
choient auprès du prince ; on les reconnoiffoit a
leurs dragons faits d’étoffe de pourpre , lies au
haut des piques dorées 8c ornées de poil, ouvrant
déméfurément la gueule, pour recevoir le vent
Ammi.in. X V I . 10. & I a. ) qui faifoit jouer 8c
otter leurs longues queues peintes de différentes
couleurs.
.Les dragons étoient brodés fur des étoffes de
coton j in linteo depicii ( . Tertullian. Apologet.
c. 16. ) ou de foie 8c de pourpre. Leur tête étoit
•de métal, 8c de vent sfengouffrant dans leur vafte gueule, agitoit leur langue , enfloit leur
•col, 8c les faifoit pa'roître fiffiant comme de vé- rita blés ferpens , afin-d’ effrayer les ennemis. C’eft
airifi que Sidoine peint les dragons ( Carm. V •
« ..•4 69 .):
........................ ... Textilis anguis
Difturrit per utrdmque acient, eut guttur adaÏÏis
Turgefcit x.ephyris.
On reconnoiffoit les dragonaires à leur collier
d’or. Prudence ( 1 • 64. ) décrivant le
fupplice des martyrs Démétrius 8c Chelidonius,
DR A
qui étoient dragonaires, dit qu’on leur arracha le
collier, marque de leur emploi :
Ite fignorum magiflri : tr.ihuni ctbßßite.
Aareos auferte torques. I l . . . . . . .
DRAPERIE. X P o y e f ‘E s p é r a n c e , N e m s -
DRAPÉE. ) sis & VlCTOnlEGr&
ca res efi nihil velare ; at contra Romana
ac militaris thoraces addere. ( P lin.)
Mariette obferve pom. L 66.) que la plupart des
ftatues que les grecs nous ont laifféesfont ordinaire-
ment nues..« S’ils employaient, dit-il, .quelque, draperie
, elle ne cachoit qu’une très-petite partie
de la -figure. Ils regardoient les vêcemens comme
une fuite de hefoins attachés à la condition humaine
3 8c fur ce fondement,.ni les dieux, ni
les hommes célèbres, qui participoient, félon
eux, de la divinité, ne dévoient paroître que
nuds. De là vient que fur leurs pierres gravées ,
ainfî que fur leurs autres monum^ens, on trouve
fi peu de figures entièrement vêtues ; mais lorf-
qu’ il s’y en rencontre , ne fa.ut-il pas convenir
qu’elles font drapées de la plus grande manière ,
8c que ces draperies offrent quelque chofe d’aufïi
parfait que le nud des plus belles fia tues grecques
?................Dans toutes ces gravures, les
étoffes dont l’artiffe a couvert les figures font
fimples 8c légères 5 elles font jettées avec grâce
8c ne reçoivent d'ornement que de la façon dont
elles font agencées. Il n'y paroît rien de trop
recherché dans le choix , non plus- que dans
l ’ordre des plis ; ceux ci font en petit nombre j
Ons trop de fymétrie, ils marquent le nud, 8c
loin ds faire perdre à la figure quelque chofe
de l’ elégaDCe de fes proportions, ils contribuent
à en indiquer tous les mouvemens. On croit voir
la nature telle qu’eîiè 5’elt offerte à l’artifte, fans
pouvoir imaginer qu’il y «iÇ fien ajouté du
fien m.
Le drap, fur les figures antiques , fe diitio^ue
facilement de la toile 8c des autres étoffes légères.
Un artifte françois, qui n’a remarqué fur le
marbre que des étoffes fines 8c tran{parentes,
( Falconet 3rèflex.fur laSculp. p1 f i . ) ne s’èft
rappellé que la Flore Farnèfe 8c quelques autres
figures habillées de drap.
Mais on peut aflurer hardiment, dit Winkelmann
, .( hiß..de Fart. liv. IV . ch. y. I. d. )
qu’il s’e l f çonfervé autant de ftatues de femmes
vêtues d’étoffes de laine .que de ftatues ajuftées
de draperies légères. Le drap eft-très^reconnoiftable
à l’ampleur de fes plis, ainfî qu’aux ruptures
qu’il contraéloit lorfqu’on le plioic dans des
prefîes après l’avoir lavé'8c foulé.
D R A 4 4 5 -
«Q uan t, ajoute Je même favant antiquaire»
( ibid. §. I I I , ) au deflin des figures drapées ,
la fineffe du ta<ft 8c la délicateffe du fentiment,
y ont moins de part-que la juftelTe du difeerne-
ment 8c l’étendue du fa voir, tant pour l’obferver
8c l’enfeigner, que pour l’imiter 8c le pratiquer.
Cela n'empêche pas que cette partie-de l’art n’offre
-encore des objets de recherches non moins inté-
relïans pour le connoilfeur que pour l’artifte. La
draperie eft au nud, ce que l'expr:efîi.on eft à la
penfée 5 8c nous avons fouvent moins de peine
à trouver la penfée que l'expreftion, ou la vraie
tournure de la penfée. Comme dans les premiers
temps de l’art on faifoit plus de figures drapées
que de figures nues, 8c que cette maxime étoit
fi générale dans les plus beaux fiècles de la Grèce
par rapport aux figures de femmes, qu’on peut
compter cinquante figures drapées contre une
nue y il e'toit naturel que les artiftes de tous les
tems ne s'attachaffent p^s moins à bien rendre
l’élégance de la draperie que la beauté du nud.
On chercha le gracieux, non-feulement dans
les attitudes 8c les allions, mais aufli dans les
habits.& dans les ajuftemens. En effet, ks.grâces
les plus anciennes étoient repréfentées vêtues. S’il
fuifit aujourd’hui à l’artifte de bien étudier quatre ou
cinq des plus belles ftatues fans draperie pour-bien
faifir la beauté du nud , il a befoin de chercher
l’élégance de la draperie dans cent figures habillées.
11 eft même très rare de trouver une ftatue
drapée qui reflemble à une autre pour l’ajufte-
ment, tandis qu’ ij n’y a rien de plus ordinaire
que de trouver des ftatues nues d’une reffemblance
parfaite : telles font en grande partie les-ftatues
de Vénus. Il en eft de même des ftatues d’A pollon
via plupart femblent avoir été exécutées
d’après un feul modèle , comme l'attellent trois
ftatues femblables de ce Dieu , à la villa Mé-
dicis , 8c une autre au capitole. La même remarque
eft aufti applicable à -la plupart des jeunes fa-
tyres. Je dirai 'donc que le deftïn des figures
drapées peut être nommé à.jufte titre une partie
effentielle de l'art. Peu i ’artiftes modernes .font
exempts de critique par rapport à l'habillement
de leurs figures j ceux du fiècle • pafte ont tous
péché contre cette partie , le feul Pouflîn excepte
^
ce Les modesties , dit le comte de Cay lus,
font dans l'habitude de regarder comme des.toges
toutes les draperies mî :psu amples , dont les
figures romaines font vêtues. Quand les ,monu-
mens repréfentent des hommes u’im certain âge ,
on leur accorde promptement les honneurs.con-
fulaires ; 8c fi les draperies font moins étendues ,
8c qu’elles biffent un plus grand nombre de parties
du corps découvertes, les;figures prennentauffî-tôt
le nom de philofophes; telle eiï l’opinion ordinaire
: on a tort de donner légèrement ces fortes
de dénominations 3 mais il faut convenir auflî que