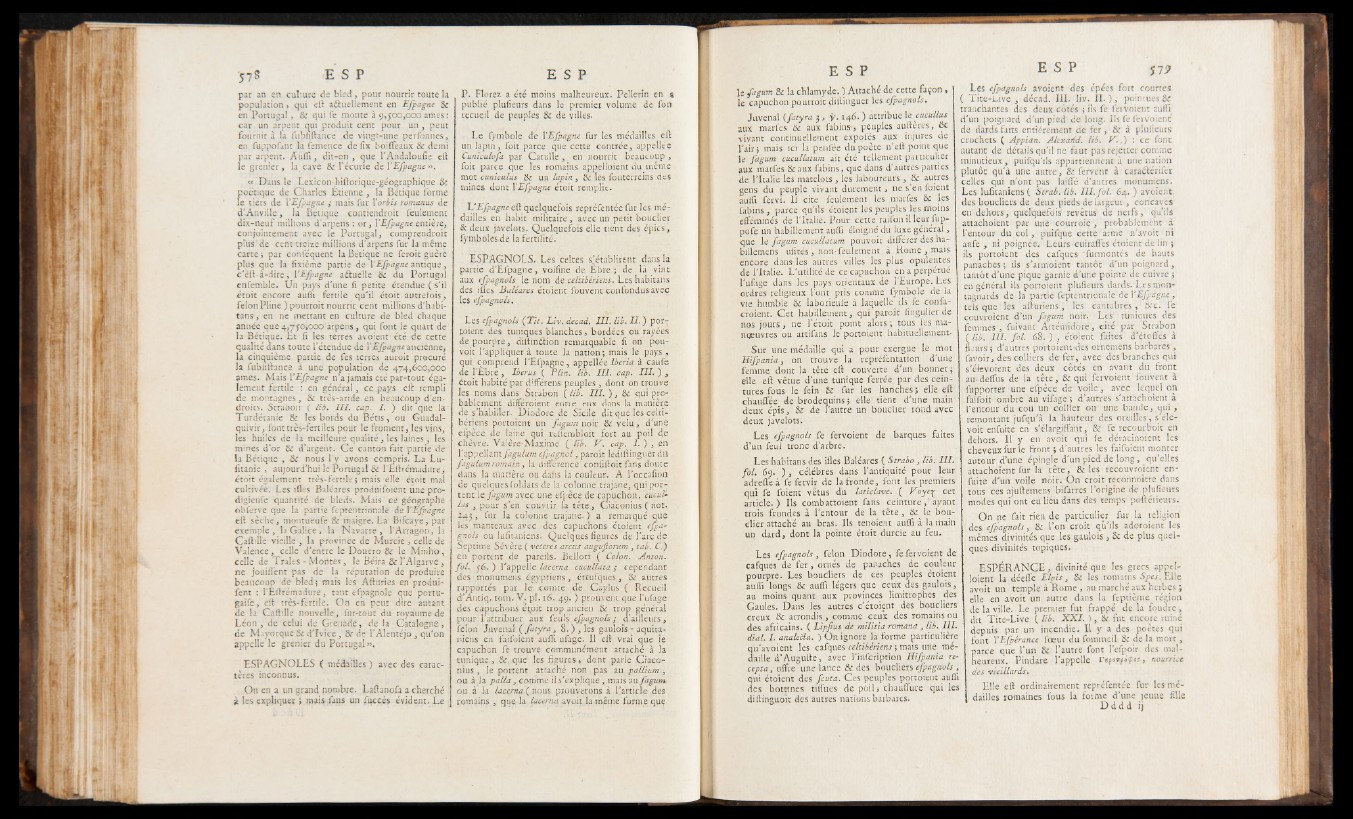
57? ES P
par an en culture de b led, pour nourrir toute la
population » qui eft a&uellement en Efpagne &
en Portugal, & qui fe monte à 9,500,000 âmes :
car un arpent qui produit cent pour un , peut
fournira la fubfiftance de vingt-une perfonnes,
en fuppofunt la femerice de fix boifleaux & demi
par arpent. Aufli , dit-on , que l’Andaloufie eft
le grenier, la cave & l’ écurie de Y Efpagne».
« Dans le Lexicon-hiftorique-géographique &
poétique de Charles Étienne, la Bétique forme
le tiers de YEfpagne ; mais fur Yorbis romanus de
d'Anville, la Bétique contiendroit feulement
dix-neuf millions d'arpens : o r , YEfpagne entière,
conjointement avec le Portugal, comprendroit
plus de cent treize millions d'arpens fur la même
carte ; par coniequent la Bétique ne feroit guère
plus que la fixième partie de Y Efpagne antique,
c'eft-à-dire, Y Efpagne aétuelle & du Portugal
enfemble. Un pays d'une fi petite étendue ( s'il
étoit encore aufli fertile qu'il étoit autrefois,
félon Pline ) pourroit nourrir, cent millions d'habi-
tans, en ne mettant en culture de bled chaque
année que 4,750,000'àrpens , qui font le quart de
la Bétique. Et fi les terres avoient été de cette
qualité dans toute l'étendue de Y Efpagne ancienne,
la cinquième partie de fes terres auroit procuré
la fubfiftance à une population de 474,600,000
âmes. Mais YEfpagne n'a jamais été par-tout également
fertile : en général, ce pays eft rempli
de montagnes, & très-aride en beaucoup d'endroits.
Straboir ( lib. III. cap. I. ) dit que la
Turdétanie & les bords du Bétis, ou Guadal-
quivir, font très-fertiles pour le froment, les vins,
les huiles de la meilleure qualité, les laines, les
mines d'or & d’argent. C e canton fait partie de
la Bétique , & nous l ’y avons compris. La Lu- |
litanie, aujourd'hui le Portugal & l'Eftrémadure, •
étoit également très-fertile ; mais elle étoit mal i
cultivée. Les ifles Baléares produiraient une pro- I
digieufe quantité de bleds. Mais ce géographe
obferve que la partie feptentrionale de YEfpagne
eft sèche, montueufe & maigre. La Bifcaye, par
exemple, la Galice, la Navarre, l’Arragon, la
Caftille vieille , la province de Murcie , celle de
Valence, celle d'entre le Douero & le Minho,
celle de Tra ie s-M on te s , le Béira & l'A lg a rv e ,
ne jouiflènt pas de la réputation de produire
beaucoup de bled 5 mais les Afturies en produi-
fent : l’Eftrémadure, tant efpagnole que pcrtu-
gaife, eft très-fertile. On en peut dire autant
de la Ca ftille nouvelle, fur-tout du royaume de
L é o n , de celui de G ren ad e, de la Catalogne ,
de Mayorque & d'Ivice, 8f de l ’Alentéjo, qu'on
appelle le grenier du Portugal».
ESPAGNOLES ( médailles ) avec des caractères
inconnus.
On en a un grand nombre. Laftanofa a cherché
a les expliquer > mais fans un fuccès évident. Le
E S P
P. Flores a été moins malheureux. Pellerin en a
publié plufieurs dans le premier volume de fon
recueil de peuples & de villes.
Le fymbole dé YEfpagne fur les médailles eft
un lapin, foit parce que cette contrée, appellée
Cuniculofa par Catulle, en nourrit beaucoup,
foit parce que les romains appelloient du même
mot cuniculus & un lapin, & les fouterreins des
mines dont YEfpagne étoit remplie.
U Efpagne eft quelquefois repréfentée fur les médailles
en habit militaire, avec un petit bouclier
& deux javelots. Quelquefois elle tient des épies,
fymboles de la fertilité.
ESPAGNOLS. Les celtes s'établirent dans la
partie d'Efpagïie, voifine de Èbre ; de là vint
aux efpagnols le nom de celtibériens. Les habitans
des illes Baléares étoient fouvent confondus avec
les efpagnols;
Les efpagnols ( Tit. Liv. decad. III. lib. IL ) portaient
des tuniques blanches, bordées ou rayées
de pourpre, diitinétion remarquable fi on pou-
voit l'appliquer à toute la nation ; mais le pays,
qui comprend l ’Efpagne, appellée Iberia à caufe
de l'Èbre, Iberus ( Plin. lib. III. cap. III. ) ,
étoit habité par différens peuples, dont on trouve
les noms dans Strabori ( lib. III. ) , & qui probablement
différoient entre eux dans la manière
de s'habiller. Diodore de Sicile dit que les celtibériens
portoient un fagum noir & v e lu, d'une
efpèce de laine qui rciiembloit fort au poil de
chèvre. Valère- Maxime ( lib. V. cap. I. ) , en
l'appellant fagulum efpagnol, paroît lediftinguer du
fagulum romain, la différence confiftoit fans doute
dans la matière ou dans là couleur. A l'occafion
de quelques foldats de la colonne trajane, qui portent
le fagum avec une efpèce’de capuchon, cucul-
lus 3 pour s'en couvrir la tê te , Ciaconiusf not.
243, fur la colonne trajane.) a remarqué que
les manteaux avec des capuchons étoient efpagnols
ou lusitaniens. Quelques figures de l'arc de
Septime Sévère ( veteres arcus augufiorum, tab. Ci)
en portent de pareils. Bellori ( Colon. Anton,
fol. 56. ) l'appelle lacerna cucullata : cependant
des monumens égyptiens, étrufques , Sr autres
rapportés par le comte de Çaylus ;( Recueil
d'Antiq. tom. V. pl. 16. 49. ) prouvent que l’ufage
des capuchons étoit trop ancien & trop général
pour l'attribuer aux feuls efpagnols i d'ailleurs,
félon Juvenal ( fatyra, 8. ) , les gaulois - aquitain
ens en faifoient aufli ufage. II eft vrai que Je
capuchon fe trouve communément attaché à la
tunique , &r. que les figures, dont parle Cîaco-
nius, le portent attaché non pas au pallium,
ou à la palla , comme il s'explique, mais au fagum
ou à la lacerna ( nous prouverons à l'article des
romains , que la lacerna avoit la même forme que
E S P E S P
le fagum & la chlamyde. ) Attaché de cette façon,
le capuchon pourroit diftinguer les efpagnols.
Juvenal ( fatyra 3 , ÿ . 146. ) attribue le cucullus
aux mariés & aux fabins-, peuples auftères, &
vivant continuellement expofés aux injures de
l'air i mais ici la penfée du poète n'eft point que
le fagum cucullatum ait été tellement particulier
aux marfes &aux fabins, que dans d'autres parties
de l'Italie les matelots, les laboureurs, & autres
gens du peuple vivant durement, ne s'en foient
aufli fervi. Il cite feulement les màrfes & les
fabins , parce qu'ils étoient les peuples les moins
efféminés de l'Italie. Pour cette raifon il leur fup-
pofe un habillement aufli éloigné du luxe général,
que le fagum cucullatum pouvoir différer des ha-
billemens ufités, non-feulement, à Rome , mais
encore dans: les autres villes les plus opulentes
de l'Italie. L'utilité de ce capuchon en; a perpétué
l'ufage dans les pays orientaux de l’Europe. Les
ordres religieux l’ont pris comme fymbole de la
vie humble & laboriéufe à laquelle ils fe confa-
croient. C e t habillement, qui paroît fingulier de
nos jours, ne l’étoit point alors; tous les manoeuvres
ou artifans le portoient habituellement.
Sur une médaille qui a pour exergue le mot
Hifpania, on trouve la repréfentation d'une
femme dont la tête eft couverte d'un bonnet ;
elle eft vêtue d'une tunique ferrée, par des ceintures
fous le fein & fur les hanches ; elle eft
chauffée de brodequins; elle tient d'une main
deux épis , & de l'autre un bouclier rond avec
deux javelots.
Les efpagnols fe fervoient de barques faites
d’ un feui tronc d’arbre.
Les habitans des ifles Baléares ( Strabo, lib. III.
fol. 69. ) , célébrés dans l’antiquité pour leur
adrefleà fe fervir de la fronde, font les premiers
qui fe foient vêtus du laticlave. ( Voye[ cet
article.) Ils combattoient fans ceinture,? ayant
trois frondes à l'entour de la tê te , & le bouclier
attaché au bras. Ils tenoient aufli à la îliain
un dard, dont la pointe étoit durcie au feu.
Les efpagnols, félon Diodore, fe fervoient de
cafques de f e r , ornés de panaches de couleur
pourpre. Les boucliers de ces peuples étoient
aufli longs & aufli légers que ceux des gaulois,
au moins quant aux provinces limitrophes des
Gaules. Dans les autres c'étoient des boucliers
creux & arrondis., comme ceux des romains ou
des africains. ( Lipfius de militia romana , lib. III.
dial. I. analefta. ) On ignore la forme particulière
qu’avoient les cafques celtibériens ; mais une médaille
d'Augufte, avec l'infeription Hifpania re-
cepta 3 offre une lance & des boucliers efpagnols,
qui étoient des feuta. Ces peuples portoient aufli
des bottines tiflues de poil > chauflure qui les
diftinguoit des autres nations barbares.
$ 7 9
Les efpagnols avoient des épées fort courtes
( Tite-Live , déc ad. III. liv. I L ) , pointues &
tranchantes des deux côtés ; ils fe fervoient aufli
d’un poignard d’un pied de long. Ils fe fervoient
de dards faits entièrement de fe r , & à plufieurs
crochets ( Appian. Alexarid. lib. V . ,) : ce font
autant de détails qu'il ne faut pas rejetter comme
minutieux, puifqu'ils appartiennent à une nation
plutôt qu'à une autre, & fervent à cara&érifer
celles qui n'ont pas laifle d’autres monumens.
Les lufitaniens ( Strab. lib. III. fol. 64. ) avoient
des boucliers de deux pieds de largeur, concaves
en dehors, quelquefois revêtus de nerfs, qu’ils
attachoient par une courroie , probablement à
l'entour du c o l , püifque cette arme n'avoit ni
anfe , ni poignée. Leurs-cuiraffes étoient de lin ;
ils portoient des cafques "furmontés de hauts
panaches ; ils s'armoient tantôt d’un poignard,
tantôt d’une pique garnie d'une pointe de cuivre 5
en général ils portoient plufieurs dards. Les montagnards
de la partie feptentrionale àc Y Efpagne,
tels que les afturiens, lés cantabres , &rc. fe
couvroient d'un fagum noir. Les tuniques des
femmes , fuivant Artémidôre, cité par Strabon
( lib'. III. fol. 68. ) , étoient faites d’étoffes à
fLurs; d'autres portoient-des ornemens barbares,
favoir, des colliers de fer, avec des branches qui
s'ékvoient des deux côtés en avant du front
au-deffus de là tê te , & qui fervoient fouvent à
fupporter une efpèce de voile, avec lequel on
faifoit ombre au vifage ; d'autres s’attachoient à
• l'entour du cou un collier ou une bande, q u i,
remontant jufqu'à la hauteur des oreilles, s'éle-
voit enfuite en s'élargiffant, & fe recourboit en
dehors. Il y en avoit qui fe déracinoient les
cheveux fur le front ; d’autres les faifoient monter
autour d’une épingle d'un pied de long, qu'elles
attachoient fur la tête , & les, recouvroient en-
fuite d'un voile noir. On croit reconnoître dans
tous ces ajuftemens bifarres l’origine de plufieurs
modes qui ont eu lieu dans des temps poftérieurs.
On ne fait rien de particulier fur la religion
des efpagnols y & l'on croit qu'ils adoroient les
mêmes divinités que .les gaulois, & de plus quelques
divinités topiques.
E S P É R A N C E , divinité que les grecs appelloient
la déeffe Elpis 3 & les romains Spes. Elle
avoit un temple'à Rome , au marché aux herbes ;
elle en avoit un autre dans la feptième région
de la ville. Le premier fut frappé de la foudre,
dit Tite-Live ( lib. X X L ) , & fut encore ruiné
depuis par iin incendie. Il y a des poètes qui
font YEfpérance foeur du fommeil & de la mort ,
parce que l'un & l’autre font l’efpoir des malheureux.
Pindare l’appelle r#?porfiçes, nourrice
des vieillards.
Eüe eft ordinairement repréfentée fur les médailles
romaines fous la forme d’une jeune fille
D d d d ij