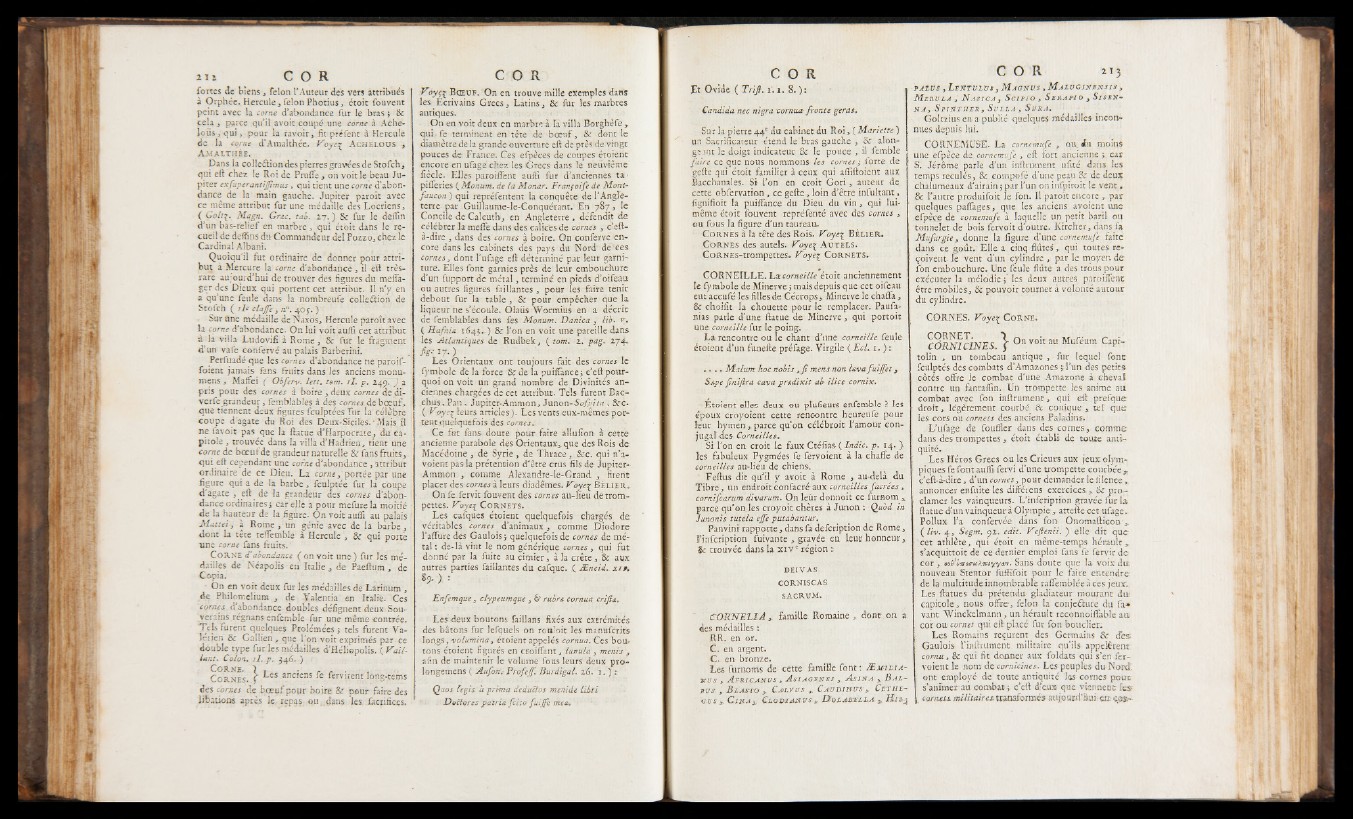
m C O R
fortes de biens , félon l’Auteur dés vers attribués
à Orphée. Hercule, félon Photius, étoit fouvent
peint avec la corne d’abondance fur le bras ; &
c e la , parce qu’il avoir coupé une corne à Ache-
lo iis , q u i, pour la ravoir, fit préfent à Hercule
de la corne d’Amalthée. Voye^ Achelous ->
Amalthêe.
Dans la collection des pierres gravées de Stofch,
qui eft chez le Roi de Prufle, on voit le beau Jupiter
exfuperantijfîmus, qui tient une corne d’abondance
de la main gauche. Jupiter paroît avec
ce même attribut fur une médaille des Locriens,
( Ç °P l' Magn. Grac. tab. 27. ) & fur le deffin
d’un bas-relief en marbre, qui étoit dans le recueil
de deffins du Commandeur del Pozzo, chez le
Cardinal Albani.
Quoiqu'il fut ordinaire de donner pour attribut
à Mercure la corne d’abondance, il eft très-
rare aujourd’hui de trouver des figures du mefîa-
ger des Dieux qui portent cet attribut. Il n’y en
a qu’une feule dans la nombreufe collection de
Stofch ( île clajfe, /i°. 405. )
Sur Une médaille de Naxos, Hercule paroît avec
la corne d’abondance. On lui voit auflî cet attribut
a la villa Ludovifi à Rome, & fur le fragment
d’un valé confervé au palais Barberîni.
Perfuadé que les cornes d’abondance ne paroif-
foient jamais fans fruits dans les anciens monu-
mens , Maffei ( Obferv. lett. tem. i l . p. 249.^ a
pris pour des cornes à boire , deux cornes de di-
verfe grandeur , femblables à des cornes de boeuf, ;
que tiennent deux figures fculptées Tur la célèbre
coupe d agate du Roi des Deux-Sicilës. • Mais il '
ne fa voit pas que la ftatue d’Harpocrate, du Capitole
, trouvée dans la villa d’Hadrien., tient une
corne de boeuf de grandeur naturelle & fans fruits,
qui eft cependant une corne d’abondance, attribut
ordinaire de ce Dieu. La corne, portée par une
figure qui a de la barbe, fculptée fur la coupe
d agate , eft de la grandeur des cornes d’abon- :
dance ordinaires i car elle a pour mefurela moitié
de la hauteur de la figure. On voitaufli au palais '
Mattéi 3 a Rome, un génie avec de la barbe,
dont la tête reflemble à Hercule , & qui porté
une corne fans fruits.
Corne d’abondance ( on voit une) fur les médailles
de Néapolis en Italie , de Paeftum , de
Copia.
On en voit deux fur les médailles de Larinum ,
de Philomelium , de Yalentia en Italie. Ces
cornes d abondance doubles défignent deux Souverains
regnans enfemble fur une même contrée.
'Tels furent quelques Ptolémées j tels furent Va-
Jeiien & Gallien, que l ’on voir exprimés par ce
double type fur les médailles d’Héliopolis. ( Vaillant.
Colon.. i l. .p. 346. ) ( Corne. j T . Cornes, t ^es ancîens fe fervirent long-tems
des cornes de boeuf pour boire & pour faire des
libations après le repas ou..dans les. facrifices.
C O R
Voye% Boe u f . On en trouve mille exemples dans
les Ecrivains Grecs, Latins, & fur les marbres
antiques.
On en voit deux en marbre à la villa Borghèfe ,
qui fe terminent en tête de boeu f, & dont le
diamètre de la grande ouverture eft de près de vingt
pouces de. France. Ces efpèces de coupes étoient
encore en ufage chez les Grecs dans le neuvième
fîècle. Elles paroifient auflî fur d’anciennes ta •
pifTeries ( Monum. de la Monar. Françoise de Mont-
faucon ) qui repréfentent la conquête de l’Anglè-
terre. par Guillaume-le-Conquérant. En 78 7 , le
Concile de Calcuth, en Angleterre, défendit de
célébrer la méfié dans des calices de cornes , c’eft-
à-dire , dans des' cornes à boire. On conferve encore
dans les cabinets des pays du Nord de’ces
cornes , dont l’ ufage eft déterminé par leur garniture.
Elles font garnies près de leur embouchure
d’un fupport de métal, terminé en pieds d’oifeau
ou autres figures faillantes , pour les faire tenir
debout fur la table, & pour empêcher que la
liqueur ne s’écoule. Olaüs Wormius en a décrit
de femblables dans fes Monum. Danica , lib. v.
( Hafnia 1643. ) & l’on en voit une pareille dans
les Atlantiques de Rudbek., f tom. 2. pag. ZJ4.
fig- 17- )
Les Orientaux ont toujours fait des cornes le
fymbole de la force & de la puifîànce j c’efi pourquoi
on voit un grand nombre de Divinités anciennes.
chargées de cet attribut. Tels furent Bac-
.chus, Pan, Jupiter-Ammon, Junon-Sofpita 3 & c .
( Fojyfç leurs articles). Les vents, eux-mêmes portent.
quelquefois des cornes.
Ce fat fans doute pour faire àllufion à cette
ancienne parabole des Orientaux,, que des Rois de
Macédoine , de Syrie, de Thrace, &c. qui n’a-
voientpasla prétention d’être crus fils de Jupiter-
Ammon , comme Alexandre-le-Grand. , firent
placer d e scornes à leurs diadèmes. Voyeç Bél ier ..
On fe fervit fouvent des cornes au-ueu de trompettes.
Voyez Cornets.
Les cafques étoient quelquefois chargés de
véritables cornes d’animaux, comme Diodore
l’afiure dès Gaulois j quelquefois de carnes de métal
: de-là vint le nom générique cornes, qui fut
donné par la fuite au cimier, à la crête, & aux
autres parties faillantes du cafque. ( Æneid.. xir»
h - ) =
Enfemque , clypeumqjue, & rubra cornua crifia.
Les deux boutons faillans fixés aux extrémités
des bâtons fur lefquels on roaloit les manufcrits
longs , volumina, étoient appelés cornua. Ces boutons
étoient figurés en croifîant, lanuld, menis ,
afin de maintenir le volume fous leurs deux pro-
longemens ( Aufon.- Profejf. Burdigal. 26. 1. ) r
Quos legis a prima dedüclos menide libri
Dociores patria fcito fuijfe mea.
C O R
Et Ovide ( Trift. 1 . 1 . 8. ):
Candida nec nigra cornua fronte géras.
Sur la pierre 44e du cabinet du Roi, ( Mariette J
un Sacrificateur étend le bras gauche , & alon- ;
geint le doigt indicateur & le pouce , il femble
faire ce que nous nommons les cornes j forte de !
gefte qui étoit familier à ceux qui afiiftoient aux
Bacchanales. Si l’on en croit G o r i, auteur de
cette obfervation, ce g e fte lo in d’être infultant,
fîgnifioit la puiftance du Dieu du v in , qui lui-
même étoit fouvent repréfenté avec des cornes ,
ou fous la figure d’un taureau.
Cornes à la tête des Rois. Voye% Bélier.
Cornes des autels. Voyei Autels.
CoRNES-trompettes. Voyei Cornets.
CORNEILLE. La corneille étoit anciennement
le fymbole de Minerve ; mais depuis que cet oifeau
eut accufé les filles de Cécrops, Minerve le chafla ,
& choifit la chouette pour le remplacer. Paufa-
nias parle d’une ftatue de Minerve, qui portoit
une corneille fur le poing. .
La rencontre ou le chant d’ une corneille feule I
étoient d’un funefte préfage. Virgile ( EcL 1. )
. . . . Matum hoc nobis mens non lava fuijfe t ,
Sape finijira cava pradixit ab iliçe cornix..
Etoient-elles deux ou plufieurs enfemble l les
époux croyoient cette rencontre heureufe pour
leur hymen, parce qu’on célébroit l’amour con- ,
jugal des Corneilles.
Si l’on en- croit le faux Ctéfias ( Indic. p. 14. ).
les fabuleux Pygmées fe fervoient à la chafle de
corneilles au-lieu de chiens.’
Feftus dit qu’il y avoit à Rome , au-delà du
Tibre , un endroit confacré aux corneilles facrées,
cornifcarum divarum. On leiir donnoit ce furnom ,
parce qu’onles croyoit chères à Junon : Quod in
Junonis tutela ejfe putabantur.
Panvinr rapporte, dans fa defeription de Rome,
î’infeription fuivante ,. gravée en leur honneur y
trouvée dans la x i v e région
deivas-
CQRNISCAS
SACRUM.
C O R N E l lA , famille Romaine ^ dent on a.
des médailles :
RR. en or.
C. en argent;
C. en bronze.
Les furnoms de cette famille font: Æxcilja-
k u s j, A m i c jix ru s 3 A s ia g e n e s ,. A s m a x B a l —
b u s . t B lals-.io - „ Ca-l v u s y, C A u m m r s , Ce t h e -
g.us » Cm.a , Clqvjanvs ». I^olasella ,
C O R * 1 3
p a lus , L en tu lu s , M agnus , M a lugjnens i s ,
M eRULA j N a SICA j SciPIO , S eRAPI O y S i s en -
N A 3 S PIN.T HER , SutLA , SiTRA.
Goltzius en a publié quelques médailles inconnues
depuis lui.
CORNEMUSE. La comemufe , ou. du moins
une efpèce de cornemufe , eft fort ancienne > car
S. Jérôme parle d’un inftrument uüité dans les
temps reculés, & eompofé d’une peau & de deux
chalumeaux d’airain 5 par l’un on infpiroit le vent,
& l’autre produifoit le fon. Il paroït encore , par
quelques paftages , que les anciens avoient une
.efpèce de cornemufe à laquelle un petit baril ou
tonnelet de bois fervoit d'outre. Kircher,.dans fa
Mufurgie, donne la figure d’une cornemufe faite
dans ce goût. Elle a cinq flûtes, qui toutes reçoivent.
le vent d’un cylindre, par le moyen.de
fon embouchure. Une feule flûte a des trous pour
exécuter la mélodie ; les deux autre-s paroiftent
être mobiles, & pouvoir tourner à volonté autour
du cylindre.
CORNES. Voyeç Corne.
CdÆOTCiA'fS. ° n T01t au Mufeunv CaP'~
tolin- un tombeau antique , fur lequel font
fculptés des combats d’Amazones îd’un. des petits
, côtés offre le combat d’ une Amazone à cheval
i contre un fantaflïn. Un trompette les anime ait
combat avec fon inftrument, qui eft prefque
; droit, légèrement courbé & conique , tel que
les cors ou cornets des anciens Paladins.
L ’ ufage de fouffier dans des cornes,.. comme
: dans des trompettes , étoit établi de toute antiquité.
Les Héros Grecs ou les Crieurs aux jèuxolym-
i piques fe font aufti fervi d’une trompette courbée,
c’ eft-à-dire, d’un cornet, pour demander le filenee
annoncer enfuite les différens exercices., & pro-
> clamer les vainqueurs. L’infcription gravée fur la.
ftatue d?un vainqueurà Olympie , attefte cet ufage..
Pollux l’a confervêe dans fon Onomafticon,.
‘ ( liv. 4 , Segm. <)l. edit. Veftenii. ) elle dit que-
cet athlète, qui étoit en même-temps hérault,
s’acquittoit de ce dernier emploi fans fe fervir de-
, cor ,. ooè,b%oxru\is.iy.yai. Sans- doute que la voix- du
: nouveau- Stentor fiiffrfoit pour le faire entendre
de la multitude innombrable rafiembléeàces jeux..
. Les ftatues du- prétendu gladiateur mourant dut
capitole, nous offre, félon la conjecture du fa*
vant YVinckelmann, un hérault reconnoiflâble an
cor ou\ cornet qui eft placé fur fon bouclier;
Les Romains reçurent des Germains 8c des
; Gaulois l’inftrument militaire qu’ ils appelèrent
. cornu 3 & qui fit donner aux foldats qui s’en fervoient
le nom de comicines. Les peuples du-Nord’
ont employé de toute antiquité les cornes pour
s’animer au combat ; c’ eft d’eux que viennent Iés>
j carnets, militaires, transformés aujourd’hui- en: cos.-