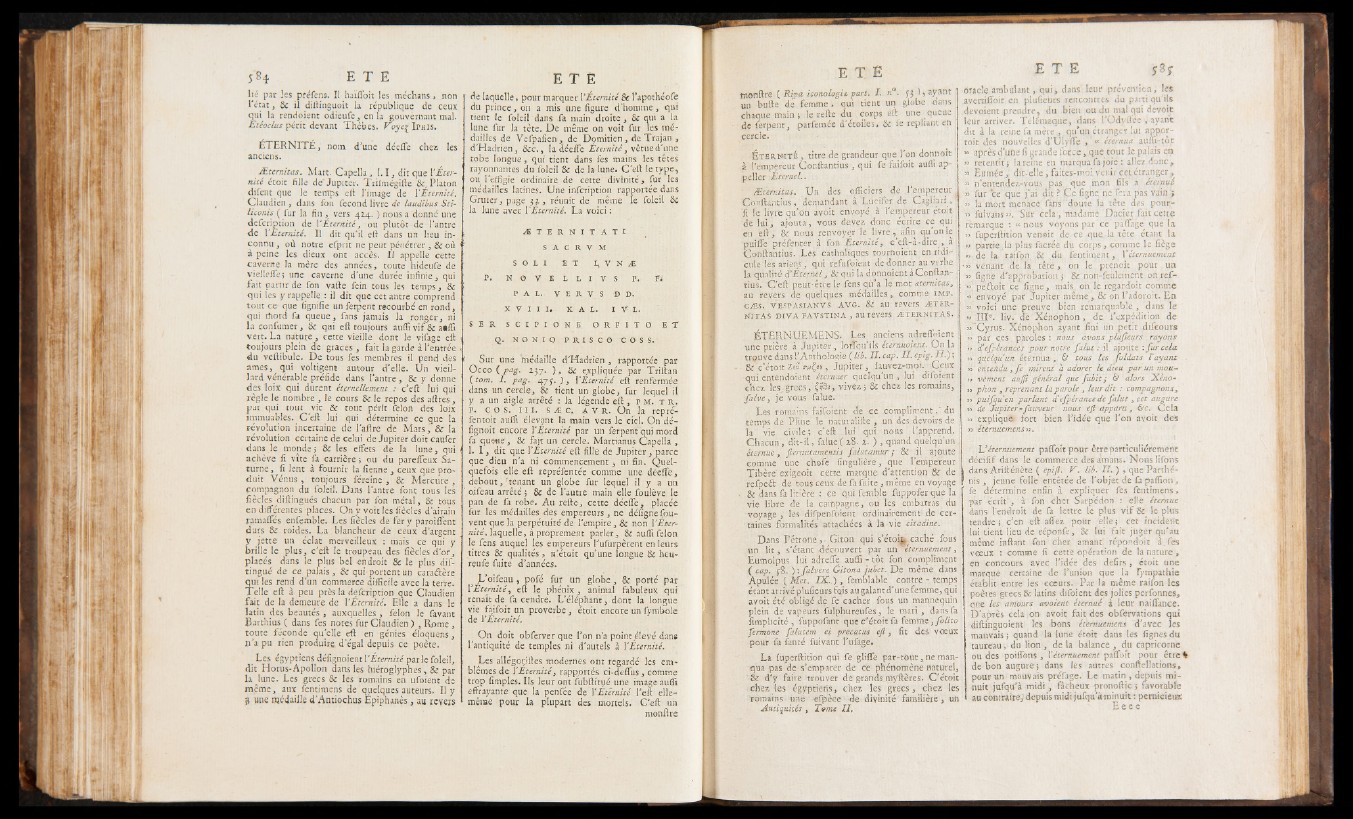
j8* E T E
lié par les préfena. Il haïffoit les méchans » non
l'état , 8c il dilfinguoit la république de ceux
qui la rendaient odieufe , en la gouvernant mal.
Étéoclus périt devant Thèbes. Voyeç Iphis.
E T E R N IT E , nom d’une déelTe chez les
anciens.
Æternitas. Mart. Capella, 1. 1 J dit que YÉternité
étoit fille de'Jupiter. Trilmégifte &, Platon
difent que le temps elt l’image de Y É tern ité .
Claudien , dans Ton fécond livre de laudibus Sti-
liconis ( fur la fin , vers 424. ) nous a donné une
defcription de YÉternité 3 ou plutôt de l’antre
de YEternité. Il dit qu’il elt dans un lieu in-,
connu , où notre efprit ne peut pénétrer , & où
à peine les dieux ont accès. Il appelle cette
caverne la mère des années, toute hideufe de
vielleffe, une caverne d’une durée infinie, qui
fait partir de fon vafte fein tous les temps, &
qui les y rappelle : il dit que cet antre comprend
tout ce' que lignifie un ferpent recourbé en rond,
qui rîiord fa queue, fans jamais la ronger, ni
la confumer, & qui eft toujours auffi v if 8c aifli
vert. La nature, cette vieille dont le vifage eft
toujours plein de grâces , fait la garde à l’entrée
du veftibule. De tous fes membres il pend des
âmes, qui voltigent autour d’elle. Un vieillard
vénérable prélîde dans l’antre, & y donne
des loix qui durent éternellement : c’eft lui qui
règle le nombre , le cours & le repos des aftres,
par qui tout vit & tout périt félon des loix
immuables. C ’eft lui qui détermine ce que la
révolution incertaine de l ’aftre de M a r s & la
révolution certaine de celui de Jupiter doit caufer
dans le monde5 & les effets de la lune, qui
achève fi vite fa carrière ; ou du pareffeux Saturne
, fi lent à fournir la fienne , ceux que produit
V én u s, toujours féreine , & Mercure,
Compagnon du Toleil. Dans l ’antre font tous les
fiècles diftingués chacun par fon métal, & tous
en différentes places. On y voit lès fiècles d’airain
ramafles enfemble. Les fiècles de fer y parodient
durs 8c roides. La blancheur de ceux d’argent
y jette un éclat merveilleux : mais ce qui y
brille le plus, c’eft le troupeau des fiècles d’or,
placés dans le plus bel endroit Se le plus distingué
de ce palais, 8e qui-portent un cara&ère
qui les rend d’un commerce difficile avec la terre.
Telle eft à peu près la defcription que Claudien
fait de la demeure de YÉternité. Elle a dans le
latin des beautés', auxquelles, félon le favant
Barthius ( dans fes notes fur Claudien ) , Rome ,
toute féconde qu’elle eft en génies éloquens,
n’a pu rien produire d’égal depuis ce poète.
Les égyptiens défignoientl’Émvz/ré parlefoleil,-
dit Horus-Apollon dans les hiéroglyphes, & par
la lune. Les grecs & les romains en ufoient de
même, aux fentimens de quelques auteurs. Il y
3 une médaille d’Antiochus Épiphanès, au revers
E T E
de laquelle, pour marquer YEternité & l’apothéofe
du prince, on a mis une figure d’homme, qui
tient le foleil dans fa main droite, 8c qui a la
lune fur la tète. De même on voit fur les médailles
de Vefpafien, de Dçmitien, deTrajan ,
d’Hadrien, 8cc., la déeffe Éternité, vêtue d’une
robe longue, qui tient dans fes mains les têtes
rayonnantes du foleil 8c de la lune. C ’eft le type,
ou l ’effigie ordinaire.de cette divinité, fur les
médailles latines. Une infcription rapportée dans
Grtiter, page 3 2 , réunit de même le foleil 8c
la lune avec 1 Éternité. La voici :
Æ T E R N I T A T I
S A C R y M
S O L I E T I, V'N Æ
P. N O V E L L I V S P. fi
PAL. V E R VS D D.
X V I I I . K A L. I V L.
S ER S C I P I ON E O R F I T O ET
Q. N O N I 0 P R I S C © C t> S S.
Sur une médaille d’Hadrien, rapportée par
Occo ( pag. 237. ) , 8c expliquée par Triftan
( tom. I . pag. 47j’. ) , YEternité eft renfermée
dans un cercle, 8c tient un globe, fur lequel il
y a un aigle arrêté : la légende e f t , p m . t r .
p . c o s. n i . s æ c f a v R. On la repré-
fentoit auffi élevant la main vers le ciel. On dé-
fignoit encore YEternité par un ferpent qui mord
fa queue, & fait un cercle. Martianus Capella , 1. 1 , dit que YÉternité eft fille de Jupiter, parce
que dieu n’a ni commencement -3 ni fin. Quelquefois
elle eft repréfentée comme une déeffe,
debout, rtenant un globe fur lequel il y a un
oifeau arrêté j & de l’autre main elle foulève le
pan de fa robe. Au refte, cette déeffe, placée
fur les médailles des empereurs, ne défignefou-
vent que la perpétuité de l'empire, & non Y Éternité,
laquelle, à proprement parler, 8c auffi félon
le fens auquel les empereurs l’ufurpèrent en leurs
titres 8c qualités , n’étoit qu’une longue 8c heu-
reufe fuite d’années.
L’oifeau, pofé fur un globe , 8c porté par
YÉternité, eft le phénix, animal fabuleux qui
renaît de fa cendre. L’éléphant, dont la longue
vie farifoit un proverbe, étoit encore un fymbole
de YÉternité.
On doit obferver que l’on n’a point élevé dans
l ’antiquité de temples ni d’autels à YÉternité.
Les allégoriftes modernes ont regardé les emblèmes
de l’Éternité, rapportés ci-deffus, comme
trop fimples. Ils leur ont fubftitué une image aufli
effrayante que la penfée de YÉternité. l’eft elle-
même pour la plupart des mortels. C ’eft un
monftre
E T E
monftre ( Ripa iconologin part. I. n°. ) , ayant
un bufte de femme, qui tient un globe dans '
chaque main ; le refte du corps eft une queue ;
de ferpent, parfemée d'étoiles, & fe repliant en :
cercle.
É t e r n i t é , titre de grandeur que l'on donnoit1
à l’empereur Cor.ftantius, qui fe faifoit aufli ap-
peller Eternel..
Æ ternit us. Un dés officiers de l’empereur ■
Conftantius, demandant à Lucifer de Cagfiari , '
fi le livre qu’ on avoit envoyé à l’empereur étoit
dé lu i, ajouta, vous devez donc écrire ce qui '
en e f t 8 c nous renvoyer le livre, afin q uonle;
puiflè préfenter à fon Éternité, c’eft-à-dire , à
Conftantius. Les catholiques tournoient en ridi- ;
cule les ariens, qui refufoient de donner, au verbe j
la qualité d'Éternel, & qui la donnoient.àConftan- .
tius. C ’eft peut-être le fens qù’a le mot sternitas3 \
au revers de quelques médailles, comme im p. ■
cæ s . V es p A s i AN V s AVG. 8c au revers ÆT.er-
Nit a s d iv a FAVSTiNA, au revers æ t e r n it a s . \
. ÉTERN-UEMENS. Les anciens adreffoient j
-une prière à Jupiter, lortqu’ ils éie'rnuoient. On ia j
trouve dans l’Anthologie ( lib. I I . cap. I I . cpig. H.) ; j
& c’étoit Ztv raÇov, Jupiter, fauvez-mor.- Ceux
qui entendaient éternuer quelqu’un, lui difoient ■
chez tes„ grecs/<£?&, vivez 5 8c chez les romains,
falve 3 je vous falue.
Les romains faîfoient de ce complimentdu
temps de Pline le naturalifte , un dès-devoirs de j
la vie civile ; c’eft lui ■ qui nous l’apprend. •
Chacun, dit-il, 'falue ( 28. 2. ) , quand quelqu'un -!
éternue, fierrmtamentis falut arnur ; & il ajoute !
comme une chofe fingulièré, que l’empereur ■
Tibère' exigeoit cette marque- d’attention 8c de
refpeét de tous ceux de fa fuite, même en voyage
8c dans fa litière : ce qui fcmble fuppofer que la
vie libre de la campagne, ou les embarras; du
voyage, les difpenfoient ordinairement de certaines
formalités attachées à la vie citadine.
Dans Pétrone >- Giton qui s'étoùk. caché fous
un li t , s’ étant découvert par un "éternuement,
Eumolpus lui adreffe aufli - tôt fon compliment
( cap. ^8. ) : fplvere Gitona jubet. De même dans
Apulée ( Mer. IX . ) , femblable contre - temps
étant arrivé plufieurs fois au galant d’ une femme, qui ;
avoit été obligé de fe cacher fous un mannequin
plein de vapeurs fulphureufes, le mari, dans fa |
fimplicfté , fuppofant que c ’étoit fa femme, fôlito
fermone falutem ei precatus e ft, fit des voeux
pour fa fanté fuivant l’ufage.
La fuperftition qui fe gliffe par-tout, ne manqua
pas de s’emparer de ce phénomène naturel,
8c d’y faire trouver de grands myftères. C ’étoit
chez les égyptiens, chez les grecs, chez les
romains une efpèee 4 e divinité familière, un
Antiquités , Terne I I ,
E T E y8y
oracle ambulant, qui, dans leur prévention, les
avertiffoit en plufieurs rencontres du parti qu’ils
dévoient .prendre, du bien ou du mal qui devoir
leur arriver. Télémaque, dans l’Odyflée , ayant
dit à la reine fa m è r e q u ’un étranger lui app.or-
toit des nouvelles d’Ulyffe , cc éternua aufli-tôt
x> après d’une fi grande force, que tout le palais eu
» retentit j la reine en marqua fa joie : allez donc,
« Eumée, dit-elle, faites-moi. venir cet étranger,
” n’entendez-vous pas que mon fils a étemuft
» fur ce: que j’ai dit ? C e figne ne fera pas vain >
« la mort menace fans doute la tête des pour-
fùiva'ns-” . 'Sur celà, madame Dacier fait cette
remarque : «nous voyons par cë pâffage que la
« fuperftition venoit de ce que la tête étant la
» partie Ja plus facrée du corps, comme le fiège
» de la raifoiT 8ç du fentiraent, Y éternuement
•4 venant de la tê.té, on le pr.enoit pour un
*> figne d’approbation j & non-feulement on ref-
» .pedoit ce figne, mais, on le regardoit comme
»? envoyé par Jupiter même , 8c on l’adoroit. En
« v o ic i une preuve bien remarquable , dans le
» IIIe. liv. de Xénophon, de l'expédition de
» Cyrus. Xénophon ayant fini un petit difeours
» par c.es, paroles : nous avons plufieurs rayons
y> d‘efpérances pour notre falut : il ajoilte : fu r cela.
» quelqu'un étefnua 6* tous les foldats l'ayant
entendu 3 f e mirent a adorer le dieu par un mou-
» vément aujft général que fubitÿ & alors Xéno-
» pKon reprenant la parole , leur dit : compagnons,
33 puifquen parlant d’efpérance de falut , cet augure
33 de Jupiter-fauveur nous eft apparu, &c. Cela
33 explique, fort bien l’idée que l’on avoit des
33 étemuemens».
L’ éternuement paffoit pour être particuliérement
décifif dans le commerce des amans. Nous lifons
dans Arifténète ( epift. V . lib. I I . ) , que Parthé-
nis , jeune folle entêtée de l’objet de la paflion ,
fe détermine enfin à expliquer fes fentimens,
par écrit', à fon cher Sarpédon : elle éternue
dans l’endroit de fa lettre le plus v if 8c le plus
tendre j , c ’en eft affez pour elle; cet incident
lui tient lieu de réponfe, 8c lui fait juger qu’ au
même inftant fon cher amant répondoit à,fes
voeux : comme fi cette opération de la nature,
en concours avec l’idée des defirs, étoit une
marque certaine de l’union que la fympathie
établit entre les coeurs. Par fa même raifon les
poètes grecs 8c latins difoient des jolies perfonnes,
que les amours av oient éternué à leur naiflance.
D ’après cela on avoit fait des obfervations qui
diftinguoient les bons étemuemens d’avec les
mauvais ; quand la lune étoit dans les lignes du
taureau, du lion, delà balance , du capricorne
ou des poiffons , Y éternuement paffoit pour être ^
de bon augure 5 dans les autres conftellations,
pour un mauvais préfage. Le matin , depuis minuit
jufqU’ à midi, fâcheux pronoftic } favorable
au contraire, depuis midi jufqu’à minuit : pernicieux
E e e e