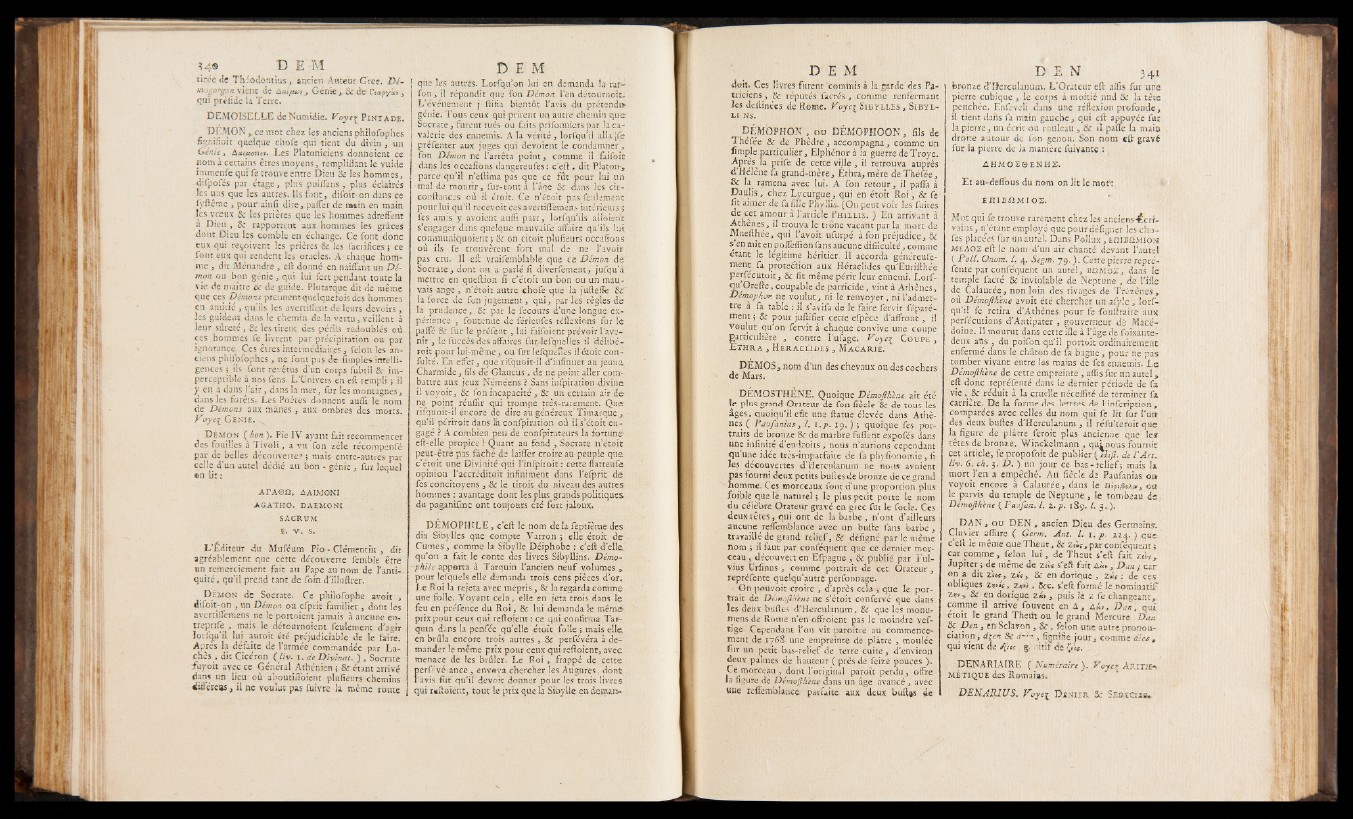
tirée de Théodôntius, ancien Auteur Gree. Dé-
mogorgon vient de A Génie > & de Vtaipyav,
qui préiïde la Terre.
DEMOISELLE de Numidie. Voye% Pintade.
DÉMON , ce mot chez les anciens philofophes
fignifioit quelque cliofe qui tient du divin , un
Génie, Acapoviov. Les Platoniciens donnoienc ce
nom à certains êtres moyens, remplifiant le vuide
immenfe qur fe trouve entre Dieu & les hommes,
difpofés par étage, plus puilTans, plus éclairés
les uns que les autres. Ils font, difoit-on dans ce
fyfteme , pour ainfi dire, palier de main en main
les vceux & les prières que les hommes adreffent
a Dieu , 6c rapportent aux hommes les grâces
dont Dieu les comble en échange. Ce font donc
eux qui reçoivent les prières & les facrifices 5 ce
font eux qui rendent les oracles. A chaque homme
, dit Ménandre , eft donné en naiffant un Démon
ou bon génie, qui lui fcrt pendant toute la
vie de maître 6c de guide. Plutarque dit de même
que ces Démons prennent quelquefois des hommes
en amitié , qu'ils les avertilient de leurs devoirs ,
les guident dans le chemin de la vertu, veillent à
leur sûreté, & les tirent des périls redoublés onces
hommes fe livrent par précipitation ou par
ignorance. Ces êtres intermédiaires, félon les anciens
phifofophes , ne font pas de fimples intelligences
; ils font revêtus d’un corps Subtil & imperceptible
à nos Sens. L ’Univers en eft rempli $ il
y en a dans l’air, dans la mer, fur les montagnes,
dans les forêts. Les Poètes donnent aulli le nom
de Démons aux mânes , aux ombres des morts.
Voye^ G én ie . .
D ém o n ( bon ). Pie IV ayant fait recommencer
des fouilles à T iv o li, a vu fon zèle récompenfé
par de belles découverte? ; mais-entre-autres par
celle d un autel dédié au bon - g é n ie fu r lequel
©n lit :
A r A e o , A A IM ON I
A GA THO - DAEMONI
SACRUM
e. y . s.
L ’Editeur du Muféum Pio - Clémentîn , dit
agréablement que cette découverte femble être
un remerciement fait au Pape au nom de l’antiquité,
qu’il prend tant de foin d’illuftrer.
D ém o n de Socrate. Ce philofophe avoir ,
difoit-on , un Démon ou efprît familier , dont les
avcrtiiïemens ne le portoient jamais à aucune en-
trepnfe , mais le dé tournoient feulement d’agir
ïorSjuil lui auroit été préjudiciable de le faire.
Après la défaite de l’armée commandée par Lâch
é s , dit Cicéron (Liv. 1. de Divinat. ) , Socrate
■ fuyoit avec ce Général Athénien ; & étant arrivé
dans un lieu où aboutifloient plufîeurs chemins
différeas, il ne voulut pas fuivre la même route
| que les autres. Lorfqu’on lui en demanda la rar~
fon, il répondit que fon Démon, l ’en détournoit.
L ’événement j ftifia bientôt l’avis du prétendu*
génie. Tous ceux qui prirent un autre chemin que
Socrate, furent tués ou faits prifonniers par la cavalerie
des ennemis. A la vérité, lorsqu’ il alla [Se
présenter aux juges qui dévoient le condamner ,
Son Démon ne l ’arrêta point, comme il faifoit
dans les occafions dangereufes: c’e ft, dit Platon-,
parcexqu’il n’eftima pas que ce fût pour lui un
mal de mourir, fur-tout à l’âge 6c dans les cir-
conftances où il étoit. Ce n’étoit pas feulement
pour lui qu’il recevoitces avertiflemens intérieurs î
fes amis y avoient aufîl part, lorsqu’ils allbieht
s’engager dans quelque mauvaise affaire qu’ils lui
cômmuniquoient ; 6c on citoit plufîeurs occafîons
où ils fe trouvèrent fort mal de ne l’avoir
pas cru. Il eft vraisemblable que ce Démon de
Socrate , dont on. a parlé fî diversement, jufqu’à
mettre en queflion fî e’etoît un bon ou un mauvais
ange, n’étoit autre chofe que la jufteflè 8c~
la force de fon jugement, qui, par les règles dé
la prudence, & par le Secours d’une longue expérience
, Soutenue de férieufes réflexions fur le
paffé 6c Sur le préfent , lui fiifoient prévoir l ’avenir
, le Succès des affaires fur/leSquelles il délibé-
roit pour lui-même ou fur lesquelles il étoit consulté.
En effet, que rifquoit-il d’infinuer au jeûna
Charmide, fils de Glàucus, de ne point aller combattre
aux jeux Néméens ? Sans înfpiration divine
il voyoit, & Son incapacité , & un certain air de
ne point réufîir qui trompe très-rarement. Que
rifquoit-il encore de dire au généreux Timarque >
qu’il périrait dans-îh confpiration où il s’étoit engagé
? A combien peu de confpirateurs la fortuné
eft-elle propice ! Quant au fond , Socrate n’étoit
peut-être pas fâché de laifTer croire au peuple que
c’étoit une Divinité qui l’infpiroit r cette flatteufe
. opinion Taccréditoit infiniment dans l’efprit de
fes concitoyens , 6c le. tiroit du niveau dés autres
hommes : avantage dont les plus grands politiques
du paganifme ont toujours été fort jaloux.
DÉMOPHILE, c’eft le nom delà feptfème dès
dix Sibylles que compte Varron ; elle étoit de
Cumes, comme la Sibylle Déiphobe : ç’eft d’elle
qu’on a fait le conte des livres Sibyllins. Démo-
'phile apporta à Tarquin l'ancien neuf volumes,
pour lefquels elle demanda trois cens pièces d’or.
Le Roi la rejeta avec mépris, & la regarda comme
une folle. Voyant cela, elle en jeta trois dans le
feu en préfence du R oï, & lui demanda le même
prix pour ceux qui reftoient : ce qui confirma Tar-
qum dans la penfée qu elle étoit folle ; mais elle
en brûla encore trois autres , & perfévéra à demander
le même prix pour ceux qui reftoient, avec
menace de les brûler. Le R o i , frappé de cette
perfévé ance , envoya.chercher les Augures, dont
l'avis fut qu’il devoir donner pour les trois livres
qui rvftoient, tout le prix que La Sibylle en detpa.i>
doit. Ces livres furent'"commis à la garde des Patriciens
, & réputésxfacrés, comme renfermant
les deftinées de Rome. Voye* Sibylles , Sibyll
i NS.
DÉMOPHON , ou DÉMOPHOON , fils de
Théfée & de Phèdre, accompagna, comme un
fîmple particulier, Elphénor à ia guerre de Troye.
Après la prife de cette v ille , il retrouva auprès
d’Hélène ia grand-mère, Éthra, mère de Théfée ,
& la^ ramena avec lui. A fon retour , il paffa à
Daulis, chez Lycurgue, qui en étoit R o i, 6c fe
fit aimer de Sa fille Phyllis. (On peut voir les fuites
de cet amour à l’article Phillis. ) En arrivant à
Athènes, il trouva le trône vacant par la mort de
JVlnefthée, qui l’avoit ufurpé à Son préjudice, 6c
s en mit en poffelfion Sans aucune difficulté, comme
étant le légitimé héritier. Il accorda généreusement
fa protection aux Héraclides qu’Eurifthée
perfécutoit, 6c fit même périr leur ennemi. Lorf-
qu Orefte, coupable de parricide, vint à Athènes,
Demophor ne voulut, ni le renvoyer, ni l’admettre
a fa table : il s’avifa de le faire fervir Séparément
; 6c pour juftifier cette efpèce d’affront, il
voulut qu’on fervît à chaque convive une coupe
Particulière , contre l ’ulage.E Voye^ Coupe , thra , Héracéides , Maçarie.
DEMOS, nom d'un des chevaux ou des cochers
de Mars.
DEMOSTHENE. Quoique Démofthene ait été
le plus grand Orateur de Ton Siècle 6c de tous les
âges, quoiqu’il eût une ftatue élevée dans Athènes
( Paufanias, /. i.p . 19. ) ; quoique fes portraits
de bronze 6c de marbre fuffent expofés dans
une infinité d’endroits, nous n’aurions cependant
qu’une idée très-imparfaite de fa phyfîonomie, fi
le? découvertes d’Herculanum ne nous avoient ;
pas fourni deux petits bufiesde bronze de ce grand i
homme. Ces morceaux font d’une proportion plus
foible que lè naturel} le plus petit porte le nom
du célèbre Orateur gravé en grec fur le focle. Ces
deux têtes, qui ont de la barbe , n’ont d’ailleurs
aucune reffemblance avec un bufte fans barbé,
travaillé de grand relief, 6c défîgné par le même
hom } il faut par conséquent que ce dernier morceau
, découvert en Efpagne , 6c publié par Ful-
vius Urfinns , comme portrait de cet Orateur ,
représente quelqu’autre perfonnage.
On pouvoit croire , d’après cela. , que le portrait
de Dtinofiriene ne s’étoit confervé que dans
les deux buftes d’Herculanum, & que les monu->
mens de Rome n’en offroient pas le moindre yef-
tige. Cependant l’on vit pavoitre au commencement
de 1768 une empreinte de plâtre , moulée
fur un petit bas-relief de terre cuite, d’environ
deux palmes de hauteur ( près de feize pouces ).
Ce morceau, dont l’original paroït perdu, offre
la figure de Démofthene dans un âge avancé , avec
une reffemblance parfaite aux deux bulles de
bronze d’Herculanum. L’Orateur eft aflis fur une
pierre cubique , le corps à moitié nud 6c la tête
penchée. Enfeveli dans une réflexion profonde,
il tient dans fa main gauche, qui eft appuyée fur
la pierre, un écrit où rouleau , 6c il pafie la maio
droite autour de fon genou. Son nom eft gravé
fur la pierre de la manière Suivante :
AHMO2 0 ENHZ.
Et au-deffous du nom on lit le mot*:
e n 1 b n m 1 o s .
Mot qui fe trouve rarement chez les anciens «Écrivains
, n’étant employé que pour défigner les cho-
fes placées fur un autel. Dans PoJlux, tniB£2M!ON
m e a o s eft le nom d’un air chanté devant l’autel
( Poil. Onom. I, 4. Segm. 79. ). Cette pierre repréfente
par conféquent un autel, BfîMoz, dans le
temple faoré 6c inviolable de Neptune , de l’ifle
de Calaurée, non loin des rivages de Trézènés ,
où Démofthene avoit été chercher un afylc , lorsqu’il
fe retira d’Athènes pour fe foultraire aux:
persécutions d’Antipater , gouverneur dé Macé-^
doine. Il mourut dans cette ifle à l’âge de Soixante-
deux aîîs , du poifon qu’il portoit ordinairement
enfermé dans le chaton de fa bague, pour ne pas
tomber vivant entre les mains de fes ennemis. Le
Démofthene de cette empreinte, aflis fur nn autel,
eft donc représenté dans le dernier période de Sa
v ie, & réduit à la cruellenécefîité de terminer Sa
carrière. De la forme des lettres de 1 infeription ,
comparées avec celles du nom qui fe lit fur l'un
des deux buftes d’Hercuîanum , il réiulteroit que
la figure de plâtre feroit plus ancienne que le*
têtes de bronze. Winckelmann , qui nous fournit
cet article, fe propofoit de publier {Hift. de L'Art.
liv. 6. ch. 3. D. ) un jour ce bas-relief; mais la
mort l’en a empêché. Au fiècle de Paufanias on
voyoit encore à Calaurée, dans le nîfiQoXa, on
le parvis du temple de Neptune., le tombeau de
Démofthene ( Faufan. I. l . p. 189. /. 3. ).
D A N , o u DEN , ancien Dieu des Germains-.
Cuvier affure ( Germ. Ânt. I. 1. p. 224. ) quc
c’eft le même que T heut, & Ztif, par conséquent j
car comme, Selon lui , de Theut s’eft fait zeh?r
Jupiter ; de même de zélé, s’eft fait A«», Dan; car
on a dit zW , z*V,, 6c en dorique ,. zi.s : de ces
obliques zW*, z s ’eft formé le nominatiJT
Ztyty 6c en dorique z«v > puis le z fe changeant,
comme il arrive fouvent en A , A«v, Dan, qui
étoit le grand Theiit ou le grand Mercure Dan.
& Den , en Scîavon, 6 c , félon une autre prononciation,
dren 8c d^n , fignifie jour, comme aies0
qui vient de 4 )«;, g. ^.itit de
DENARIAIRE ( Numéraire ). Voyez A rith^
m ét iqu e des Romaias.
DENÂJ&US. Voye£ Denier 6z Sëdeciz-s»