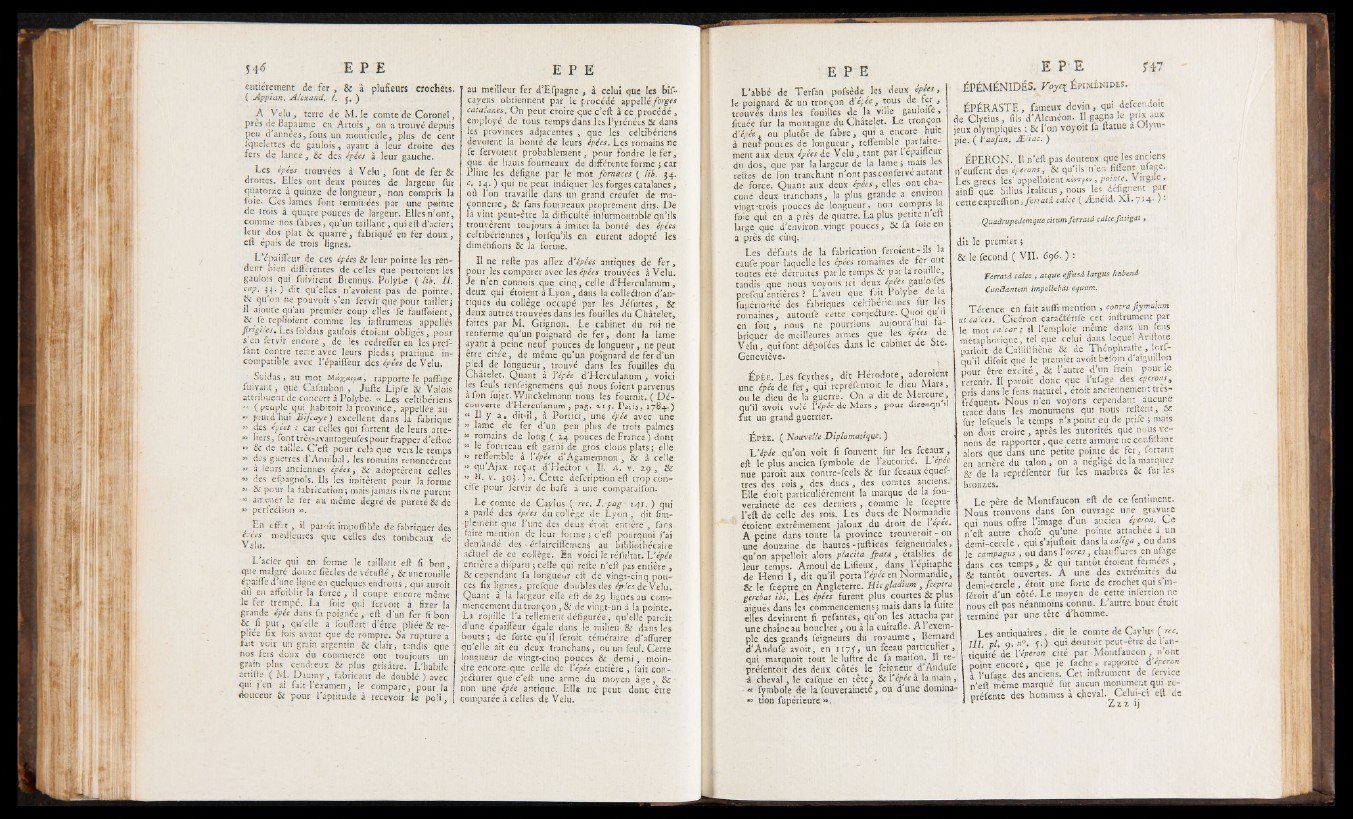
Î4<f E P E
entièrement de fer , 8c a plufîeurs crochets.
,( Appian, A/exand. I. f. )
A V e lu , terre de M. le comte de Coronel,
près de Bapaume en Artois on a trouvé depuis
peu d'années, fous un monticule, plus de cent
fquelettes de gaulois, ayant à leur droite des
fers de lance , & des épées à leur gauche.
Les epe&s trouvées à V e k i , font de fer &
droites. Elles ont deux pouces de largeur fur
quatorze à quinze de longueur, non compris la
foie. Ces lames font terminées par une peinte
de trois à quatre pouces de largeur. Elles n'ont,
comme nos fabres, qu'un taillant, qui eft d'acier;
leur dos plat & quarré, fabriqué en fer doux,
elt épais de trois lignes.
L epaifleur de ces épées & leur pointe les rendent
bien différentes de celles que portoient les
gaulois qui fuivirent Brennus. Polybe ( lib. II.
caP' $$• ) -dit qu'elles n'avoient pas de pointe,
& qu on ne pouvoit Ven fervir que pour tailler;
il ajoute qu’au premier coup elles fe fauffoient,
& fe replioient comme les inllrumens appelles
ftrigiles. Les foldats gaulois étoienit obligés, pour
s en fervir encore, de les redreffer en les.pref-
fant contre terre avec leurs pieds ; pratique incompatible
avec l'épaifTeur des épées de Velu.
Suidas, au mot Mà%ettpet, rapporte le paffage
fuivant, que Cafaubon , Julie Lipfe & Valois
attribuent de concert à Polybe. « Les celtibériens
33 (peuple qui habitoit la province, appellée au-
*3 jour.d’hui Bifcaye) excellent dans la fabrique
93 des épées : car celles qui fortent de leurs atte-
03 tiers, font très-avahtageufes pour frapper d'eftoc
93 & de taille. C'eft pour cela que vers Je temps
3» des guerres d'Ann:bal, les romains renoncèrent :
” à leurs anciennes épées, & adoptèrent celles
des efpagnols. Ils les imitèrent pour la forme
33 & pour la fabrication; mais jamais ils ne purent
33 amener le fer au même degré de pureté & de
33 perfection ».
En e ffet, il paroît impoffible de fabriquer des
bé es meilleures que celles des tombeaux de
Velu.
L'acier qui en. forme le taillant eft fi b on,
que malgré douze fiècles de vétufté, & une rouille
éçaiffe d'une ligne en quelques endroits , qui auroit
du en affaiblir la fo rc e , il coupe encore même
le fer trempé. La foie qui fervojt à fixer la
grande épée dans fa poignée, eft d'urt fer fi bon
& fi pur, qu'elle a fouffert d'être pliée & repliée
fix fois avant que de rompre. Sa rupture a
fait voir un grain argentin & clair, tandis que •
nos fers doux du commerce ont toujours un
grain plus cendreux & plus grisâtre. L'habile?
artifts ( M. Daumy, fabricant de doublé ) avec
qui j'en ai fait l'examen, le compare, pour la
douceur & pour l ’aptitude à recevoir le p oli, |
E P E
au meilleur fer d’Efpagne * à celui que les bîf-
cayens obtiennent par le procédé appellé forges
catalanes. On peut croire que c'eft à ce procédé,
employé de tous temps-dans les Pyrénées & dans
les provinces adjacentes , que les celtibériens
dévoient la bonté de leurs épées. Les romains ne
fe fervoient probablement, pour fondre le fe r ,
que de hauts fourneaux de différente forme ; car
Pline les défigne par le mot fomaces ( lib. 34.
^ 14. ) qui ne peut indiquer les forges catalanes,
où l'on travaille dans un grand creufet de maçonnerie,
& fans fourneaux proprement dits. De
là vint peut-être la difficulté infurmontable qu'ils
trouvèrent toujours, à imiter la bonté des épées
celtibériennes, lorfqu'ils en eurent adopté les
dimëhfions & la forme.
Il ne refte pas aftez d'épées antiques de fe r ,
pour les comparer avec les épées trouvées à Velu.
Je n'en connois que cinq, celle d'Herculanum,
deux qui étoient à Lyon, dans la collection d'antiques
du collège occupé par les Jéfuites, &
deux autres trouvées dans les fouilles du Châtelet,
faites par M. Grignon. Le cabinet du roi ne
renferme qu'un poignard de fe r , dont la lame
ayant à peine neuf pouces de longueur, ne peut
erre citée, de même qu'un poignard de fer d'un
pied de longueur, trouvé dans les fouilles du
Châtelet. Quant à Yépée d'Herculanum, voici
les fouis renfeignemens qui nous foient parvenus
à fon fujet.Winckelmann nous les fournit. ( Dé couverte
d'Herculanum, pag. 115. Paris, 1784.)
ec II y a , dit-il, à -Portici, une épée avec une
» lame de fer d'un peu plus de trois palmes
*> romains de long ( 24 pouces de France) dont
33 le fourreau eft garni de gros clous plats; elle
» reffemble à Yépée d'Agamemnon, & à celle
qu'Ajax reçut d'Heétor ( II. A'. v. 29 , &
” H. v. 303. )». Cette deferiptioneft trop con-
cife pour fervir de bafe à une comparaifon.
Le comte de Caylus {; rec. I .-p a g • 24;. ) qui
a parlé des épées du collège de Lyon , dit fim-
-piement que l'une des deux étoit entière , fans
faire mention dé leur forme ; c'eft pourquoi j'ai
demandé des ' éclairciflèmens au bibliothécaire
aCtuel de ce collège. En voici le réfultat. L ’ épée
entière a difparu ; celle qui refte n'eft pas entière ,
& cependant Ta longueur eft de vingt-cinq pouces
fix lignes, prefque doubles des épées de Velu.
Quant à la largeur elle eft de 29 lignés au commencement
du tronçon , & de vingt-un à la pointe.
Là rojiille l'a tellement défigurée, qu'elle paroît
d'une épaiffeur égale dans le milieu & dans les
bouts ; de forte qu'il feroit téméraire d'affurer
qu'elle ait eu deux tranchans, ou un feul. Cette
longueur de vingt-cinq pouces & demi, moindre
encore^que celle de Yépée entière , fait conjecturer
que c'eft une arme du moyen âg e , &
non une épée antique. Eli* ne peut donc être
comparée à celles de Velu.
E P E
L ’ abbé de Terfan pofsètfo les deux epées,
le poignard & un tronçon d'épée, tous de rer ,
trouves dans les fouilles de la ville gauloife,
fituée fur la montagne du Châtelet. Le tronçon
d ’épée, ou plutôt de fabre, qui a encore nuit
à neuf pouces de longueur, reffemble parfaitement
aux deux épées de V e lu , tant par 1 epaifleur
du dos, que par la largeur de la lame; mais les
reftes de fon tranchant n'ont pas conferve autant
de force. Quant aux deux épées, elles ont chacune
deux tranchans, la plus grande a environ
vingt-trois pouces de longueur, non compris la
foie qui en a près de quatre. La plus petite n eft
large que d'environ.vingt pouces, & fa foie en
a près de cinq.
Les défauts de la fabrication feroient-ils la
caufepour laquelle les épées romaines de fer ont
toutes été détruites par le temps & par la rouille,
tandis que nous voyons ici deux épées gau.oifes
prefqu'entières ? L'aveu que hit Polybe de là
fupériorité dés fabriques celtiberiennes fur les
romaines, autorife cette conjeClure. Quoi qu il
en foit , nous ne pourrions aujourd hui-ra-
briquèr de meilleures armes que les épees de
V e lu , qui font dépofées dans le cabinet de bte.
Geneviève. .
É pée. Les feythes, dit Hérodote, adoroierit
une épée de fer, qui reprefentoit le dieu Mars,
ou le dieu de la guerre. On a dit de Mercure ,
qu'il avoit volé Yépée de M ars , . pour dire®quil
fut un grand guerrier.
ÉpÉE. ( Nouvelle Diplomatique.')
U épée qu'on voit fi fouvent fur les fceaux,
eft le plus ancien fymbole de l'autorité. L epee
nue paroît aux contre-fcels & fur fceaux equef-
tres des rois, des ducs, des comtes anciens/
Elle étoit particuliérement la marque de la fou- ,
veraineté de ces derniers, comme le feeptre
l'eft de celle des rois. Les ducs de Normandie
étoient extrêmement jaloux du droit de \ epee. A peine dans toute la province trouveroit - on
une douzaine de hautes-juftices feigneuriales,
qu'on appelloit alors placita fp a t s , établies de
leur temps. Arnoul de Lifieux, dans l'épitaphe
de Henri I , dit qu'il porta Yépée en Normandie,
& le feeptre, en Angleterre. H ic gladium, feeptra
gerebat ibi. Lès épées furent plus courtes & plus
aiguës dans les commencemens; mais dans la fuite
elles devinrent fi pefantes, qu'on les attacha par
une chaîne au bouclier, ou à la cuirafle. A 1 exemple
des grands feigneurs du royaume, Bernard
d'Andufe avoit, en 117 5 , un fceau particulier ,
qui marquoit tout le luftre de fa maifon. Il re-:
préfentoit des deux côtés le feigneur d Andufe^
à cheval, le cafque en tête, & Yépée à la main,
«« fymbole de la fouveraineté, ou d’une domina-
« tion fupérieure »j
E P E *47
ÉPÉMÉNIDÉS, Voyet ÉPIMÉNIDES.
É P É R A S T E , fameux devin , qui defeendoit
de Clytius , fils d’Alcméon. Il gagna le prix aux
jeux olympiques : & l'on voyoit fa ltatue a Ulym-
pie. ( Yaujan. Æciac. )
ÉPERON. Il n’eft pas douteux que les anciens
n'euflent des éperons, & qu'ils n’en fiffent ufage.
Les grecs les- appelloient ȏyrpov, pointe. Virgile,
ainfi que Silius Italicus, nous les deljgnent par
cette expreffion, c a l c e ( Æneid- XI. 714- ) •
Quadrupedemque citumferratâ calce fatigat,
dit le premier ;
& le fécond ( VII. 696. ) ;
Ferratâ calce, atque effusâ largüs heibeni
Cundantem impcllebat equum.
Térence en fait auffi mention , contra ftymulum
ut calccs. Cice'ron caraétérife cet inftrument par
le mot ca ka r ; il l’emploie même dans un fens
métaphorique j tel que celui dans lequel Ariftote
parloir de Callifthène & de Théophraftê , lorf-
qu'il difoit que le premier ayoit befoin d'aiguillon
pour être excité 3 & l’autre d un frein pour le
retenir. II paroît donc que l’uûge des éperons,
pris dans le feus naturel, étoit anciennement tres-
fréquent. Nous n'en voyons cependant aucune
trace dans les monumens qui nous relient, Se
fur lefquels le temps n'a point eu de prife ; mais
on doit croire , après les autorités que nous venons
de rapporter, que cette armure ne conullant
alors que dans une petite pointe de fer, fortant
en arrière du talon , on a négligé de la marquer
& de la repréfenter fur les marbres & fur les
bronzes.
Le père de Montfaucon eft de ce fentiment.
Nous trouvons dans fon ouvrage une gravure
qui nous offre l’image d'un ancien éperon. C e
n’ell autre chofe qu’une pointe attachée à un
demi-cercle , qui s’ajulloit dans la caliga , ou dans
le campagus , ou dans Vocrea, chauffures en ufage
dans ces temps, & qui tantôt étoient ^fermées,
& tantôt ouvertes. A une des extrémités du
demi-cercle , étoit une forte de crochet qui s’in-
féroit d'un côté. Le moyen de cette infertion ne
nous ell pas néanmoins connu. L ’autre bout étoit
terminé pat une tete d homme.
Les antiquaires, dit le comte de Caylus ( rec.
JXI. pl, y. n°. 5. ) qui doutoit peut-être de l’antiquité
de l’éperon cité par Montfaucon ^ n’ont
point encore, que je fâche, rapporté d‘ éperon
à l’ ufage des anciens. Cet inftrument de fetvice
n’ eft même marqué fur aucun monument qui re-
oréfente des hommes à cheval. Celui-ci eft de
‘ 7. T 7. ii