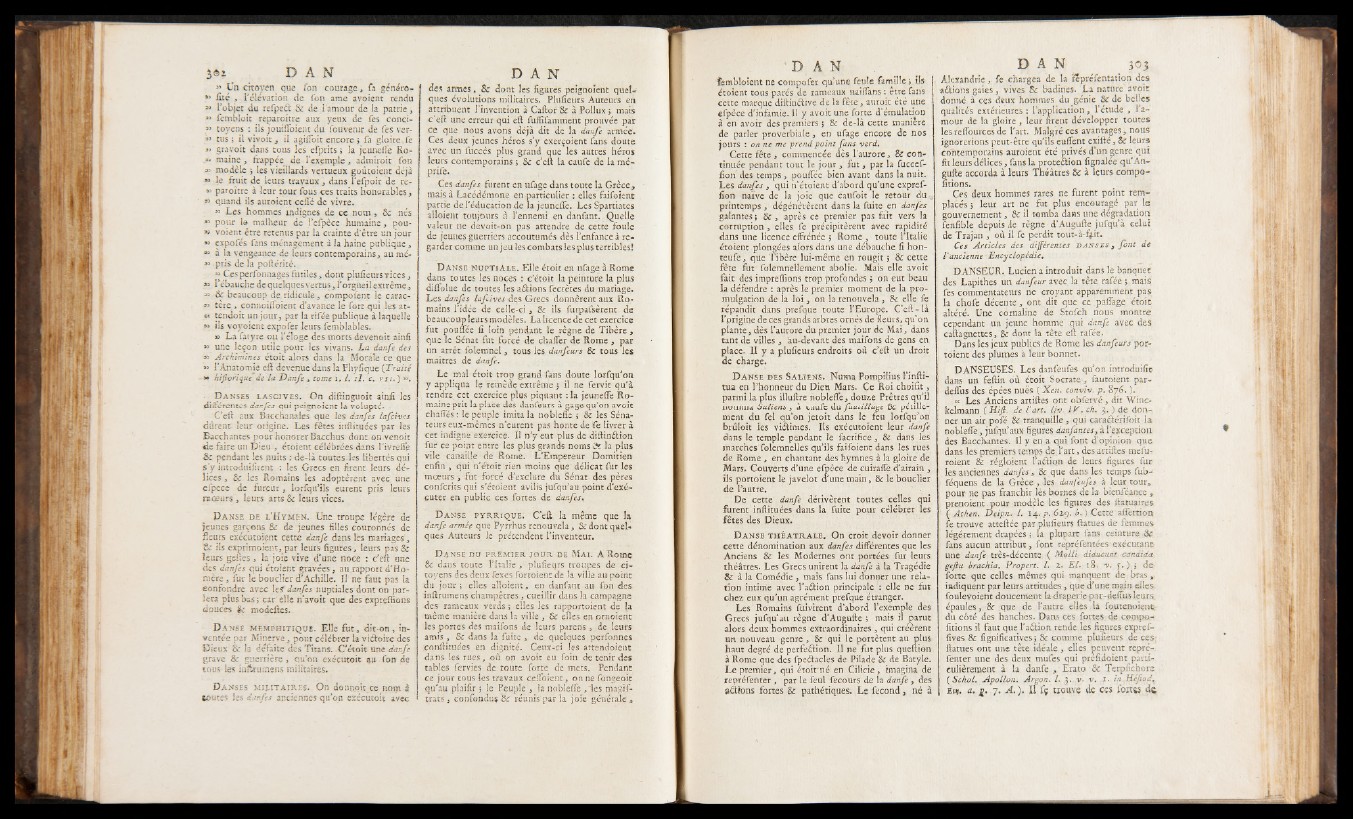
» Un citoyen que fon courage, fa gcnéro-
33 fité 3 l’élévation de ion ame avoient rendu
33 l’objet du refpeél & de l ’amour de la patrie ,
33 fembloit reparoître aux yeux de fes conçi-
33 toyens : ils jou-iüoient du fouvenir de fes ver-
33 tus ; il vivo it, il agiffoit encore ; fa gloire , fe
w gravoit dans tous les efprits ; la jeuneife Ro-
33 maine, frappée de l’exemple, admiroit fon
33 modèle j les vieillards vertueux goûtoient déjà
83 le fruit de leurs travaux, dans l’efpoir de re-
33 paroître à leur tour fous ces traits honorables,
» quand ils auroient ce (Té de vivre.
33 Les hommes indignes de ce nom, & nés
33 pour le malheur de l’efpèce humaine , pou-
a? voient être retenus par la crainte d’être un jour
33 cxpofés fans ménagement à la haine publique ,
M à la vengeance de leurs contemporains, au mé-
»» pris de la poftérité.
33 Cesperfonnages futiles, dont plufieurs vices,
** l’ébauche de quelques vertus, l’orgueil extrême,
33 & beaucoup de ridicule, compofent le carac-
J3 tè re , connoiifoient d’avance le fort qui les at-
« tendoit un jour, par la rifée publique à laquelle
M ils voyoient expofer leurs femblables.
» La fatyre ou l’éloge des morts devenoit ainfi
» une leçon utile pour les vivans. La danfe des
» Archimines étoit alors dans la Morale ce que
33 l’Anatomie eft devenue dans la Phyfique (Traité
30 hifiorîque de la Danfe » tome i , l. il. c .v n . ) ».
D an s e s l a s c iv e s . On diftinguoit ainii les
différentes dar.fes qui peignoient la volupté. .
C’eft aux Bacchanales que les danfes lafiives
durent leur origine. Les fêtes iuftituées par les
Bacchantes pour honorer Bacchus dont on venoit
de faire un Dieu , étoient célébrées dans Tivreffe
•& pendant les nuits : de-là toutes-ks libertés qui
s ’y introduifirent : les Grecs en firent leurs dé*-
lices , 8£ les Romains les adoptèrent avec une
efpece de fureur, lorfqu’ils eurent pris leurs
moeurs , leurs arts & leurs vices.
D a n s e de l ’H ym e n . Une troupe légère de
jeunes garçons & de jeunes filles couronnés de
fleurs exécutoient cette danfe dans les mariages,
t e ils exprimoient, par leurs figures, leurs pas 8c
leurs geftes, la joie vive d’ une noce : c’eft une
des danfes qui étoient gravées, au rapport d’Homère
, fur le bouclier d’Achille. Il ne faut pas la
confondre avec les' danfes nuptiales dont on parlera
plus bas; car elle n’ avoir que des expreffions
douces êc modeftes.
D a n s e m em ph it iq u e . Elle fu t, dit-on, inventée
par Minerve, pour célébrer la viéfcoire des
Dieux 8c la défaite des Titans. -C’étoit une danfe
grave 8c guerrière , qu’on exéçutoit au fon de
tous les inftrumens militaires.
Danses militaires. On donpoit ce nom a
toutes les danfes anciennes qu’on exéçutoit avec
des armes, & dont les figures peignoient quelques
évolutions militaires. Plufieurs Auteurs en
attribuent l’invention à Caftof & à Pollux ; mais
c ’eft une erreur qui eft fuffifamment prouvée par
ce que nous avons déjà dit de la danfe armée.
Ces deux jeunes héros s’y exerçoient fans doute
avec un fuccès plus grand que les autres héros
leurs contemporains ; & c’eft la caufe de la mé-
prife.
Ces danfes furent en ufage dans toute la Grèce ,
mais à Lacédémone en particulier : elles faifoient
partie de l’éducation de la jeuneife. Les Spartiates
ailoient toujours à l’ennemi en danfant. Quelle
valeur ne devoit-on pas attendre de cette foule
de jeunes guerriers accoutumés dès l’enfance à regarder
comme un jeu les combats les plus terribles!
Danse nuptiale. Elle étoit en ufage à Rome
dans toutes les noces : c'étoit la peinture la plus
dilfolue de toutes les a étions fecrètes du mariage.
Les danfes lafeives des Grecs donnèrent aux Romains
l’idée de celle-ci, 8c ils furpafsèrent de
beaucoup leurs modèles. La licence de cet exercice
fut pounée fi loin pendant le règne de Tibère ,
que le Sénat fut forcé de chalfer de Rome , par
un arrêt foiemnel, tous les danfeurs & tous les
maîtres de danfe.
Le mal étoit trop grand fans doute lorfqu’on
y appliqua le remède extrême ; il ne fervit qu’à
rendre^cet exercice plus piquant : 1a jeuneffe Romaine
prit la place des danfeurs à gage, qu’on avoit
chaffés : le peuple imita la nobleffe ; Sc les Sénateurs
eux-mêmes n’eurènt pas honte de fe livrer à
cet indigne exercice. Il n’y eut plus de diftinélion
fur ce point entre les plus grands noms & la plus
vile canaille de Rome. L’Empereur Domitien
enfin , qui n’étoit rien moins que délicat furies
moeurs ; fut forcé d’exclure du Sénat des pères
confcrits qui s’étoîent avilis jufqu’au point d’exécuter
en public ces fortes de danfes%
Danse pyrrique. C’eft la même que la
danfe armée que Pyrrhus renouvela, & dont quelques
Auteurs le prétendent l’inventeur.
D ^ nse du premier jour de Ma i . A Rome
8c dans toute l’ Italie , plufieqrs troupes de citoyens
des deux fexes fortoient de la ville au point
du jour; elles ailoient, en danfant au fon des
inftrumens champêtres , cueillir dans la campagne
des rameaux verds ; elles les rapportoient de |a
même manière dans la ville , & elles en prnoient
les portes des maîfons de leurs parens , de leurs
amis , & dans la fuite , de quelques perfonnçs
çonftituées en dignité. Ceux-ci les attendoient
dans les rues, où on avoir eu foin de tenir des
tables fervies de route forte de mets. Pendant
ce jour tous les travaux ceffoient, on ne fongeoît
qu’au plaifir ; le Peuple , la nobleffe ,ie s magif-
trats, confondu? 8r réunis par la joie générale.
D A N
fembloîent ne compofer qu’une feule famille ; ils
étoient tous parés de rameaux naiffans : être fans
cette marque diftinétive de la fête, auroit été une
efpece d’infamie. Il y avoit une forte d’émulation
à en avoir des premiers ; 8c de-là cette manière
de parler proverbiale, en ufage encore de nos
jours : on ne me prend point fans verd.
Cette fête , commencée dès l'aurore, & continuée
pendant tout le jour , fu t , par la fuccef-
fion des temps, pouffée bien avant dans la nuit.
Les danfes, qui n’étoient d’abord qu’une expref-
fion naïve de la joie que califoit le retour du.„
printemps , dégénérèrent dans la fuite en danfes
galantes ; 8c, après ce premier pas fait vers la
corruption, elles fe précipitèrent avec rapidité
dans une licence effrénée ; Rome , toute l’Italie
étoient plongées alors dans une débauche fi hon-
teufe, que Tibère lui-même en rougit ; & cette
fête fut folemnellement abolie. Mais elle avoit
fait des impreflions trop profondes ; on eut beau
la défendre : après le premier moment de la promulgation
de la lo i , on la renouvela , 8c elle fe
répandit dans prefque toute l’Europe. C’eft-là
l’prigine de ces grands arbres ornés de fleurs, qu’on
plante, dès l’aurore du premier jour de Mai, dans
tant de villes , au-devant des maifons de gens en
place. II y a plufieurs endroits ou c’eft un droit
de charge.
Danse des Salïens. Numa Pompilius Pinfti-
tua en l’honneur du Dieu Mars. Ce Roi choifit,
parmi la plus illuftre nobleffe, douze Prêtres qu’il
nomma Saliens, à caufe du fautillage 8c pétillement
du fel qu’on jetoit dans le feu lorfqu’on
brûloit les viérimes. Ils exécutoient leur danfe
dans le temple pendant le facrifice, 8c dans les
marches folemnelles qu’ils faifoient dans les rues
de Rome , en chantant des hymnes à la gloire de
Mars. Couverts d’une efpece de cuiraffe d’airain ,
ils portoient le javelot a une main, & le bouclier
de l’autre.
De cette danfe dérivèrent toutes celles qui
furent inftituées dans la fuite pour célébrer les
fêtes des Dieux.
Danse théâtrale. On croit devoir donner
cette dénomination aux danfes différentes que les
Anciens 8c les Modernes ont portées fur leurs
théâtres. Les Grecs unirent la danfe à la Tragédie
& à la Comédie , mais fans lui donner une relation
intime avec l’a&ion principale : elle ne fut
chez eux qu’un agrément prefque étranger.
Les Romains fuivirent d’abord l’exemple des
Grecs jufqu’au règne d’Augufte ; mais il parut
alors deux hommes extraordinaires, qui créèrent
un nouveau genre, Sc qui le portètent au plus
haut degré de perfe&ion. Il ne fut plus queftion
à Rome que des fpeétacles de Pilade 8c de Batyle.
Le premier, qui étoirné en Cilicte, imagina de
repréfenter , par le feul fecours de la danfe , des
itérions fortes 8c pathétiques. Le fécond, né à
D A N 303
Alexandrie, fe chargea de la ïeptéfentation des
aérions gaies, vives Sc badines. La nature avoir
donné à ces deux hommes du génie & de belles
qualités extérieures : l’application, l’étude , l’amour
de la gloire , leur firent développer toutes
les reffources de l’art. Malgré ces avantages, nous
ignorerions peut-être qu’ ils euffent exifté, 8c leurs
contemporains auroient été privés d’un genre qui
fit leurs délices, fans la proteérion fignalée qu’An-
gufte accorda à leurs Théâtres 8c à leurs comportions.
Ces deux hommes rares ne furent point remplacés
; leur art ne fut plus encouragé par le
gouvernement, 8c il tomba dans une dégradation
fenfible depuis /le règne d’Augufte jufqu’ à celui
de Trajan , où il fe perdit tout-à-f$it.
Ces Articles des différentes danses , font de
Vancienne Encyclopédie,
DANSEUR. Lucien a introduit dans le banquet
des Lapithes un danfeur avec, la tête rafée > mais
fes commentateurs ne croyant apparemment pas
la chofe décente;, ont dit que ce paffage étoit
altéré. Une cornaline de Stofch nous montre
cependant un jeune homme qui danfe avec des
caftagnettes, 8c dont la tête eft rafée.
Dans les jeux publics de Rome les danfeurs por-
• toient des plumes à leur bonnet.
DANSEUSES. Les danfeufes qu’on introduifîe
dans un feftin où étoit Socrate , fautoient par-
deffus des épées nuës ( Xen. conviv. p. 876. ).
cc Les Anciens artiftes ont obfervé, dit Winc-
kelmann ( Hiß. de l'art, liy. I V . ch. 3,. ) de don-,
ner un air pofé 8c tranquille , qui çaraéiérifoit la
nobleffe , jufqu’aux figures danfantes, à l’exception
des Bacchantes. Il y en a qui font d’opinion que
dans les premiers temps de.l’ art, des artiftes mefu-
roient 8c régloient l’aétion de leurs figures fur
les anciennes danfes, 8c que dans les temps fub-
féquens de la Grèce , les danfeufes à leur tour,
pour ne pas franchir lès bornes de la- bienféance ,
prenoient - pour modèle les figures des ftatuaires
{Athen. Deipn, l. 14. p. 62.9: 6.) Cette affertion
fe trouve atteftée par plufieurs ftatues de femmes
légèrement drapéës ; la plupart fans ceinture 8c
fans aucun attribut, font rëpréfentées exécutant-
une danfe très-décente ( Molli diducunt candida.
gefiu brachia. Propert. I. 2. El. 18. v. ƒ. ) ; de
forte que celles mêmes qui manquent de bras,
indiquent par leurs attitudes , que d’une main elles
foulevoient doucement la draperie par-deffus leurs,
épaules, 8c que de l’autre elles. la fputenoienC;
du côté des hanches. Dans ces fortes de corn polirions
il faut que l’a&ion rende les figures exprçf-
fives 8c fignificatives; 8c comme plufieurs de ces;
ftatues ont une tête idéale, elles peuvent repréfenter
une des deux mufes qui préfidoient particulièrement
à la. danfe , Erato -8c Terpfichore
{Sckol. Apollon. Argon. I. 3. v- v. J. in.Héfod.
Eva. a. g. 7. A. ). Il fç trouve de ces fortes ds.