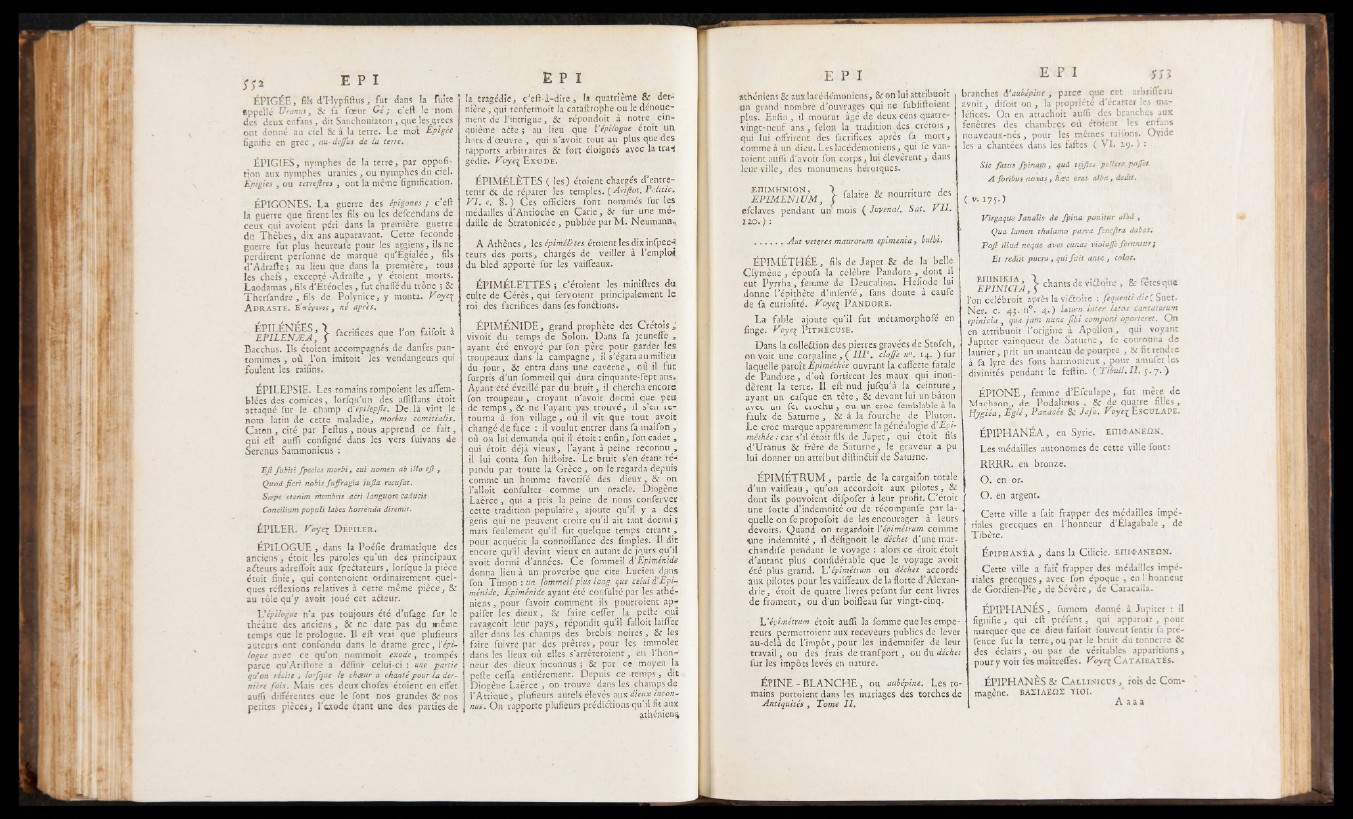
y?a E P I
ÉPIG ÉE , fils d’Hypfiftus y fut dans la fuite
fippellé Uranus, & fa foeur G é ; c'eft le ' nom
des deux enfans, dit Sanchoniaton ,,que les.grecs
ont donné au ciel & à la terre. Le mot Epigée
fignifie en g re c , au-dejfus de la terre.
ÉPIG1E S , nymphes de la terres par oppofi-
tîon aux nymphes uranies , ou nymphes du ciel.
Épigies 3 ou terrejîres y ont la meme lignification.
ÉPIGONES. La guerre des épigones ; c’ eft
la guerre que firent les fils ou les defeendans de
ceux qui avoient péri dans la première guerre
de Thèbes, dix ans auparavant. Cette fécondé
guerre fut plus heureufe pour les a rg ip s , ils ne
perdirent perfonne de marque qu’Egialée, fils
d’Adraftej au lieu que dans la première, tous
les chefs , excepté -Adrafte , y étoient morts.
Laodamas , fils d’Étéocles , fut chafle du trône > &
Therfandre, fils de Polynice, y monta. Voyei
A d r ASTE. E'-nl-yovoç 3 né apres.
^ P I ^ I OE A 3 5" facrifices que Ton faifoit à
Bacchus. Ils étoient accompagnés de danfes pantomimes
, où l’on imitoit les vendangeurs qui
foulent les raifins.
ÉPILEPSIE. Les romains rompoient les afîem-
felées des comices, lorfqii’ un des affiftans étoit
attaqué fur le champ à'épilepfie. D e .là vint le
nom latin de cette maladie, morhus comitialis.
C a ton , cité par Feftus, nous apprend ce. fait,
qui eft auflî configné dans les vers fuivans de
Serenus Sammoniçus ;
jEjl fdbiti fpecies morbi, cul notnen àb illo e jl,
Quod fieri nobis fuffragia jujla reeufat.
Sape etenim rftembrïs acrï languore cadücis
Concïlium populï lobes horrendu diremit,
ÉPILER. V'oyei D épiler,
É P ILO G U E , dans la Poéfie dramatique des
anciens, étoit les paroles qu’ un des principaux
a «fleurs adrelfoit aux fpeélateurs, lorfque la pièce
étoit finie, qui contenoient ordinairement quelques
réflexions relatives à cette même pièce, &
au rôle qu’y avoit joué cet adieu r.
\Jépilogue n’ a pas toujours été d’ ufage fur le
théâtre des anciens, & ne date pas du même
temps que le prologue. Il eft vrai que plufieurs
auteurs ont confondu dans le drame grec, Vépilogue
avec ce qu’on nommoit exode 3 trompés
parce qu’Ariftote a défini* celui-ci : une partie
quon récite , lorfque le choeur a chanté pour la dernière
fo is . Mais ces deux chofes étoient en effet
auffi différentes que le font nos grandes & nos
petites pièces, l’exode étant une des parties de
E P I
la tragédie, c’eft-à-d nière , qui renfermoit lai rcea, talfat roqpuhaetr ioèum lee d&én odueerqmueinèmt
dee ald’ilne trj igauue , li&eu rqépuoe ndoit à notre cinépilogue
etoit un
hra upsp-odr’toes uavrbreit r,a irqeusi &n’ avfooritt étolouitg naéus palvuesc q luae tdrae^s gédie. Voye[ Exode.
ÉPIMÉLÈTES ( les) étoient chargés d’entretenir
&, de réparer les temples. ( Arijlot. Politic.
V I . c. 8 .) Ces officiers font nommés fur les
médailles d’Antioche en Carie, & fur une médaille
de Stratonicée, publiée par M. Neumann.*
A Athènes, les épimélètes étoient les dix infpec-L
teurs des ports, chargés de veiller à l’emploi
du bled apporté fur les vaiffeaux.
ÉPIMÉLETTES j c’étoient les miniftres du
culte de Cérès, qui fervoient principalement le
roi des facrifices dans fes fondions.
É P IM ÉN ID E , grand prophète des Cretois 3
vivait du temps de Solon. Dans fa jeuneffe ,
ayant été envoyé par fon père pour garder les
troupeaux dans la campagne, il s’égara au milieu
du jour, & entra dans une caverne, où il fut
furpris d’un fommeil qui dura cinquante-fept ans.
Ayant été éveillé par du bruit, il chercha encore
fon troupeau, croyant n’avoir dormi que peu
de temps, & ne l’ayant pas trouvé, il s’en retourna
à fon village, où il vit que tout avoit
changé de face : il voulut entrer dans fa maifon ,
où on lui demanda qui il étoit : enfin, fon cadet,
qui étoit déjà vieux, l’ayant à peine reconnu. ,
j il lui conta fon hiftoire. Le bruit s’en étant ré«-
pandu par toute la G rèce, on le regarda depuis
comme un homme favorifé des dieux, & on
l’alloit confulter comme un oracle. Diogène
' Laërce, qui a pris la peine de nous conferver
cette tradition populaire, ajoute qu’il y a des
'gens qui ne peuvent croire qu’il ait tant dormi 5)
mais feulement qu’il fut quelque temps errant,
pour acquérir la connoiffance des Amples. Il dit
encore qu’il devint vieux en autant de jours qu’il
avoit dormi d’années. C e fommeil d'Epiménide
donna lieu à un proverbe que cite Lucien d,ans
fon Timon : un fommeil plus long que celui à'Epi-
ménide. Épiménide ayant été confulté par les athéniens,
pour favoir comment ils pourraient ap-
paifer les dieux, & faire ceffer la pefte qui
ravageoit leur pays, répondit qu’il falloit biffer
aller dans, les champs des brebis noires , & les
faire fuivre par des prêtres, pour les immoler
dans les lieux où elles s'arrêteraient, en l’hon-'
neur des dieux inconnus j & par ce moyen la
pelle ceffa entièrement. Depuis ce-temps, dit
Diogène Laërce , on trouve dans les champs de
l’Attique, plufieurs autels élevés aux dieux inconnu
». On rapporte plufieurs prédictions qu’il fit aux
athénien^
EPI EPI ssi
athéniens & aux lacédémoniens, & on lui attribuoit
un grand nombre d’ouvrages qui ne fubfiftoient
plus. Enfin, il mourut âgé de deux cens quatre-
vingt-neuf ans, félon la tradition des cretois,
qui lui offrirent des facrifices après fa mort,
comme à un dieu. Les lacédémoniens, qui fe van- 1
soient auffi d’avoir fon corps, lui élevèrent, dans
leur ville, des monume.ns héroïques.
EITIMHNION, J r Joe
E P IM E N 1V M , ƒ falaire & nourr,tlue dCS i
efclaves pendant un' mois ( Juvenal. Sat. V I I .
l iO t f : -
............Aut veteres maurorum epimenia, bulbi.
, É P IM É TH É E , fils de Japet & de la belle
Clÿmène, époufa la célèbre Pandore , dont il
eut Pyrrha, femme de Deucalion. Héfiode lui
donne l’épithète d’infenfé, fans doute à caufe
de fa curiofité. Voyeç P a n d o r e .
La fable ajoute qu’ il fut métamorphofé en
finge. Voyei P ithécxjse.
Dans la colle&ion des pierres gravées de Stofch,
on voit une cornaline , ( I I I e. clajfe 14. ) fur
laquelle paraît Epiméthèe ouvrant la caffètte fatale
de Pandore, d’où fortirent les maux qui inondèrent
la terre. Il eft nud jufqu’ à la ceinture,
ayant un cafque en tê te , & devant lui un bâton
avec un fer crochu, ou un croc femblable à la
faulx de Saturne , & à la fourche^ de Plutpn.
Le croc marque apparemment la généalogie d'Epi-
méchée : car s’ il étoit fils de Japet, qui étoit fils
d’Uranus & frère de Saturne, le graveur a pu
lui donner un attribut difiinétif de Saturne.
É P IM É T R UM , partie^ de la cargaifon totale
d’un vaifleau, qu’on accordoit aux pilotes, &
dont ils pouvoient difpofer à leur profit. C ’ étoic
une forte d’ indemnité oir de récompenfe par la- ,
quelle on fe propofoit de les encourager à leurs
devoirs. Quand on regardoit l’ épimétrum comme ;
vne indemnité , il défignoit le déchet d’une mar-
chandife pendant le voyage : alors ce droit étoit
d’autant plus confidérable que le voyage avait
été plus grand. L'épimétrum ou déchet accordé
aux pilotes pour les vaiffeaux de la flotte d’Alexandrie,
étoit de quatre livres pefant fur cent livres
de froment, ou d’un boiffeau fur vingt-cinq.
U épimétrum étoit auffi la fomme que les empereurs
permettoient aux receveurs publics de lever
au-delà de l’impôt, pour les indemnifer de leur
travail, ou des frais de tranfport, ou du déchet
fur les impôts levés en nature.
ÉPINE - B L A N C H E , ou aubépine. Les romains
portoient dans les mariages des torches de
Antiquités , Tome I I .
branches d’aubépine, parce que cet arbriffeau
avoit, difoit on , la propriété d ecarter les maléfices.
On en attachoit auffi des branches aux
fenêtres des chambres ou étoient les enfans
nouveaux-nés, pour les mêmes raifons. Ovide
les a chantées dans les faftes ( V I . 2.9. ) • •
S i c fa tu s f p in a m , quâ tr ifles p e île r e p o j je t
A fo r ïb u s n o x a s , h a c erat a lb a , d éd it.
(,v. I 7 I - )
V irg aq u e J a n a lis d e fpin a. p p n itu r albâ ,
1 Q u a lum en th a lam o p a rv a f en e jlr a dab a ti
T o f t illu d n eque aves cunas vio la jfe fe r u n tu r ;
E t rediit p u c ro , q u i f u i t a n te , color .
chants devicïqîrc , & fêtes que
l’on célébroit après la viéloire : fequenti dieC Suer.
Ner. c. 43. n°. 4 .) Utum inter Utos cantaturum
epinicia 5 qua jam nunc fibi comporté oporteret. On
en attribuoit l’origine à Apollon, qui voyant
Jupiter vainqueur de Saturne, fe couronna de
laurier, prit un manteau de. pourpre , & fit rendre
à fa lyre des fons harmonieux, pour amufer les
divinités pendant le feilin. ( T i lu ll .I I . y. 7 . )
É P IO N E , femme d’Efculape, fut mère de
Machaon,, de Podalirius , & de quatre filles,
Hygiéa, Églé s Panacée & Jafo. Voye^ ESCULAPE.
É P IPH AN É A , en Syrie. EmoANEiîN.
Les médailles autonomes de cette ville font:
RRRR. en bronze.
O. en or.
O . en argent.
Cette ville a fait frapper des médailles impériales
grecques en l’honneur d’Elagabale, de
Tibère.
Épiphan éa , dans la Cilicie. EmoANEflN.
Cette ville a fait frapper des médailles impériales
grecques, avec fon e'poque , en T honneur
de Gordien-Pie, de Sévère, de Caracalla.
É P IPH AN É S , furnom donné à Jupiter : il
fignifie, qui eft préfent, qui apparoir pour
marquer que ce dieu faifoit fouvent fentir fa pré-
fence fur la terre, ou par le bruit du tonnerre &
des éclairs, ou par de véritables apparitions,
pour y voir fes maîtrefles. Voye% C a t a ib a t é s .
ÉPIPHANÉS & C allinicus , rois de Cornmaeène.
BAEIAEÛS YIOI.
A a a a