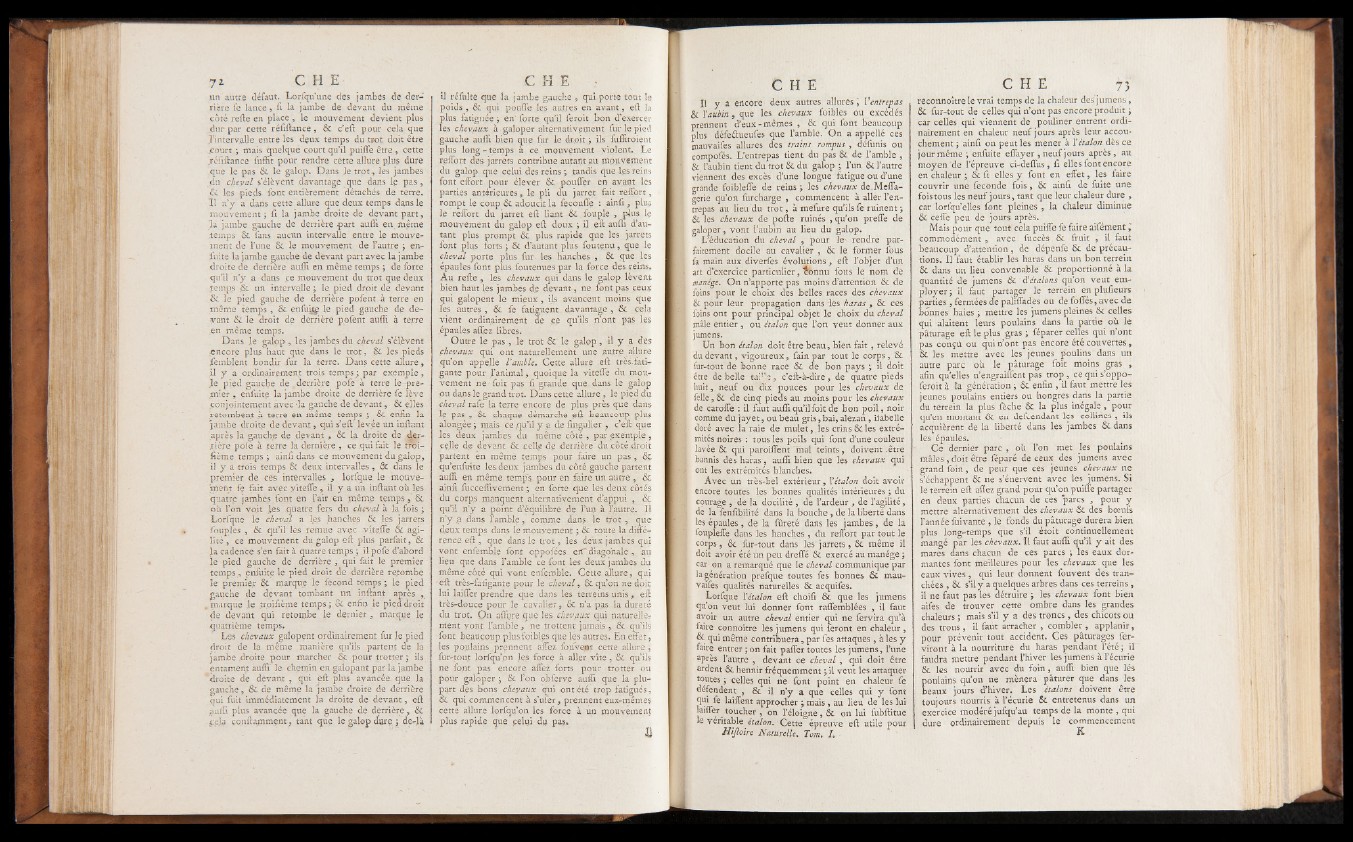
,un autre défaut. Lorfqu’une des jambes de derrière
fe lance, fi la jambe de devant du même
coté relte en place , le mouvement devient plus
.dur par cette r.éfiftance, & c’eft pour cela que
l’intervalle entre les dçux temps du trot doit être
.court ; mais Quelque court qu’il puiffe être , cette
rcfiftance fuffit pour rendre cette allure plus dure
que le pas & le galop. Dans je trot., les jambes
.du cheval s’élèvent davantage que dans le pas,
& les pieds font entièrement détachés de terre.
Il n’y a dans cette allure que deux temps dans le
mouvement ; fi la jambe droite de devant part,
la jambe gauche de derrière ..part auffi en m,ême
temps- & fans aucun intervalle entre le mouvement
de l’une & le mouvement de l’autre ; en-
fuite la jambe gauche de devant part avec la jambe
droite de derrière auffi en même temps ; de forte
qu’il n’y a dans ce mouvement du trot que deux
temps ,& un intervalle ; le pied droit de devant
8c le pied gauche de derrière pofent.à terre en
.même temps , & e.nfuj^ le pied gauche de devant
& le droit de derrière pofent auffi à tepre
.en même temps.
Dans le galop , les jambes du cheva l s’élèvent
.encore plus haut que dans le tro t , 8c les pieds
Semblent bondir fur la terre. Dans cette allure,
il y a ordinairement trois temps ; par exemple,
le pied gauche de , derrière pofe'à terre le premier
, enfuite la jambe droite de derrière fe lève
conjointement avec -la gauche de devant, & elles
retombent à terre en même temps ; &. enfin la
jambe droite de devant, qui s’eft levée un inftant
après la gauche de devant & la droite de derrière
pofè à terre la derniere , ce qui fait le troisième
temps ; ainfi dans ce mouvement du galop,
il y a trois temps & deux intervalles , & dans le
premier de ces intervalles , lorfque. le mouvement
fe fait avec yîteffe , il y a un inftant ou les
quatrp jambes font en l’air en mêmp temps,, &
où l’on vo.it jes .quatre fers du cheval à la fois ;
Lorfque le cheval a fes hanches 8c les jarrets
fouples , & .qu’il les remue avec vîtgffe 8c agilité
, ce mouvement du galop eft plus parfait, &
la cadence s’en fait à quatre temps ; il pofe d’abord
le pied gauche de derrière ; qui fait le premier
temps,, enfuite le pied droit de derrière retombe
le premier & marque le fécond temps ; le pied
gauche de devant tombant un inftant après ,
, marque le troifième tem p s& enfin le pied droit
de devant qui retombe le dernier, marque le
quatrième temps..
Les chevaux galopent ordinairement fur Je pied
droit de la même manière qu’ils partent de la
jambe droite pour marcher 8ç pour trotter ; ils
entament auffi le chemin en galopant par la jambe
droite de devant , qui eft plus avancée, que la
gauche, & de même la jambe droite de derrière
qui fuit immédiatement la droite de devant, eft
•suffi plus avancée que la gauche de derrière, &
.çela co.nftamment j, tant que le galop dure ; deftà
il réfnlte que la jam b e g auche , qui p o rte to u t le
poids , 8l qui pouffe les autres en a v a n t , eft la
plus fatiguée ; en' fo rte qu’il fe roit b o n d’exe rce r
le s chevaux à g a lop e r alte rn a tiv em en t fur le pied
gau ch e auffi bien q u e fur le d r p i t i l s fuffiroient
plus lo n g - t em p s à c e m o u v em en t v io le n t. Le
re ffort des ja rre ts con trib u e autant au m o u v em en t
du galop que celui des reins ; tandis que les reins
fo n t effort p ou r é le v e r & pouffer en ay an t les
p arties a n té r ie u re s , le pli du ja r re t fait r e f f o r t ,
rom p t le coup 8c ad o u cit la fecouffp : a in fi, plus
le re ffort du ja r re t e ft liant fouple , plus lç
m o u v em en t du galop e ft d o u x ; il eft auffi d’auta
n t plus p rom p t 8c plus rapide que les jarrets
font plus forts ; & d’autant plus foutenu, que le
cheval p o r te plus fur les hanches , 8c que les
épaules font plus foutenues p a r la fo rc e des reins..
A u r e f t e ., les chevaux qui dans le galop lè v en t
bien haut les jamb es de d e v a n t , n e fo n t pas ceu x
qui g a lop en t le m i e u x , ils a v an cen t moins que
le s a u t r e s , & fe fatiguent d av an tag e , & cela
v ie n t o rd in a irem en t de .ce qu’ils n’o n t pas les
épaules affez libres.
O u tre le p a s , le tro t & le galpp ;, il y a des
çhevaux qui .ont naturellement, une a u tre allure
q u ’o n appelle l'amble. C e t te allure ,eft très, fatig
an te p o u r j ’a n im a i, quoique la viteffe du mouv
em e n t n e fo it pas fi gran de que. dans le g alop
pu dans le gran d tro t. D an s c e tte allure ., le pied du
cheval rafe la te rre en co re de plus p rè s que dans
le p as , 8c chaque d ém a rch e eft beau cou p plus
along ée ; mais ce q u ’il y a de Singulier ? c ’e ft que
le s d eu x jambes du m êm e cô te , p a r e x em p le ?
c ç lle d e d e v an t & ce lle dg d e rriè re du .co té d ro it
p a rten t én m êm e tem p s p ou r faire un pas , ôç
qu’enfuite le s d eu x jambes du cô té g auche p a rten t
âuffi en m êm e tem p s , p ou r en faire un au tre , 8c
ainfi fu cce ffiv em en t ; en fo rte que les d eu x cô té s
du co rp s manquent alte rn a tiv em en t d’appui , ôç
qu’ij n’y a p o in t d’équilibre de l’un à l’au tre . I l
n’y ja dans l’amble, com m e dans. le tro t , que
d eu x tem p s dans le m o u v em en t ? & to u te la différen
ce , e f t , que dans le t r o t , les d eu x jambes qui
v o n t enfemble font oppofées erT d iagonale , au
lieu que dans l’amble c e fo n t le s d eu x jamb es du
m êm e cô té qui v o n t en femb le. C e t te a llu re , qui
eft trè s -fa tig an te p ou r le cheval, & qu’on n e doit
lui laiffer p ren d re que dans les terrein s unis , eft
trè s -d o u c e p ou r le cavalier, & n’a pas. la d ureté
du tro t. Q n affure .que les chevaux qui naturelle?
n ien t yon.t J’ambîè , ne tro tte n t jamais , & qu’ils
fo n t b e au cou p plusfoibles que les autres. E n e f f e t,
les poulains prennent allez fouvent c e tte allure ,
fu r-tou t lorfqu’p n les fo rc e à -aller v ite , & qu’ils
n e font pas en co re affez fo rts p ou r tro tte r ou
p o u r g a lop e r ; & l’on ob ferve auffi que la plup
a rt des bon s chevaux qui o n t é té tro p fa tigu é s,
8c qui com m en cen t à s’u l e r , p ren n en t eux-mêmes
c e t te allure lorfqu’on les fo rc e à un m o u v em en t
plus rap id e que pelui du p a s .
a
Il y a en co re d eu x autres allures j Ventreras
& Xaubin, que les chevaux foibles o u e x céd é s
prennent d’e u x -m êm e s , & qui font beau cou p
plus d é fe âu eu fe s que l’amble. O n a appellé ce s
xnauvaifes allures des trains rompus , défunis ou
compofés. L ’entrepas tien t du pas 8c de l’amble ,
& . l’aubin tien t du tro t 8c du galop ; l’un & l’autre
viennent des e x c è s d’une longue fatigue ou d’une
grande foibleffe de reins ; l e s chevaux d e .M e f fa -
gerie qu’o n furcharge , com m en cen t à aller l’e n -
trepas au lieu du t r o t , à mefiure qu’ils fe ruinent ;
& les chevaux de p o fte ruinés , qu’on preffe de
g a lop e r, v o n t l’aubiri au lieu du galop .
L ’éducation du cheval , p ou r le'' ren d re p arfaitement
d o cile au ca v a lie r , 8c le fo rm e r fous
fa main au x diverfes évolu tions , eft l’o b je t d’un
art d’e x e r c ic e p a r ticu lie r , cônnu fous le n om de
manège. O n n’ap p o rte pas mo in s d’a ttention 8c de
foins p ou r le ch o ix des belles ra ce s des chevaux
& pour leur p rop agation dans l e s haras > 8c ce s .
foins o n t p o u r p rincipal o b je t le ch o ix du cheval
mâle e n t i e r , o u étalon que l’on v e u t d onner au x
jumens.
Un b o n étalon d o it ê tre b e a u , b ien f a i t , re le v é
du d e v a n t, v ig o u r e u x , fain p a r to u t le c o r p s , 8c
fur-tout de b on n e r a c e & d e b o n p a y s ; il doit
être de belle t a i ^ e , c ’e f t-à -d ire , de q uatre pieds
h uit, neu f o u dix p o u ce s p o u r les chevaux de
felle, 8c de cin q pieds au m o in s p o u r les chevaux
de. carofle : il faut auffi qu’il fo it de bon p o i l , no ir
comme du j a y e t , ou b e au g r i s ,b a i , a le z a n , ilabelle
doré a v e c la ra ie de m u le t , les crins 8c les e x tré mités
noires : tous les poils qui fo n t d’u ne couleur
lavée 8c qui paroiffent "mal te in t s , d o iv en t .ê tre
bannis des h a r a s , auffi bien que les chevaux qui
ont les e x trém ité s blanches.
A v e c un trè s -b e l e x té r i e u r , l’étalon do it a v o ir
encore tou te s les b onnës qualités intérieures ; du
courage , de la d o cilité , de l’ardeur , de l’a g ilité ,
de la fenfibilité dans la b ouche , de la liberté dans
les épaules , de la fûreté dans les jam b e s , d e la
foupleffe dans les hanches , du reffort p a r to u t le
c o rp s , & fu r-tou t dans les' ja r r e t s , 8c m êm e il
doit avoir été un p eu dreffé & e x e r c é au manèg e ;
car on a remarqué que le cheval communique p a r
[ la génération prefque tou tes fes b on n e s & m au -
vaifes qualités naturelles & acquifes.
Lorfque l'étalon e ft choifi & que les jumens
qu’on v eu t lui don n er font raffemblées , il faut
avoir un autre cheval en tie r qui n e fe rv ira qu’à
faire con n o ître les jumens qui fe ron t en ch a l e u r ,
& qui m êm e co n tr ib u e r a , p a r fes attaques , à les y
faire en tre r ; on fait paffer tou te s les jum e n s , l’u ne
apres l’autre , d e v a n t ce cheval, qui d o it ê tre
ardent 8c hennir fréq u em m en t ; il v e u t les attaquer
toutes ; celles qui n e fo n t p o in t en chaleur fe
défendent , 8c il n’y a que celles qui y font
t a r e n t ap p rq ch e r ; m a i s , au lieu de les lui
laiffer to u ch e r , on l’é lo ig n e , 8c on lui fubftitue
le véritable étalon. C e t te ép reu v e e ft utile p our
Histoire Naturelle. Tom, / ,
re co n n o ître le v ra i tem p s de la ch aleu r des jum e n s ,
8c fu r-tou t de celles qui n’o n t pas en co re p roduit ;
ca r celles qui v ien n en t d e pouliner en tren t ordin
a irem en t en chaleur n eu f jo u rs après leu r a c c o u ch
em en t ; ainfi on p eu t le s m e n e r à Xétalon dès ce
jo u r m êm e ; enfuite effaye r , n eu f jou rs a p r è s , au
m o y e n d e l’ép reu v e ci-d e ffu s , fi elles fo n t en co re
en chaleur ; & fi elles y fo n t en e f f e t, le s faire
co u v r ir une fé co n d é f o i s , ÔC ainfi de fuite u n e
fois tous les n eu f jo u r s , tan t que leur chaleur dure ,
c a r lorfqu’elles fo n t pleines , la chaleur diminue
8c ceffe peu de jou rs après.
Mais p ou r que to u t ce la puiffe fe faire a ifémen t ^
com m od ém en t , a v e c fu ccès & fruit , il faut
b e au cou p d’a tte n tio n , de dépenfe 8c de p ré cau tion
s . I l faut établir les haras dans un b o n te rre in
& dans un lieu co n v en ab le & p ro p o rtion n é à la
quantité de jumens & d'étalons qu’o n v e u t emp
l o y e r ; il faut p a rtag e r le te rre in en plufieurs
parties , fermées de paliffades o u de fo ffé s , a v e c d e
bonnes haies ; m e ttre les jumens pleines & ce lle s
qui a laitent leurs poulains dans la p artie o ù le
p â tu rag e e ft le plus gras ; fép a re r celles qui n’o n t
pas co n çü o u qui n’o n t pas en co re é té c o u v e r te s ,
8c les m e ttre a v e c les jeunes poulins dans un
au tre p a r c o ù le p âturag e fo it mo in s gras ,
afin qu’elles n’engraiffent pas t r o p , c e gui s’o p p o -
f e r o i tà la g é n é r a tio n ; 8c e n f in , il faut m e ttre les
jeunes poulains entiers o u hongres dans la p a rtie
du te rre in la plus lè ch e & la plus in é g a le , p o u r
qu’en m o n tan t 8c en defeendant les collines , iis
acq u iè ren t de la lib e rté dans le s jam b e s 8c dans
les épaules.
C e d e rn ie r p a r c , o ù l’on m e t les poulains
mâles , d o it ê tre féparé de ce u x des jum en s a v e c
g ran d fo in , de p eu r que c e s jeunes chevaux n e
s’éch ap p en t 8c ne s’én e rv en t a v e c les jumen s . S i
le te rre in e ft a ^ e z gran d p ou r qu’on puiffe p a rta g e r
en d eu x parties chacun de ce s p a rc s , p o u r y
m e ttre a lte rn a tiv em en t des chevaux 8c des boeufs
l’année fuivante , le fonds du p â tu rag e d u rera bien
plus lon g -tem p s que s’il é to it con tin u e llem en t
mangé p ar les chevaux. I l faut auffi qu’il y a it des
mares dans chacun de ce s p a rc s ; le s e a u x d o rm
an tes fo n t meilleures p o u r le s chevaux que les
e au x v i v e s , qui leur d on n en t fou ven t des tran chées
, & s’il y a quelques arbres dans ce s terrein s ,
il n e fau t pas les détruire ; les chevaux font bien
aifes d e tro u v e r c e tte om b re dans les grandes
chaleurs ; mais s’il y a des tro n c s , des ch ico ts ou
des trou s , il faut a rra ch e r , com b le r , ap p la n ir ,
p ou r p rév en ir to u t a c c id en t. C e s p â tu rag e s fe r-
v iro n t à la n ou rritu re du haras p en d an t l’été ; il
faudra m e ttre p en d an t l’hiver le s jumens à l’écu rie
& les nourrir a v e c du f o in , auffi bien que lés
poulains qu’on n e m è n e ra p â tu re r que dans les
b e au x jours d’h iv e r . L e s étalons d o iv en t ê tre
tou jou rs nourris à l’é cu rie 8c en tre ten u s dans un
e x e r c i c e m o d é ré jufqu’au tem p s de la m o n te , qui
dure o rd in a irem en t depuis le com m en cem en t