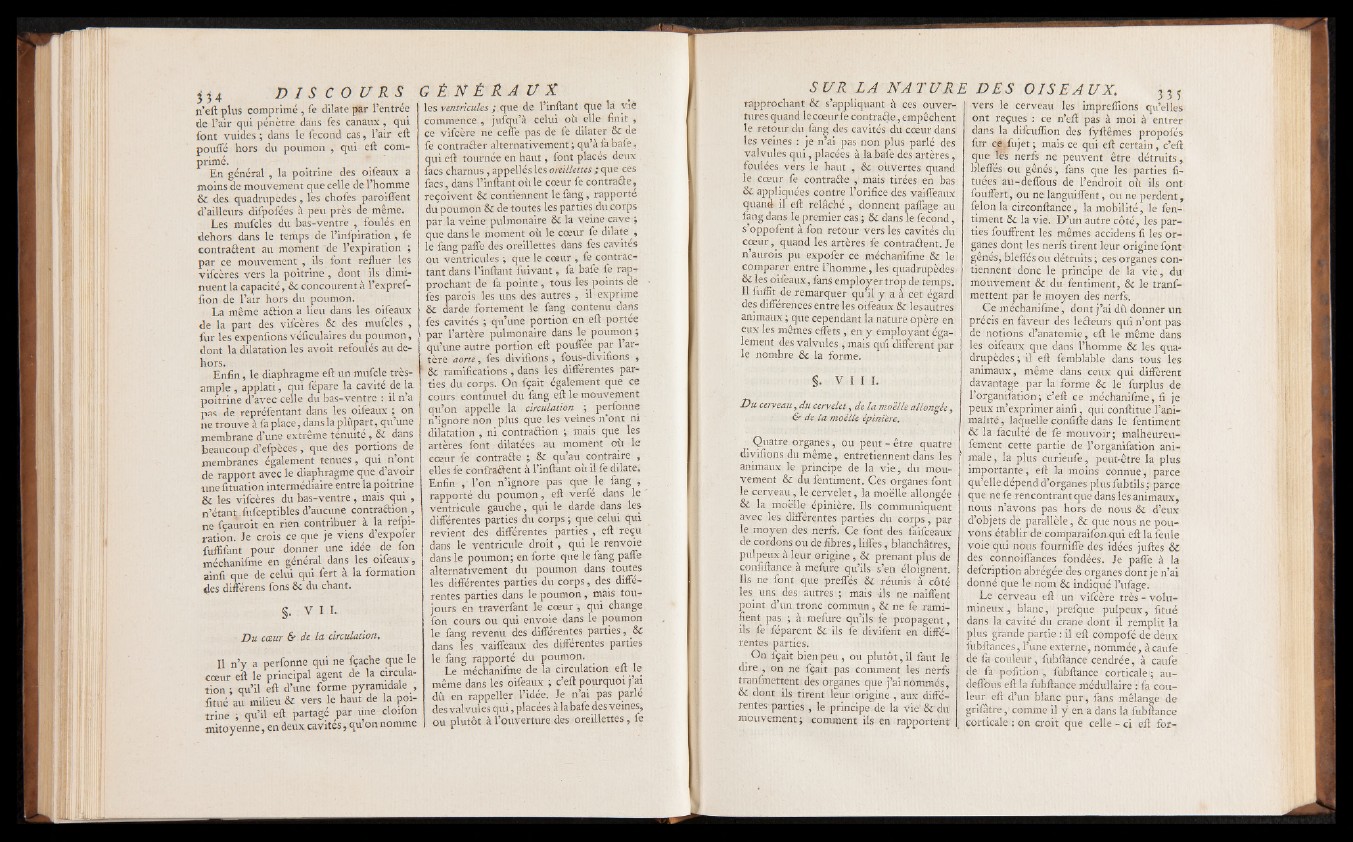
n’eft plus comprimé, fe dilate par l’entrée
de l’air qui pénètre dans fes canaux , qui
font vuides ; dans le fécond cas, l’air eft
pouffé hors du poumon , qui eft comprimé.
"
En général , la poitrine des oifeaux a
moins de mouvement que celle de l’homme
& des quadrupèdes., les chofes paroiffent
d’ailleurs difpofées à peu près de même.
Les mufcles du bas-ventre , foulés en
dehors dans le temps de l’infpiration, fe
contraâent au moment de l’expiration ;
par ce mouvement , ils font refluer les
vifcères vers la poitrine , dont ils diminuent
la capacité, 8c concourent à l’expref-
fion de l’air hors du poumon.
La même action a lieu dans les oifeaux
de la part des vifcères 8c des mufcles ,
fur les expenfions véfxculaires du poumon,
dont la dilatation les avoit refoulés au dehors.
.
Enfin, le diaphragme eft un mufcle très-
ample , applati, qui fépare la cavité de la
poitrine d’avec celle du bas-ventre : il n’a
pas de repréfentant dans les oifeaux ; on
ne trouve à fa place, dans la plûpart, qu’une
membrane d’une extrême ténuité, 8c dans
beaucoup d’efpèces, que des portions de
membranes également tenues , qui ^n ont
de rapport avec le diaphragme que d’avoir
une fituation intermédiaire entre la poitrine
& les vifcères du bas-ventre , mais qui ,
n’étant-fufceptibles d’aucune contraftion,
ne fçauroit en rien contribuer a la refpi-
ration. Je crois ce que je viens d’expofer
fuflifant pour donner une idée de fon
méchanifme en général dans les oifeaux,
ainfi que de celui qui fert à la formation
des différens fons 8c du chant.
§• V I I .
Du coeur &' de lu circulation.
Il n’y a perfonne qui ne fçache que le
coeur eft le principal agent de la circulation
; qu’il eft d’une forme pyramidale ,
jitué au milieu 8c vers le haut de la poitrine
; qu’il eft partagé par une cloifon
mitoyenne, en deux cavités, qu on nomme
les ventricules ; .que de l’inftant que là viè
commence , jufqu’à celui oh elle finit ,
ce vifeère ne celle pas de fe dilater 8t de
fe contracter alternativement ; qu’à fa bafe,
qui eft tournée en haut, font placés deux
lacs charnus, appellés les oreillettes ; que ces
facs, dans l’inftant où le coeur fe contracte,
reçoivent 8c contiennent le fang, rapporte
du poumon 8c de toutes les parties du corps
par la veine pulmonaire 8c la veine cave ;
que dans le moment où le coeur fe dilate y,
le fang paffe des oreillettes dans fes cavités
qu ventricules ; que le coeur , fe contractant
dans l’inftant fuivant, fa bafe fe rapprochant
de fa pointe , tous les points de
fes parois les uns des autres , il exprime
8c darde fortement le fang contenu dans
fes cavités ; qu’une portion en eft portée
par l’artère pulmonaire dans le poumon ;
qu’une autre portion eft pouffée par l’artère
aorte, fes divifions , fous-divifions ,
* 8c ramifications , dans les différentes parties
du corps. On fçait également que ce
cours continuel du fang eft le mouvement
qu’on appelle la circulation ; perfonne
n’ignore non plus que les veines n’ont ni
dilatation , ni contraftion ; mais que les
artères font dilatées au moment où le
coeur fe contracte ; 8c qu’au contraire ,
elles fe confraftent à l’inftant où il fe dilate;
Enfin , l’on n’ignore pas que le fang ,
rapporté du poumon, eft verfe dans le
ventricule gauche, qui le darde dans les
différentes parties du corps ; que celui qui
revient des différentes parties , eft reçu
dans le ventricule d ro it, qui le renvoie
dans le poumon; en forte que le fang paffe
alternativement du poumon dans toutes
les différentes parties du corps, des différentes
parties dans le poumon, mais toujours
en traverfant le coeur , qui change
fon cours ou qui envoie dans le poumon
le fang revenu des différentes parties, 8c
dans le s . vaiffeaux des différentes parties
le fang rapporté du poumon.
Le méchanifme de la circulation, eft^jlc
même dans les oifeaux ; c’eft pourquoi j’ai
dû en rappeller l’idee. Je n’ai pas parle
des valvules qui, placées à la bafe des veines,
ou plutôt à l’ouverture des oreillettes, fe
rapprochant 8c s’appliquant à ces ouvertures
quand le coeur fe contracte, empêchent
le retour du fang des cavités du coeur dans
les veines : je n’ai pas non plus parlé des
valvules qu i, placées à la bafe des artères,
foulées vers le haut , 8c ouvertes quand
le coeur fe contracte , mais tirées en bas
8c appliquées- contre l’orifice des vaiffeaux
quand il eft relâché , donnent pafl'age au
fang dans le premier cas ; 8c dans le fécond,
s’oppofent à fon retour vers les cavités du’
coeur, quand les artères fe contraftent. Je
n’aurois pu expofer ce méchanifme 8c le
comparer entre l’homme, les quadrupèdes -
8c les oifeaux, fans employer trop de temps.;
Il fuffit de remarquer qu:ij y a à cet égard
des différences entre les oifeaux 8c lesautres
animaux ; que cependant la nature opère en;
eux les mêmes effets, en y employant éga-;
lement des valvules , mais qui diffèrent par
le nombre 8c la forme.
§. V I I I .
Du cerveau, du cervelet, de la moelle allongée ,
& de la moelle épinihre.
Quatre organes, ou peut - être quatre
divifions du même , entretiennent dans les
animaux le principe de la v ie , du mouvement
8c du fentiment. Ces organes.font
le cerveau, le cervelet, la moelle allongée
8c la moelle épinière. Ils communiquent
avec les différentes parties du corps, par
le moyen des nerfs. Ce font des faifeeaux
de cordons ou de fibres, liffes, blanchâtres,
pulpeux à leur origine , 8c prenant plus de
confiftance a mefure qu’ils s’en éloignent.
Ils ne font que preffés 8c réunis à côté
les. uns des autres ; mais dis ne naiffent
point d’un, tronc commun, 8c ne fe ramifient
pas ; à mefure qu’ils! fe propagent,
ils fè féparent 8c ils fe divifent en diffé-1
rentes parties.
On fçait bien peu, ou plutôt, il faut le
dire , on ne fçait pas comment les nerfs
tranfmettent . des organes que j’ai nommés,.
8c dont ils tirent leur origine , aux différentes
parties , le principe de la vie' 8c'du
mouvement; comment ils en rapportent
vers le cerveau les imprelîîons qu’elles
ont reçues : ce n’eft pas à moi à entrer
dans la difeuffion des fyftêmes propofés
fur ce jfujet ; mais ce qui eft certain, c’eft
que les nerfs ne peuvent être détruits,
bleffés ou gênés, fans que les parties fi-
tuées au-deffous de l’endroit où ils ont
fouffert, ou ne languiffent, ou ne perdent,
félon la circonftance, la mobilité, le fentiment
8c la vie. D ’un autre côté, les parties
fouffrent les mêmes accidens fi les organes
dont les nerfs tirent leur origine font
gênés, bleffés ou détruits ; ces organes contiennent
donc le principe de la v ie , du
mouvement 8c du fentiment, 8c le tranfmettent
par le moyen des nerfs.
Ce méchanifme, dont j ’ai dû donner un
précis en faveur des lefteurs qui n’ont pas
de notions d’anatomie, eft le même dans
les oifeaux que dans l’homme 8c les quadrupèdes;
il eft femblable dans tous les
animaux, même dans ceux qui different
davantage par la forme 8c le furplus de
l’organilàtiôn; c’eft ce méchanifme, fi je
peux m’exprimer ainfi, qui conftitue l ’animalité
, laquelle confifte dans le fentiment
8c la faculté de fe mouvoir; malheureu-
fement cette partie de l’organifation animale,
la plus curieufe, peut-être la plus
importante-, eft la moiiis connue, parce
qu’elle dépend d’organes plus fubtils ; parce
que ne fe rencontrant que dans les animaux,
nous n’avons pas hors de nous 8c d’eux
d’objets de parallèle, 8c que nous ne pouvons
établir de comparaifon qui eft la feule
voie qui nous fourniffe des idées juftes 8c
des connoiffances fondées. Je paffe à la
defeription abrégée des organes dont je n’ai
donné que le nom 8c indiqué l’ufage.
Le cerveau eft un vifeère trè s -vo lu mineux
, blanc, prefqite pidpeux, fitué
dans la cavité du crâne dont il remplit la
plus grande partie : il eft compofé de deux
fubftances, l’une externe, nommée, àcaufe
de fa couleur, fubftance cendrée, à caufe
de fa pofition , fubftance corticale; au-
deffous eft la fubftance médullaire : fa couleur
eft d’un blanc pur, fans mélange de
grifâtre, comme il y en a dans la fubftance
ieorticale : on croit que celle - ci eft for