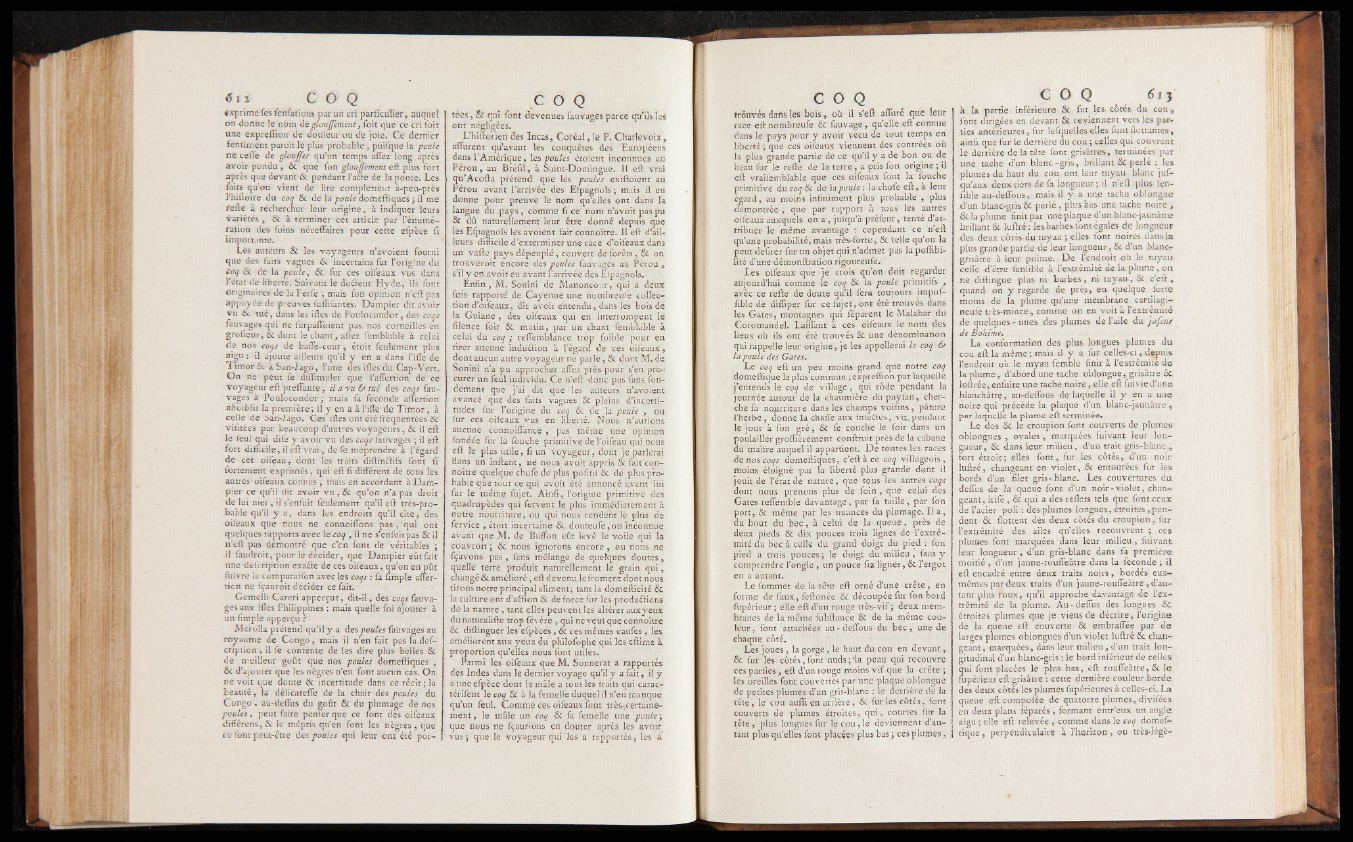
exprime fës fenfations par un cri particulier, auquel
on donne le nom de gloujfement 3 foit que ce cri l'oit
une expreffion de douleur ou de joie. Ce dernier'
fentiment paroîtle plus probable, puifque la poule
ne celle de gloujfer qu’un temps allez long après
avoir pondu, & que Ion glouffement eft plus fort
après que devant & pendant l’aéte de la ponte. Les
faits qu’on vient de lire complettent à-peu-près
l’hiftoire du coq & de la poule dorîièftiques ; il me
relie à rechercher leur origine , à indiquer leurs
variétés, & à terminer-cet article par rémunération
des foins néceffaires pour cette efpèce fi
importante.
Les auteurs & les voyageurs n’avoient fourni
que des faits vagues & incertains lur l’origine du
coq & de la poule, &. fur ces oifeaux vus dans
l’état de liberté. Suivant le doéfeur Hyde, ils font
Originaires de la Perfe /, mais fon opinion n’eft pas
aPPuy®e de preuves fuffifantes. Dampier dit avoir
vu &. tué, dans les ifles de Poulocondor, des coqs
fauvages qui ne furpaffoient pas nos corneilles en
groffeur, &. dont le chant, affez femblable à celui
de nos coqs de baffe-cour , étoit feulement plus
aigu ; il ajoute ailleurs qu’il y en a dans rifle de
Timor & a San-Jago, l’une des ifles du Cap-Vert.
On ne peut fe diffmutler que l’affertion de ce
voyageur eft preffante-, il a vu & tué des coqs fauvages
à Poulocondor ; mais fa fécondé affertion
aftoiblit la première; il y en a à l’ifte de Timor, à
celle de San-Jago. Ces ifles ont été fréquentées &
vifitées par beaucoup d’autres voyageurs, & il eft
le leul qui dife y avoir vu des coqs fauvages'; il eft
fort difficile, il eft vrai, de fe méprendre à l’égard
de cet oifeau, dont : les traits diftinéfifs font fl
fortement exprimés, qui eft fl différent de tous lés
autres oifeaux connus; mais en accordant àDartï-
pier ce qu’il dit avoir v u , & qu’on n’a pas droit
de lui nier, il s’enfuit feulement qu’il eft très-probable
qu’il y a, dans les endroits qu’il cite, dés
oileaux que nous ne connoiffons pas , qui ont
quelques rapports avec le coq , il ne s’enfuit pas & il
n eft pas démontré que c’en font de véritables ;
H faudroit, pour le décider, que Dampier eût fait
une delcription exaéle de ces oileaux, qù’on en pût
fuivre la comparaifon avec les coqs : fa Ample affer-
ticn ne fçauroit décider ce fait.
Gemelli-Careri apperçut, dit-il, des coqs fauvages
aux ifles Philippines : mais quelle foi ajouter à
un Ample apperçu ?
Mérolla prétend qu’il y a des poules fauvages au
royaume de Congo, mais il n’en fait pas la defi-
cription ; il fe contente de les dire plus belles &
de meilleur goût que nos poules domeftiques ,
& d’ajouter que les nègres n’en font aucun cas. On
ne voit que doute & incertitude dans ce récit; la
beauté, la délicateffe de la chair des poules du
Congo, au-deffus du goût & du plumage de nos
poules, peut faire penlèr que ce font des oifeaux
différens, & le mépris qu’en font les nègres , que
ce font peut-être tes poules qui leur oiit été portées,
& qui font devenues fauvages parce qu’ils les
ont négligées.
L’hiltorien des Incas, Coréal, le P. Charlevoix,
affurent qu’avant les conquêtes des Européens
dans l’Amérique, les poules étoient inconnues au
Pérou, au Bréfil, à Saint-Domingue. Il eft vrai
qu’Acofta prétend que les poules exiftoient au
Pérou avant l’arrivée des Elpagnols ; mais il eii
donne pour preuve le nom qu’elles ont dans la
langue du.pays, comme fl ce nom n’avoit pas pu
& dû naturellement leur être donné depuis que
les Efpagnols les avoient fait connoître. Il eft d’ailleurs
difficile d’exterminer Une race d’oifeaux dans
un vafte pays dépeuplé, couvert de forêts , & on
trouvéroit encore des poules fauvages au Pérou ,
s’il y en avôit eu avant l’arrivée des Ëipagnols.
Enfin, M. Soriini de Manonçour, qui a deux
fois rapporté de Cayenne une nombreufe collection
d’oifeaux, dit avoir entendu, dans les bois de
la Guiâne , dés oifeaux qui en interrompent lé
filençe foir & matin, par un chant femblable à
celui du coq ; reffemblance trop foible pour en
tirer aucune induéfion à l’égard de ces oifeaux ,
dont aucun autre voyageur ne parle, & dont M. de
Sonini n’a pu approcher affez près pour s’en procurer
un feul individu. Ce n’eft donc pas fans fondement
que j’ai dit que les auteurs n’a-voient
avancé que des faits vagues & pleins d’incertitudes
fur l’origine du coq & de la poule , ou
fur ces oifeaux vus en liberté. Nous n’aurions
aucune connoiffance ', pas même une opinion
fondée fur la fouche primitive de l’oifeau qui nous
eft le plus Utile, fl un voyageur, dont je parlerai
dans un inftant, né nous avoit appris & fait bon-
noîfrè quelque chofe dé plus pofitif & de plus probable
qüé tout ce qui avoit été annoncé avant lui
fur le même fujet. Ainfi, l’origine primitive dés
quadrupèdes qui fervent le plus immédiatement à
notre nourriture, ou qui nous rendent le plus de
fervice, étoit incertaine & douteufe , ou inconnue
avant que M. de Buffon eût lèvé le voile qui la
coüvroit ; & nous ignorons encore y ou nous ne
fçavons pas , fans mélange de quelques doutes,
quelle terre produit naturellement le grain qui,
changé & amélioré, eft devenu le froment dont nous
tirons notre principal aliment; tant la domefticité &
la culture ont d’aélion & de force fur les produélions
de la nature , tant elles peuvent les altérer auxyeux
dunaturalifte trop févère , qui ne veut que connoître
& diftinguer les efpècés, & ces mêmes caufes , les
améliorent aux yeux du philofophe qui les eftime a
proportion qu’elles nous font utiles.
Parmi les oifeaux que M. Sonnerat a rapportés
des Indes dans le dernier voyage qu’il y a fait, il y
a une efpèce dont le mâle a tous les traits qui carac-
térifent le coq & à la femelle duquel il n’en manque
qu’un feul. Comme ces oifeaux font très-certainement
, le mâle un coq & fa femelle une poule ;
que nous ne fçaurions en douter après les avoir
vus j que le voyageur qui les a rapportés, lès a
trouvés dans les bois, oh il s?eft affuré que leur
race eft nombreufe & faüvage, qu’elle eft connue
dans le pays pour y avoir vécu de tout temps en
liberté ; que ces oileaux viennent des contrées oh
la plus grande partie de ce qu’il y a de bon ou de
beau fur le refte de la terre, a pris fon origine ; il
eft vraifemblable que ces oifeaux font la fouche
primitive du coq & de la poule : la chofe eft, à leur
égard', au moins infiniment plus probable , 'plus
démontrée , que par rapport à tous les autres
oifeaux auxquels on a , jufqu’à prélent, tenté d’attribuer
le même avantage : cependant ce n’eft
qu’une probabilité, mais très-forte, &. telle qu’on la
peut defirer fur un objet qui n’admet pas la poffibi-
lité d’une démonftration rigoureufe. "
Les oifeaux que je crois qu’on doit regarder
aujourd’hui comme le coq & la poule primitifs ,
avec ce refte de doute qu’il fera toujours impof-
flble de difliper fur ce fujet, ont été trouvés dans
les Gates, montagnes qui fépàrent le Malabàr du
Coromandel. Laiffant à ces oifeaux le nom des
lieux oh ils ont été trouvés & une dénomination
qui rappelle leur origine, je les appellerai le coq &
ta poule des Gates.
Le coq eft un peu moins grand que notre coq
doméftique le plus commun ; expreffion par laquelle
j’entends le coq de village, qui rôde pendant la
journée autour de la chaumière diipayiàn, cherche
fa nourriture dans,les champs voifins, pâture
l’herbe , donne la chaffe aux infeéles, vil. pendant
le jour à fon gré, & fie couche le foir dans un.
poulailler groffièrement conftruit près de la cabane
du maître auquel il appartient. De toutes les races
de nos coqs domeftiques, c’eft à ce coq villageois,
moins éloigné par la liberté plus grande dont il
jouit de l’état de nature, que tous les autres coqs
dont nous prenons plus de foin, que celui des
Gates reffemble davantage, par fa taille, par fon
port, & même par les nuances du plumage. Il a,
du bout du bec, à celui de la queue, près de
deux pieds & dix pouces trois lignes de l’extrémité
du bec à celle du grand doigt du pied : fon
pied a trois pouces ; le doigt du milieu , fans y
comprendre l’ongle , un pouce flx lignes, & l’ergot
en a autant.
Le fommet de la tête eft orné d’une crête, en
forme de faux, feftonée & découpée fur fon bord
fupérieur ; elle eft d’un rouge très-vif ; deux membranes
de la même fubftance & de la même couleur,
font attachées au-deffotis du bec, une de
chaque côté.
Les joues, la gorge, le haut du cou en devant,
& fur les- côtés, font nuds;'la peau qui recouvre
ces parties , eft d’un rouge moins vif que la crête ;
les oreilles font couvertes par une plaque oblongue
de petites plumes d’un gris-blanc : le derrière de la
fête, le cou auffi en arrière, & fur les côtés, font
couverts de plumes étroites, qui, courtes fur la
tête , plus longues fur le cou ,1e deviennent d’autant
plus qu’elles font placées plus bas ; ces plumes,
à la partie inférieure & fur les. côtés du cou 9
font dirigées en devant & reviennent vers les parr
.ties antérieures, fur lefquelles elles font flottantes,
ainfi que fur le derrière du cou ; celles-qui couvrent
le derrière de la tête font grisâtres, terminées par
une tache d’un blanc-gris, brillant & perlé : les
plumes du haut du cou ont leur tuyau blanc jusqu’aux
deux tiers de fa longueur ; il n’eft plus fen-
fible au-deffous, mais il y a un.e tache oblongue
d’un blanc-gris & perlé, plus bas une tache noire ,
& la plume finit par une plaque d’un blane-jaunâti e
brillant & luftré : le&barbes font égales de longueur
des deux côtés du tuyau ; elles font noires dans la
plus grande partie de leur longueur, &. d’un blanc-
grisâtre à leur pointe. De l’endroit oh le tuyau
ceffe d’être fenfible à l’extrémité de la. plume , on
ne diftingue plus ni barbes, ni-tuyau., & c’eft,
quand on y regarde de près,, en quelque forte
moins de la plume qu’une membrane cartilagi-
neufe très-mince, comme on en voit à l’extrémité
de quelques - unes des plumes de l’aile du jafcur
de Bohême.
La conformation des plus longues plumes du
cou eft la même ; mais il y a fur celles-ci, depuis
l’endroit ou le tuyau fiemble finir à l’extrémité de
la plume , d’abord une tache oblongue, grisâtre &.
luftrée,. enfuite une tache noire, elle eft fuivie d’une
blanchâtre, au-deffous de laquelle il y en a une
noire qui précède la plaque d’un blanc-jaunâtre ,
par laquelle la plume eft terminée.
Le dos & le croupion font couverts de plumes
oblongues , ovales , marquées fuivant leur longueur
, & dans leur milieu, d’un trait gris-blanc
fort étroit; elles font, fur les côtés,, d’un noir
luftré, changeant en violet, & entourées fur les
bords d’un filet gris-blanc. Les couvertures du
deffus de la queue font d’un noir-violet, chan-:
géant, irifé , & qui a des reflets tels que font ceux
de l’acier poli : des plumes longues, étroites.,pendent
& flottent des deux côtés du croupion, fur
l’extrémité des ailes quelles recouvrent ; ces
plumes font marquées dans leur milieu, fuivant
leur longueur, d’un gris-blanc dans fa première,
moitié , d’un jaune-rouffeâtre dans la -fécondé ; il.
eft encadré entre deux traits noirs, bordés eux-
mêmes par deux traits d’un jaune-rouffeâtre , d’au-,
tant plus roux, qu’il approche davantage de l’extrémité
de la plume. Au-deffus des longues &
étroites plumes que je viens de décrire, l’origine
de la queue eft couverte & embraffée par de
larges plumes oblongues d’un violet luftré & changeant
, marquées, dans leur milieu , d’un trait longitudinal
d’un blanc-gris : le bord inférieur de celles
qui font placées le plus bas, eft rouffeâtre, & le
mpérieur eft grisâtre : cette dernière couleur borde
des deux côtes les plumes fupérieures à celles-ci. La
queue eft compofée. de quatorze plumes, divifées
en deux plans féparés , formant entr’eux un angle,
aigu ; elle eft relevée , comme dans le coq domef-
tique, perpendiculaire à l’horizon, ou très-légè