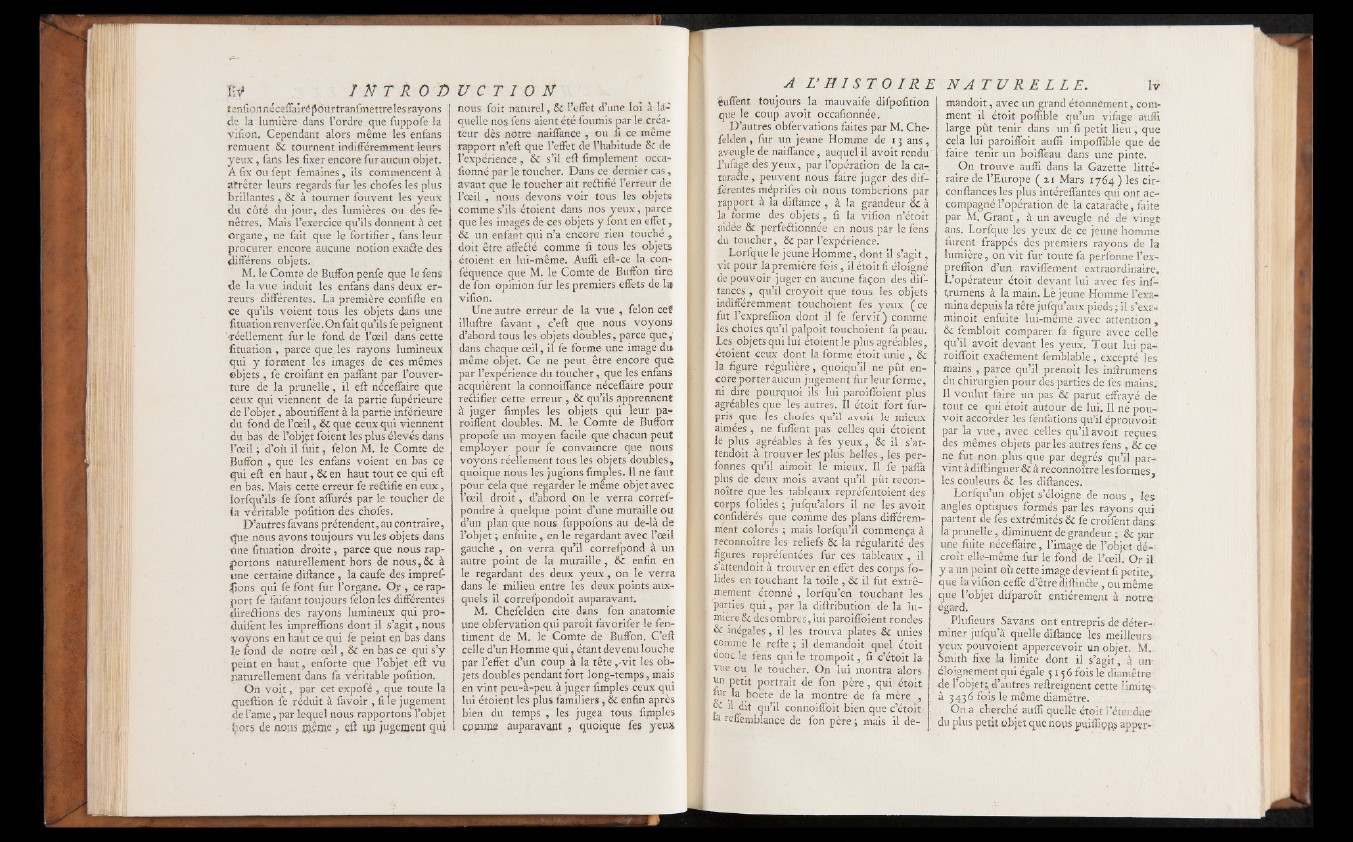
tenfiortnéceffairéjlôürtranfmettreles rayons
de la lumière dans l’ordre que fuppofe la
vifion. Cependant alors même les enfans
remuent & tournent indifféremment leurs
y e u x , fans les fixer encore fur aucun objet.
A fix ou fept femaines, ils commencent à
arrêter leurs regards fur les chofes les plus
brillantes, & à tourner fouvent les yeux
du côté du jour, des lumières ou des fenêtres.
Mais l’exercice qu’ils donnent à cet
organe, ne fait que le fortifier, fans leur
procurer encore aucune notion exaâe des
différens objets.
M. le Comte de Buffon penfe que le fens
de la vue induit les enfans dans deux erreurs
différentes. La première confiffe en
ce qu’ils voient tous les objets dans ime
fituation renverfée. On fait qu’ils fe peignent
•réellement fur le fond de l’oeil dans cette
fituation , parce que, les rayons lumineux
qui y forment les images de ces mêmes
objets , fe croifant en paffant par l’ouverture
de la prunelle, il eft neceffaire que
ceux qui viennent de la partie fupérieure
de l’objet, aboutjffent à la partie inférieure
du fond de l’oe il, & que çeux qui viennent
du bas de l’objet foient les plus élevés dans
l ’oeil ; d’oit il fu it, félon M. le Comte de
Buffon , que les enfans voient en bas ce
qui eft en haut, & en haut tout ce qui eft
en bas. Mais cette erreur fe reâifie en e u x , !
lorfqu’ils fe font affurés par le toucher de
la véritable pofition des chofes.
D ’autres favans prétendent, au contraire,
que nous avons toujours vu les objets dans
fine fituation droite , parce que nous rapportons
naturellement hors de n o u s ,& à
une certaine diftance , la caufe des impref-
lions qui fe font fur l’organe. Or , ce rapport
fe faifant toujours félon les différentes
riireûions des rayons lumineux qui pro-
duifènt les impreflîons dont il s’agit, nous
-voyons en haut ce qui fe peint en bas dans
le fond de notre oe i l , & en bas ce qui s’y
peint en haut, enforte que l ’objet eft vu
naturellement dans fa véritable pofition.
On v o i t , par cet expofé , que toute la
queftion fe réduit â favoir , fi le jugement
de l’ame, par lequel nous rapportons l’objet
Sjiors de nous a jlm e , eft un jugement qui
nous foit naturel, & l’effet d’une loi à laquelle
nos. fens aient été fournis par le. créateur
dès notre naiffance , ou fi ce même
rapport n’eft que l’effet de l’habitude & de
l’expérience, & s’il eft Amplement occa-
fionné par le toucher. Dans ce dernier cas,
avant que le toucher ait reûifié l’erreur de
l’oeil , nous devons voir tous les objets
comme s’ils étoient dans nos y e u x , parce
que les images de ces objets y font en effet,
& un enfant qui n’a encore rien touché ,
doit être affefté comme fi tous les objets
étoient en lui-même. Aulîi eft-ce la con-
féquence que M. le Comte de Buffon tire
de fon opinion fur les premiers effets de la
vifion.
Une autre erreur de la vue , félon cef
illuftre favaqt , c’eft que nous voyons
d’abord tous les objets doubles, parce que,
dans chaque oe il, il fe forme une image du
même objet. Ce ne peut être encore que
par l’experience du toucher, que les enfans
acquièrent la connoiffance néceffaire pour
redifier cette erreur , & qu’ils apprennent
à juger fimples les objets qui leur parodient
doubles. M. .le Comte de Buffonr
propofe un moyen facile que chacun peut
employer pour fe convaincre que nous
voyons réellement tous les objets doubles,
quoique nous les jugions fimples. Il ne faut
pour cela que regarder le meme objet avec
l’oe il d ro it, d’abord on le verra corref-
pondre à quelque point d’une muraille ou
d’un plan que nous fuppofons au de-là de
l’objet ; enfuite, en le regardant avec l’oeil
gauche , on verra qu’il correfpond à un
autre point de la muraille , & enfin en
le regardant des deux y e u x , on le verra
dans le milieu entre les deux points auxquels
il correfpondoit auparavant.
M. Chefelden cite dans fon anatomie
une obfervation qui paroît favorifer le fen-
timent de M. le Comte de Buffon. C ’eft
celle d’un Homme q u i, étant devenu louche
par l’effet d’un coup à la tête ,-vit les objets
doubles pendant fort long-temps, mais
en vint peu-à-peu à juger fimples ceux qui
lui étoient les plus familiers, & enfin après
bien du temps , les jugea tous fimples
comme auparavant , quoique fes yeux
'êuffent toujours la mauvaife difpofition
que le coup avoit occafionnée,
D’autres obfervations faites par M. Chefelden
, fur un jeune Homme de 13 ans,
aveugle de naiffance, auquel il avoit rendu
l ’ufage des yeu x, par l’opération de la ca-
taraâe , peuvent nous faire juger des différentes
méprifes où nous tomberions par
rapport à la diftance , à la grandeur & â
la forme des objets , fi la vifion n’étoit
aidée & perfeâionnée en nous par le fens
du toucher, & par l’expérience.
Lorfque le jeune Homme, dont il s’agit,
vit pour la première fo is , il étoit fi éloigné
de pouvoir juger en aucune façon des dif-
tances , qu’il croyoit que tous les objets
indifféremment touchoient fes yeux (ce
fut l’expreffion dont il fe ferv it) comme
les chofes qu’il palpoit touchoient fa peau.
Les objets qui lui etoient le plus agréables,
étoient ceux dont la forme étoit unie , &
la figure régulière, quoiqu’il ne pût encore
porter aucun jugement fur leur forme,
ni dire pourquoi ils lui paroiffoient plus
agréables que les autres. Il étoit fort fur-
pris que les chofes qu’il avoit le mieux
aimées -, ne fuffent pas celles qui étoient
le plus agréables à fes y e u x , & il s’at-
tendoit à trouver les plus belles, les per-
fonnes qu’il aimoit le mieux. Il fe paffa
plus de deux mois avant qu’il pût recon-
noître que les tableaux repréfentoient des
corps folides ; jufqu’alors il ne les avoit
confidérés tjue comme des plans différemment
colores 3 mais lorfqu’il commença â
reconnoître les reliefs & la régularité des
figures repréfentées fur ces tableaux , il
s’attendoit à trouver en effet des corps folides
en touchant la toile , & il fut extrê-,
mement étonné , lorfqu’en touchant les
parties q u i, par la diftribution de la lumière
& des ombres, lui paroiffoient rondes
& inégales, il les trouva plates & unies
comme leyefte ; il demandoit quel étoit
donc le fens qui le trompoit, fi c’étoit la
vue ou le toucher. On lui montra alors
tjn petit portrait de fon père, qui étoit
fur la boëte de la montre de fa mère ,
j d dit qu’il connoiffoit bien que c’étoit
la reffemblance de fon père ; mais il demandoit
, avec un grand étonnement, comment
il étoit pofuble qu’un vifage auflî
large pût tenir dans un fi petit lieu , que
cela lui paroiffoit aulîi impolîible que de
faire tenir un boiffeau dans une pinte.
On trouve aulîi dans la Gazette littéraire
de l’Europe ( z i Mars 1764 ) les cir-
conftances les plus intéreffantes qui ont accompagné
l’opération de la cataraâe, faite
par M. Grant, à un aveugle né de vingt
ans. Lorfque les yeux de ce jeune homme
furent frappés des premiers rayons de la
lumière, on vit fur toute fa perfonne l’ex-
prelïion d’un raviffement extraordinaire.
L’opérateur étoit devant lui avec fes inf-
t,rumens à la main. Le jeune Homme l’examina
depuis la tête jufqu’aux pieds ; il s’exa-
minoit enfuite lui-même avec attention ,
& fembloit comparer fa figure avec celle
• qu’il avoit devant les yeux. Tout lui pa-
roiffoit exaâement femblable, excepté les
mains , parce qu’il prenoit les inftrumens
du chirurgien pour des parties de fes mains.
Il voulut faire un pas & parut effrayé de
tout ce qui étoit autour de lui. Il ne pou-
voit accorder les fenfations qu’il éprouvoit
par la v u e , avec celles qu’il avoit reçues,-
des mêmes objets parles autres fens, & ce
ne fut non plus que par degrés qu’il parvint
àdiftinguer & à reconnoître les formes,
les couleurs & les diftances.
Lorfqu’un objet s’éloigne de nous , les
angles optiques formés par les rayons qui
partent de fes extrémités & fe croifent dans
la prunelle, diminuent de grandeur 3 & par
une fuite néceffaire, l’image de l’objet décroît
elle-même fur le fond de l’oeil. Or il
y a un point où cette image devient fi petite,
que la vifion céffe d’être diftinéte, ou même
que l ’objet difparoît entièrement à notre
egard.
Plufieurs Savans ont entrepris de déterminer
jufqu’à quelle diftance les meilleurs.
yeùx pouvoient appereevoir un objet. M.-
Smith fixe la limite dont il s’agit, à un:
éloignement qui égale 5156 fois le diamètre
de l’objet;, d’autres reftreignent cette limitq--
à 3436 fois le même diamètre.
On a cherché aulîi quelle étoit l’étendue-
du plus petit objet que nous puifliops apper