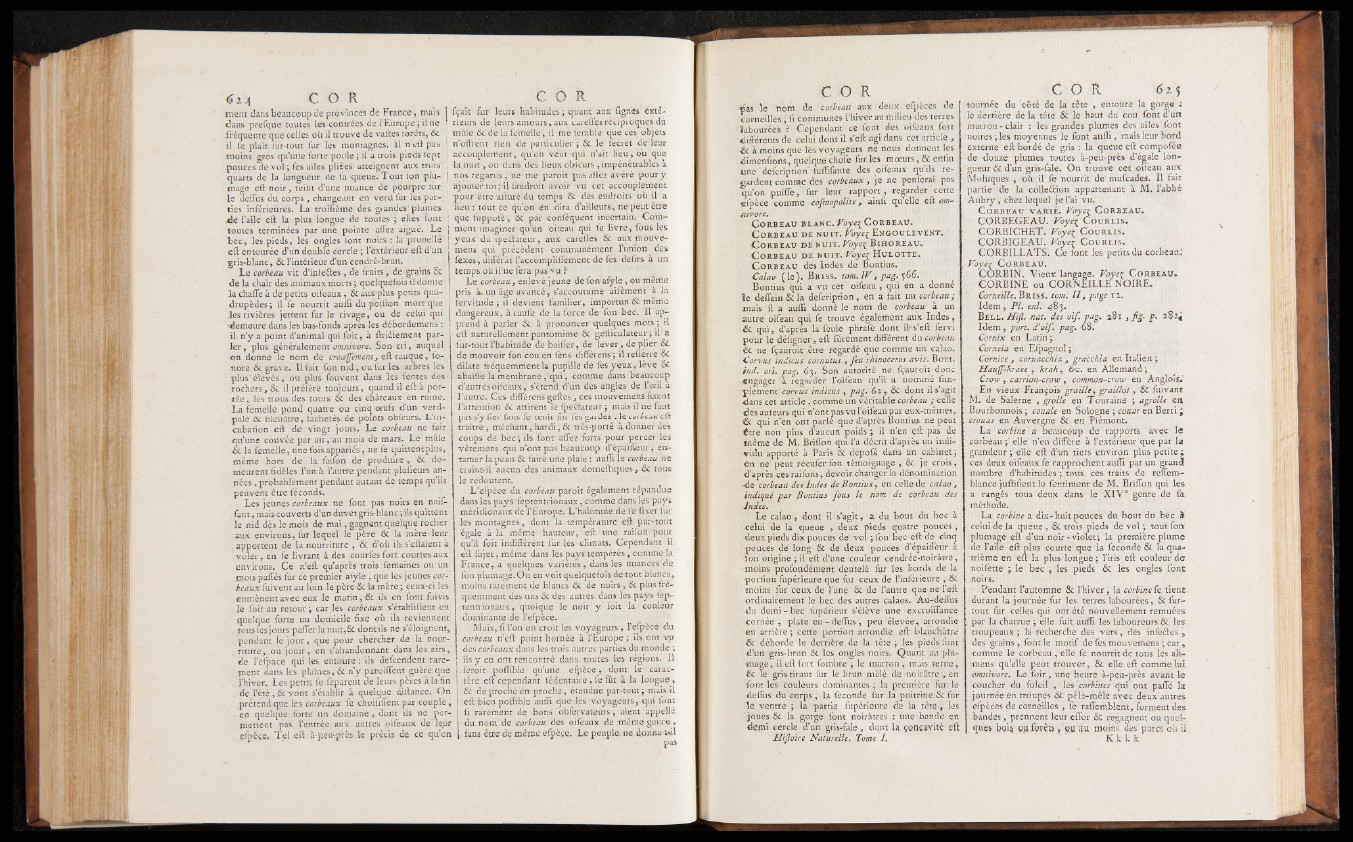
ment dans beaucoup de provinces de France, mais I fçait fur leurs habitudes ; quant aux lignes exté-
dans prefque toutes les contrées de l’Europe ; il ne ! rieurs de leurs amours, aux carefles réciproques du
fréquente que celles ou il trouve de vaftes iorêts, & mâle & de la femelle, il me l'emble que ces objets
il fe plaît fur-tout lur les montagnes. 11 n’eft pas i n offrent rien de particulier; & le l'ecret de leur
moins gros qu’une forte poule ; il a trois pieds tept 1 accouplement, quon veut qui n’ait lieu, ou que
pouces de vol ; fes ailes pliées' atteignent aux trois ; la,nuit, ou dans des lieuxobicurs , impénétrables a
quarts de la longueur de la queue. Tout Ion plu- j nos-regards, ne me paroît pas allez avéré pour y
mage eft noir, teint d’une nuance de pourpre lur ! ajouter foi;'il tau droit avoir vu cet accouplement
le deflus dU corps , changeant en verdiur les par- pour être afl'üré du temps & des endroits où il a
ties inférieùrês. La troilième des giandes' plumes i lieu : tout ce qu’on en dira d’ailleurs, ne peut être
de l’aile eft la plus longue de toutes ; elles font ! que fuppole, & par conféquent incertain. Com-
toutes terminées par une pointe allez aiguë. Le | ment imaginer qu’un oifeau qui fe livre, fous les
bec, les pieds, les ongles l'ont noirs : la prunelle ! yeux du ipèftateur, aux carefles & aux mouve-
eft entourée d’un double cercle ; l’èxtérieur eft d’un mens qui précèdent communément l’union des
gris-blanc, & l’intérieur d’un cendré-brun.
Le corbeau vit d’inleâes, de fruits , de grains &
de la chair des animaux morts ; quelquefois il donne
fa chafle à de petits oifc-aux, & aux plus petits qua- ;
drupèdes ; il fe nourrit aufli du poillon mort que
les rivières jettent fur le rivage, ou de celui qui |
■ demeure dans les bas-fonds après les débordemens : :
il n’y a point d’animal qui foit, à ftriéfement parler
, plus généralement omnivore. Son cri, auquel
on donne le nom de croajfement3 eft rauque, fo,-
nore & grave. 11 fait fon nid, ou fur les arbres les
plus'élevés, ou plus fouvent dans les fentes des
rochers, & il préfère toujours, quand il eft à portée,
les trous des tours & des châteaux en ruine.
La femelle pond quatre ou cinq oeufs d’un verd-
pâle & bleuâtre, tachetés de points obfcurs. L’incubation
eft de vingt jours. Le corbeau ne fait
qu’une couvée par an, au mois de mars. Le mâle
&. la femelle, une fois appariés, ne fe quittent plus,
même hors de la faifon de produire , & demeurent
fidèles l’un à l’autre pendant plufieürs années
, probablement pendant autant de temps qu’ils
peuvent être féconds.
Les jeunes corbeaux ne font pas noirs en naif-
fant, mais couverts d’un duvet gris-blanc ; ils quittent
- le nid dès le mois de mai, gagnent quelque rocher
aux environs, fur lequel le père & la mereleur
apportent de la nourriture , & d’où ils s’eflaient à
voler, en fe livrant à des courfesfort courtes aux
environs. Ce n’eft qu’après trois femaines ou un
mois pafles fur ce premier afyle, que les jeunes cor-•
beaux fuivent au loin le père &. la mère ; ceux-ci les
enmènentavec eux le matin, & ils en font fuivis
le foir au retour ; car les corbeaux s’établiffent en
quelque forte un domicile fixe où ils reviennent
tcu.s les jours paffer la nuit,& dont ils ne s’éloignent,
pendant le jour,.que pour chércher de la nourriture,
ou jouir, en s’abandonnant dans les airs,
de l’elpace qui les entoure : ils defcendent rarement
dans les plaines, & n’y paroiflent guère que
l’hiver. Les petits fe féparent de leurs pères à la fin
-de l’été, &. yont s’établir à quelque cÜftanee. On
prétend que les corbeaux fe choififlent par couple,
en quelque forte un domaine , dont ils ne permettent
pas rentrée aux autres oifeaux de le^ur
efpèçe, Tel eft à-peu-près le précis de ce qu’on
fexes, différât l’accompliffement de fes defirs a un
temps où il ne fera pas vu ?
Le corbeau, enlevé jeune de fon afyle, où même
pris à. un âge avancé,' s’accoutume aifément à la
lervitude ; ii devient familier, importun Sl même
dangereux, à caufe de la force de fon bec. 11 apprend
à parler & à prononcer quelques mots ; il
eft naturellement pantomime &. gefticulatçur ; il a
fur-tout l’habitude de bailler, de lever, de plier 8t
de mouvoir fon cou en fens différens; il reflerre &
dilate fréquemment la pupille de fes yeux, lève &
abaifle la membrane, qui, comme dans beaucoup
d’autres oifeaux, s’étend d’un des angles de l’oeil à
l’autre. Ces différens geftes , ces mouvemens fixent
l'attention & attirent le fpeélateur ; mais il ne faut
pas s’y fier fans fe tenir fur fes gardes : le corbeau eft
traître, méchant, hardi, & très-porté à donner des
coups de bec ; ils font affez forts pour percer les
vêtemens qui n’ont pas beaucoup d’épaifteur, entamer
la peau & faire une plaie : aufli le corbeau ne
craint-il aucun des animaux domeftiques, &. tous
le redoutent.
L’elpèce du corbeau paroît également répandue
dans les pays feptentrionaux, comme dans les pays
méridionaux de l’Europe. L’habitude de fe fixer lur
les montagnes, dont la température eft par-tout
égale à la même hauteur, eft une raifon pour
qu’il foit indifférent fur les climats. Cependant il
eft fujet, même dans les pays'tempérés| comme la
France, a quelques variétés , dans les nuânces'de
fon plumage.On en voit quelquefois de tout blancs,
moins rarement de blancs & de noirs , êt plus fréquemment
des uns & des autres dans les pays feptentrionaux
, quoique le noir y foit la couleur
-dominante de l’efpèce.
Mais, fi l’on en croit les voyageurs, l’efpèce du
corbeau n’eft point bornée à l’Europe ; ils ont yji
des corbeaux dans les trois autres parties du monde ;
ils y en ont rencontré dans-toutes ries régions. Il
feroit poffible qu’une efpèçe, dont le caractère
eft cependant fédentaire , fe fût à la longue»,
& de proche en proche, étendue par-tout ; mais il
eft bien poffible aufli que les voyageurs, qui font
fi rarement de bons obfervateurs, aient appelle
j'du nom'de corbeau des oifeaux de même genre ,
j fans être de même efpèçe. Le peuple, ne donne-tbl
pas
'pas le nom de corbeau aux deux efpèces «e
•corneilles, fi communes l’hiver au milieu des terres
îabouréès ? Cependant ce font des oifeaux fort
«différents de celui dont il s’eft agi dans cet article ,
& à moins que lés voyageurs ne nous donnent les
ffimenfions, quelque chofe fur les moeurs, & enfin :
une defcription' luffifante des oifeaux qu’ils regardent
comme des corbeaux , je ne penferai pas
qu’on puifle, fur leur rapport, regarder cette;
-efpèce comme cofmopolite, ainfi qu elle eft om-
%livore.
C o r b e a u b l a n c . Voye^ C o r b e a u .
C o r b e a u d e n u i t . Voyeç E n g o u l e v e n t .
C o r b e a u de n u i t . Voye^ B ih o r e a u .
C o r b e a u d e n u i t . Voye^ H u l o t t e ., j
C o r b e a u des Indes de Bontius.
Calao (le). B ris s . tom.1V , pag<}66.
Bontius qui a vu cet oifeau , qui en a donné
ïe deflein & la defcription, en a fait un corbeau;
mais il a aufli donné le nom de corbeau a un
autre oifeau qui fe trouve également aux Indes,
& qui, d’après la feule phrafe dont il*s’eft fervi
pour le défigner , eft fûrement différent du corbeau
ne fçauroit être regardé que comme un calao.
Corvus indicus cornutus,, feu rhinocéros avis. Bont.
ind. ori. pag. 63. Son autorité ne fçauroit donc
•engager a regarder l’ôifeau qu’il a nommé iim-
-plement corvus indicus , pag. 62 , & dont il s’agit
clans cet article , Comme un véritable corbeau ; celle
dés auteurs qui n’ont pas vu l’oifeau par eux-mêmes,
'& qui n’en ont parlé que d’après Bontius ne peut
être non plus d’aucun poids ; il n’en eft pas de
même de M. Briflbn qui l’a décrit d’après un individu
apporté à Paris & dépofé dans un cabinet ;
ôn ne peut récufer fon témoignage , & je crois, .,
d’après ces raifons, devoir changer la dénomination
•de corbeau des Indes de Bontius, en celle de calao ,
indiqué par Bontius fous le nom de corbeau des
Indes.
Le calao, dont il s’agit, a du bout du bec à
celui de la queue , deux pieds quatre pouces ,
deux pieds dix pouces de vol ; fon bec eft de cinq
•pouces de long & de deux pouces d’épaifleur à
■ fon origine ; il eft d’une couleur cendrée-noirâtre,
moins profondément dentelé fur les bords de la
portion fupérieure que fur ceux de l’inférieure , &
moins fur ceux de l’une & de l’autre que ne l’eft
ordinairement' le bec des autres calaos. Au-deflus
du demi - bec fupérieur s’élève une excroiffance
cornée , plate en-deflus, peu élevée, arrondie
en arrière ; cette portion arrondie eft blanchâtre
& déborde le derrière de la tête ; les pieds font
d’un gris-brun &. les ongles noirs. Quant au plumage,
il eft fort fombre ; le marron , mais terne,
6c le gris tirant fur le brun mêlé de noirâtre , en
font les couleurs dominantes; la première fur-le
deflus du corps, la fécondé fur la poitrine & fur
le ventre ; la partie fupérieure de la tête , les
joues & la gorge font noirâtres : une bande en
demi cercle d’un gris-fale, dont la çonçavité eft
Hijloire Naturelle, Tome I,
tournée du côté de la tête , entoure la gorge :
le derrière de la tête & le haut du cou font d’un
marron - clair : les grandes plumes des ailes font
noires ; les moyennes le font aüffi , mais leur bord
externe eft bordé de gris : la queue eft compofée
de douze plumes toutes à-peu-près d’égale longueur
& d’un gris-fale. On trouve cet oifeau aux
Moluques , où il fe nourrir de'mufcades. Il fait
partie de la colleélion appartenant à M. l’abbé
Aubry, chez lequel je l’ai vu.
C o r b e a u v a r ié . Voyeç C o r b e a u .
CORBEGEAU. Voyeç C o u r l is .
CORBICHET. Voye^ C o u r l i s .
CORBIGEAU. Voye{ C o u r l i s .
CORBILLATS. Ce font les petits du corbeau:
Voyer CORBEAU.
CORBIN. Vieux langage. Voye\[ C o rb eau.
CORBINE ou CORNEILLE NOIRE.
Corneille. Br is s . tom. //, page 12.
Idem, PL enl. 483.
Be l l . Hift. nat. des o i f . pag. 281 , fig. p , 282^
Idem , port, d’oif. pag. 68.
Cornix en Latin ;
Corneia en Efpagnol ;
Cornice , cornacchia , gràcchia en Italien *,
Hauff-kraee , krah, 6*c. en Allemand ;
Crow , carrion-crow , common-crow en AngloiS#
En vieux François graille, graillât, Sc fuivant
M. de Salerne , grolle en Touraine ; agrôlle en
Bourbonnois; couale en Sologne ; couardn Berri ;
crouas en Auvergne & en Piémont.
La corbine â beaucoup de rapports avec le
_corbéau ;* elle n’en diffère à l’extérieur que par la
grandeur ; elle eft d’un tiers environ plus petite ;
ces deux oifeaux fe rapprochent aufli par un grand
nombre d’habitudes ; tous ces traits de reuem-
blance juftifient le fentiment de M. Briflbn qui les
a rangés tous deux dans le X IV e genre de fa
méthode.
La corbine a dix-huit pouces du bout du bec à
celui de la queue , & trois pieds de vol ; tout fon
plumage eft d’un noir - Violet ; la première plume
de l’aile eft plus courte que la fécondé & la qua-^
trièrtie en eft la plus longue ; l’iris eft couleur de
noifette ; le bec ; les pieds & les ongles font
noirs.
Pendant l’automne & l’hiver, la corbine fe tient
durant la journée fur les terres labourées, & fur-
tout fur celles qui ont été nouvellement remuées
, par la charrue ; elle fuit aufli les laboureurs & les
troupeaux ; là recherche des vers, des infeâes,,
des grains, font le motif de fes mouvemens ; car ,
comme le corbeau , elle fe nourrit de tous les ali—
mens qu’elle peut trouver, & elle eft comme lui
omnivore. Le foir , une heure à-peu-près avant le
coucher du fbleil , ' les corbines qui ont pafle la
journée en troupes 8t pêle-mêle avec deux autres
efpèces de coméilles , fe raflemblent, forment des
bandés , prennent leur efîor & regagnent ou quelques
bpi§' QU forets , ou ÜU moins des parcs où il
K k k k