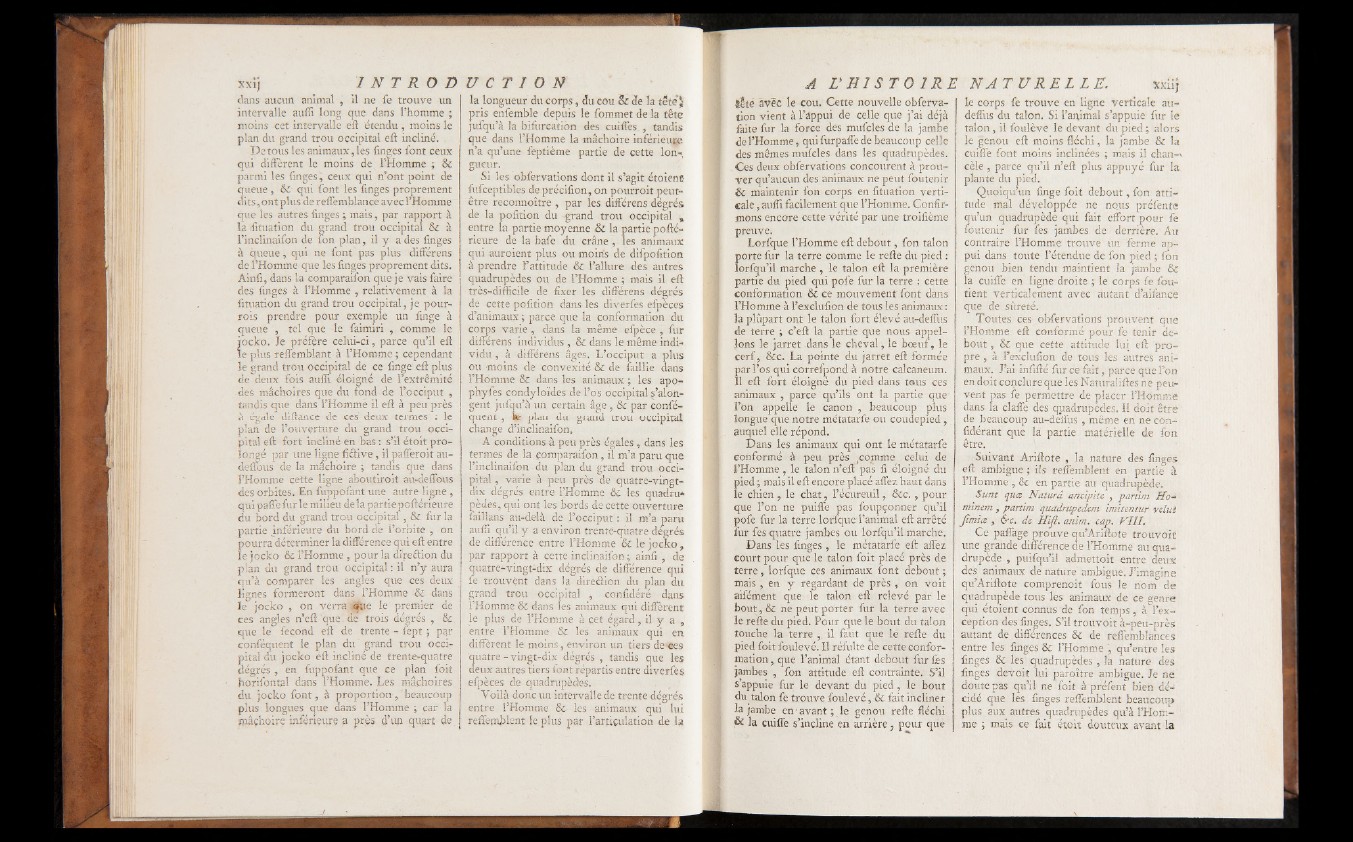
dans aucun animal , il ne fe trouve un
intervalle auffi long que dans l’homme ;
moins cet intervalle eft étendu , moins le
plan du grand trou occipital eft incliné. .
De tous les animaux, les linges font ceux
qui diffèrent le moins de l’Homme ; &
parmi les linges j ceux qui n’ont point de
queue, & qui font les linges proprement
dits, ont plus de reffemblance avec l’Homme
que les autres linges ; mais, par rapport à
la ilituation du grand trou occipital & à
l ’inclinaifon de Ion plan, il y a des linges
à queue, qui ne font pas plus différens
de l’Homme que les linges proprement dits.
Ainfi, dans la comparaifon que je vais faire
des linges à l’Homme , relativement à la
fituation du grand trou occipital, je pour-
rois prendre pour exemple un linge à
queue , tel que le faimiri , comme le
jocko. Je préfère celui-ci, parce qu’il eft
le plus relfemblant à l’Homme ; cependant
le grand trou occipital de ce linge eft plus
de deux fois auffi. éloigné de l’extrémité
des mâchoires que du fond de l’occiput ,
tandis que dans l’Homme il eft à peu près
à égale diftance de ces deux termes" : le
plan de l’ouverture du grand trou occipital
eft fort incliné en bas : s’il étoit prolongé
par une ligne fiftive, il pafferoit au-
delfous de la mâchoire ; tandis que dans
l’Homme cette ligne aboutiroit au-delfous
des orbites. En fuppofant une autre ligne ,
qui paffe fur le milieu de la partie poftérieure
du bord du grand trou occipital, & fur la
partie ^inférieure du bord de l’orbite , on
pourra déterminer la différence qui eft entre
le jocko & l’Homme, pour la dïreâion du
plan du grand trou occipital : il n’y aura
qu’à comparer les angles que ces deux
lignes formeront dans l’Homme & dans
le jocko , on verra ique le premier de
ces angles n’elî: 'que. de trois dégrés , &
que le fécond eft de trente - fept ; par
çonféquent le plan du' grand trou occipital
du jocko éft incliné de trente-quatre
dégrés , en fuppofant que ce plan foit
horifontal dans l’Homme. Les mâchoires
du jocko fo n t, à proportion, beaucoup
plus longues que dans l ’Homme ; car la
mâchoire inférieure a près d’un quart de.
la longueur du corps, du cou & de la tête J
pris enfemble depuis le fommet de la tête
jufqu’à la bifurcation des cuiffes , tandis
que dans l’Homme la mâchoire inférieure
n’a qu’une feptième partie de cette longueur.
Si les obfervations dont il s’agit étoien{
fufceptibles de précifion, on pourroit peut-
être reconnoître , par les différens dégrés
de la pofition du grand trou occipital »
entre la partie moyenne & la partie poftérieure
de la bafe du crâne , les animaux
qui auroient plus ou moins de difpofition
à prendre l’ attitude & l’allure des autres
quadrupèdes ou de l’Homme ; mais il eft
très-difficile de fixer les différens dégrés
de cette pofition dans les diverfes efpèces
d’animaux ; parce que la conformation du
corps v a r ie , dans la même efpèce , fur
différens individus , & dans le même individu
, à différens âges. L’occiput a plus
ou moins de convexité & de faillie dans
l’Homme & dans les animaux ; les apo-
phyfes condyloïdes de l’os occipital s’aloii-
gent jufqu’à un certain âge, & par confisquent
, le plan du grand trou occipital
change d’inclinaifon.
A conditions à peu près égales , dans les
termes de la comparaifon, il m’a paru que
l’inclinaifon du plan du grand trou occipital
, varie à peu près de quatre-vingt-
dix dégrés entre l’Homme & les quadrupèdes,
qui ont les bords de cette ouverture
faillans au-delà de l’occiput : il m’a paru
auffi qu’il y a environ trente-quatre degrés
de différence entre l’Homme & le jo c k o ,
par rapport à cette inclinaifon ; ainfi , de
quatre-vingt-dix dégrés de différence qui
le trouvent dans la direûion du plan du
grand trou occipital , confidéré dans
l’Homme & dans les animaux qui diffèrent
le plus de l’Homme à cet égard, il y a ,
entre l’Homme 8f les. animaux qui en
diffèrent le moins, environ un tiers de-ees
quatre-vingt-dix dégrés, tandis que les
deux autres tiers font répartis entre diverfes
efpèces de quadrupèdes.
Voilà donc un intervalle de trente dégrés
entre l’Homme & les animaux qui lui
reffemblent le plus par l’articulation de la
tête avec le cou. Cette nouvelle obferva-
tion vient à l’âppui de celle que j’ai déjà
faite fur la force des mufcles de la jambe
de l’Homme, qui furpaffe de beaucoup celle
des mêmes mufcles dans les quadrupèdes.
Ces deux obfervations concourent à prouver
qu’aucun des animaux ne peut foutenir
& maintenir fon corps en fituation verticale
, auffi facilement que l’Homme. Confirmons
encore cette vérité par une troifième
preuve.
Lorfque l’Homme eft debout, fon talon
porte fur la terre comme le refte du pied :
lorfqu’il marche , le talon eft la première
partie du pied qui pofe fur la terre : cette
conformation & ce mouvement font dans
l’Homme à l’exclufion de tous les animaux :
la plûpart ont le talon fort élevé au-defliis
de terre ; c’eft la partie que nous appelions
le jarret dans le cheval, le boeuf, le
ce rf, &c . La pointe du jarret eft formée
par l’os qui correfpond à notre calcanéum.
Il eft fort éloigné du pied dans tous ces
animaux , parce qu’ils ont la partie que
l ’on appelle le canon , beaucoup plus
longue que notre métatarfe ou coudepied,
auquel elle répond.
Dans les animaux qui ont le métatarfe
conformé à peu près ( comme celui de
l ’Homme , le talon n’eff pas fi éloigné du
pied ; mais il eft encore placé allez haut dans
le chien , le chat, l’écureuil, & c . , pour
que l’on ne puiffe pas foupçonner qu’il
pofe fur la. terre lorfque l’animal eft arrêté
fur fes quatre jambes ou lorfqu’il .marche.
Dans les linges, le métatarfe eft allez
court pour que le talon foit placé près de
terre, lorfque ces animaux font debout ;
mais , en y regardant de près , on voit
aifément que le talon eft relevé par le
bout, & ne peut porter fur la terre avec
le refie du pied. Pour que le bout du talon
touche la terre , il faut que le refte du
pied foit foulevé. Il réfulte de cette conformation
, que l ’animal étant debout fur fes
jambes , fon attitude eft contrainte. S’il
s’appuie fur le devant du pied, le bout
du talon fe trouve foulevé, & fait incliner
la jambe en'avant; le genou refte fléchi
& la cuiffe s’incline en arrière, pour que
le corps fe trouve en ligne verticale au-
deffus du talon. Si l’animal s’appuie fur le
talon, il foulève le devant du pied ; alors
le "genou eft moins fléchi, la jambe & la
cuiffe font moins inclinées ; mais il chancèle
, parce qu’il n’eft plus appuyé fur la
plante du pied.
Quoiqu’un finge foit debout, fon attitude
mal développée ne no.us préfente
qu’un quadrupède qui fait effort pour fe
, foutenir fur fes jambes de derrière. Au
contraire l’Homme trouve un ferme appui
dans toute l’étendue de fon pied ; fon
genou bien tendu maintient la jambe &
la cuiffe en ligne droite ; le corps fe fou-
tient verticalement avec autant d’aifance
que de sûreté.
Toutes ces obfervations prouvent cme
l’Homme eft conformé pour fe tenir debout
, & que cette attitude lui eft propre
, à l’exclufion de tous les autres animaux.
J’ai infifté fur ce fa it, parce que l ’on
en doit conclure que les Naturaliftes ne peuvent
pas fe permettre de placer l’Homme
dans la clalfe des quadrupèdes. Il doit être
de beaucoup au-deffus ,,même ennecon-
fidérant que la partie matérielle de fon
être.
Suivant Ariftote , la nature des linges
eft ambiguë ; ils reffemblent en partie à
l’Homme , Sc en partie au quadrupède.
Sunt qua Natura ancipite , partim Ho-
minem , partim quadrupedcm imitmtur velut
fimicz y &c. de. Hiß. anirn. cap. VIII.
Ce paffage prouve qu’Ariftote trouvoit
une grande différence de l’Homme au quadrupède
, puifqu’il admettoit entre deux
des animaux de nature' ambiguë. J’imagine
qu’Ariftote comprenoit fous le nom de
quadrupède tous les animaux de ce genre
qui étoient connus de fon temps, à l’exception
des linges. S’il trouvoit à-peu-près
autant de différences & de reffemblances
entre les finges & l’Homme ', qu’entre les
finges & les quadrupèdes , la nature des
finges devait lui paroître ambiguë. Je ne
doute pas qu’il ne foit à préfent bien décidé
que les finges reffemblent beaucoup
plus aux autres quadrupèdes qu’à l’Homme
; mais ce fait étoit douteux avant la