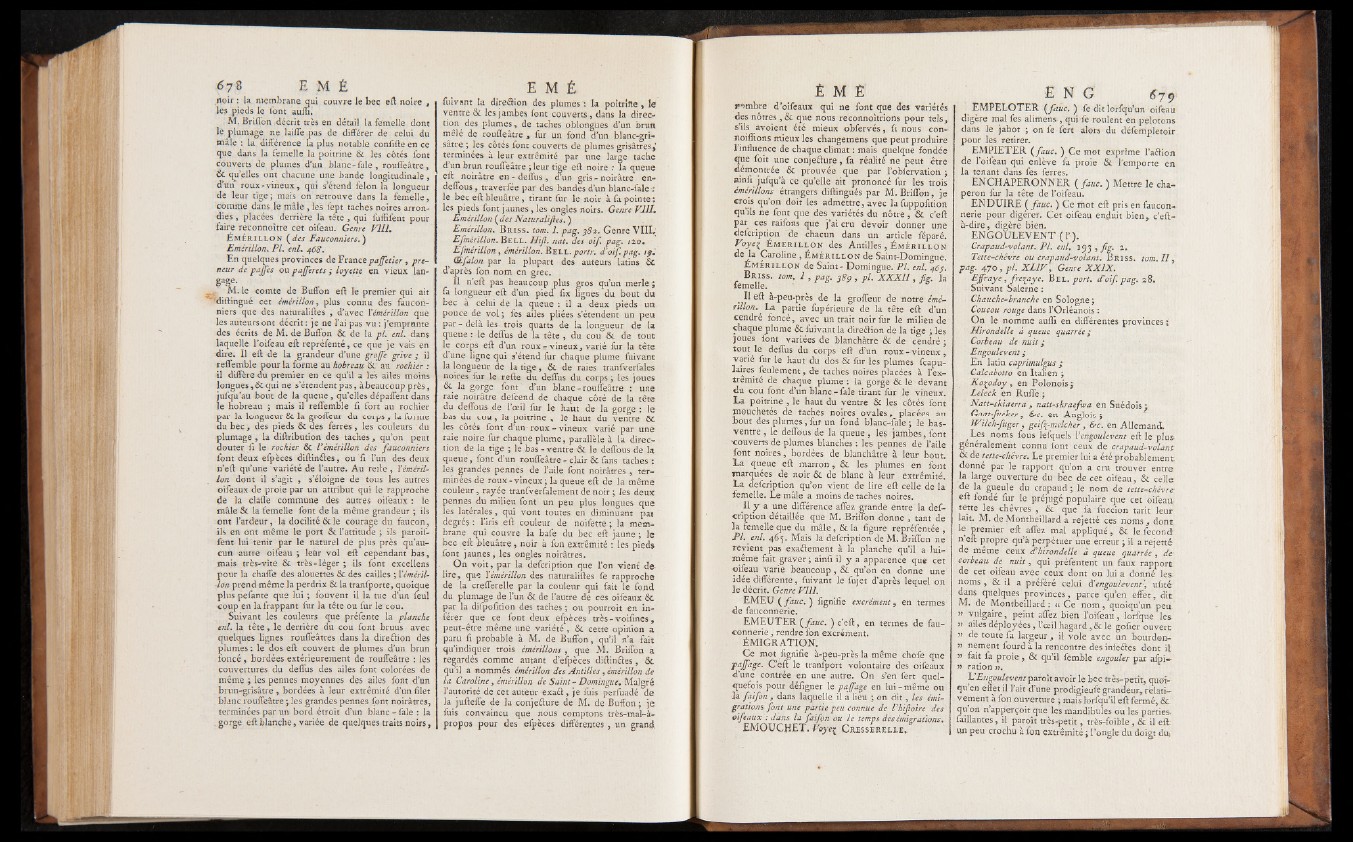
n o ir : la m em b r a n e q u i c o u v r e le b e c e f t n o ir e ,
le s p ied s le io n t au fli.
M. Briffon décrit très en détail la femelle dont
le plumage ne laiffe pas de différer de celui du
mâle : la différence la plus notable confifte en ce
que dans la femelle la poitrine les cotés font
couverts de plumes d’un blanc - fale , rouffeâtre ,
& qu’elles ont chacune une bande longitudinale ,
d’un roux-vineux, qui détend félon la longueur
de leur tige ; mais on retrouve dans la femelle,
comme dans le mâle , les fept taches noires arrondies
, placées derrière la tête, qui fuffifent pour
faire reconnoître cet oifeau. Genre Vlll.
Émérillon ( des Fauconniers. )
Emérillon. PL enL 468.
En quelques provinces de France paffetier, preneur
de pajfes ou pafferets 3 loyette en vieux langage*
r M.le comte de Buffon eft le premier qui ait
Miftingué cet émérillon, plus connu des fauconniers
que des naturalises , d’avec Xémérillon que
les auteurs ont décrit : je ne l’ai pas vu : j’emprunte
des écrits de M. de Buffon & de la pl. enl. dans
laquelle l’oifeau eft repréfenté, ce que je vais en
dire. Il eft de la grandeur d’une grojfe grive ; il
reffemble pour la forme au hobreau Ôc au roehier :
il diffère du premier en ce qü’il a les ailes moins
longues, & qui ne s’étendent pas , à beaucoup près,
jufqu’au bout de la queue, qu’elles dépaffent dans
le hobreau ; mais il reffemble fi fort au roehier
par la longueur & la groffeur du corps , la forme
du bec, des pieds & des ferres , les couleurs du
plumage, la diftribution des taches, qu’on peut
douter fi le roehier & Vémérillon des fauconniers
font deux efpèces diftinâes, ou fi l’un des deux
n’eft qu’une variété de l’autre. Au refte , Xémérillon
dont il s’agit , s’éloigne de tous les autres
oifeaux de proie par un attribut qui le rapproche
de la claffe commune des autres oifeaux : le
mâle & la femelle font de la même grandeur ; ils
ont l’ardeur, la docilité & le courage du faucon,
ils en ont même le port & l’attitude ; ils paroif-
fent lui tenir par le naturel de plus près qu’aucun
autre oifeau ; leur vol eft cependant Bas,
mais très-vite & très-léger ; ils font excellens
pour la chaffe des alouettes & des cailles ; X émérillonprend
même la perdrix & la tranfporte, quoique
plus pefante que lui ; fouvent il la tue d’un feul
coup en la frappant fur la tête ou fur le cou.
Suivant les couleurs que préfente la planche
enl. la fête, le derrière du cou font bruus avec
quelques lignes rouffeâtres dans la direéfion des
plumes: le dos eft couvert de plumes d’un brun
foncé , bordées extérieurement de rouffeâtre : les
couvertures du deffus des ailes font colorées- de
même ; les pennes moyennes des ailes font d’un
brun-grisâtre, bordées à leur extrémité d’un filet
blanc rouffeâtre ; les grandes pennes font noirâtres,
terminées par un bord étroit d’un blanc - fale : la
. gorge eft blanche, variée de quelques traits noirs,
fuivant la direftion des plumes : la poitrine , le
ventre &. les jambes font couverts, dans la direction
des plumes, de taches oblongues d’un brun
mêlé de rouffeâtre , fur un fond d’un blanc-grisâtre
; les côtés font couverts de plumes grisâtres,’
terminées à leur extrémité par une large tache
d un brun rouffeâtre jleur tige eft noire : la queue
eft noirâtre en-deffus, d’un gris - noirâtre en-
deffous, traverfée par des bandes d’un blanc-fale :
le bec eft bleuâtre, tirant fur le noir à fa pointe :
les pieds font jaunes, les ongles noirs. Genre V lll•
Emérillon (des Naturalises. )
Emérillon. B r i s s . tom. 1. pag. 382. Genre VIII;
Efmèrillon. B e l l . Hiß. nat. des oif. pag. /20.
Efmèrillon, émérillon. B e l l .portr. d’oij.pag. /<?.'
OEfalon par la plupart des auteurs latins ÔC
d’après fon nom en grec. 11 n’eft pas beaucoup plus gros qu’un merle ;
fa longueur eft d’un pied fix lignes du bout du
bec a celui de la queue : il a deux pieds un
pouce de vol; fes ailes pliées s’étendent un peu
par - delà les-trois quarts de la longueur de la
queue : le deffus de la tête , du cou & de tout
le corps eft d’un roux r vineux, varié fur la tête
d’une ligne qui s’étend fur chaque plume fuivant
la longueur de la tige, &. de raies tranfverfales
noires fur le refte du deffus du corps ; les joues
& la gorge font d’un blanc - rouffeâtre : une
raie noirâtre defeend de chaque coté de la tête
du deffous de l’oeil fur le haut de la gorge : lé
bas clu , cou’ la poitrine , le haut du ventre &
les cotes font d’un-roux-vineux varié par une
raie noire fur chaque plume, parallèle à la direction
de la tige ; le bas - ventre & le deffous de la
queue, font d’un rouffeâtre - clair & fans taches :
les grandes pennes de l’aile font noirâtres , terminées
de roux - vineux ; la queue eft de la même
couleur, rayée tranfverfalement de noir ; les deux
pennes du milieu font un peu plus longues que
les laterales, qui vont toutes en diminuant pai
degrés : l’iris eft couleur de noifette ; la membrane
qui couvre la bafe du bec eft jaune ; le
bec eft bleuâtre, noir à fon extrémité : les pieds
font jaunes, les ongles noirâtres.
On voit, par la defeription que l’on vient de-
lire, que Yémérillon des naturaliftes fe rapproche
de la crefferelle par la couleur qui fait le fond
du plumage de l’un & de l’autre de ces oifeaux &.
par la difpofition des taches; ou pourroit en inférer
que ce font deux efpèces très - voiftnes,
peut-être même une variété, &. cette opinion a
paru fi probable à M. de Buffon, qu’il n’a fait
qu’indiquer trois émérillons , que M. Briffon a
regardés comme autant d’efpèces diftinéles, &
qu’il a nommés émérillon des Antilles, émérillon de
la Caroline 3 émérillon de Saint - Domingue\ Malgré
l’autorité de cet auteur exaét, je fuis perfuadé de
la jufteffe de la conjecture de M. de Buffon ; je
fuis convaincu que nous comptons très-mal-à-
propos pour des efpèces différentes , un grand
t im b r e d 'o ife a u x q u i n e fo n t q u e d e s v a r ié té s
d e s n ô t r e s ,& q u e n o u s re c o n n o îtr io n s p o u r t e l s ,
s ’ils a v o ie n t é té m ie u x o b f e r v é s , fi n o u s c o n -
n o iff io n s m ie u x les c h a n g em e n s q u e p e u t p ro d u ir e
l ’in flu en ce d e c h a q u e c lim a t : m a is q u e lq u e fo n d é e
q u e fo it u n e c o n je é lu r e , fa ré a lité n e p e u t ê t r e
d ém o n t r é e & p ro u v é e q u e p a r l ’o b lè rv a tio n ;
a in f i ju fq ü ’à c e q u ’e lle a it p ro n o n c é fu r le s tro is
émérillons é tra n g e rs d iftin g u é s p a r M . B r i f fo n , je
c ro i s q u ’o n d o i t les a dm e t t r e , a v e c la fu p p o fitio n
q u ’ils n e fo n t q u e d e s v a r ié té s d u n ô t re , & c’e ft
p a r ces ra ifo n s q u e j ’ai c ru d e v o ir d o n n e r u n e
d e fe r ip tio n d e c h a cu n d a n s u n a r tic le fép a ré .
Voyeç Émérillon d e s A n tille s , Émérillon
d e 1* C a ro lin e , Émérillon d e S a in t-D om in g u e .
Émérillon de Saint - Domingue. PI. enl. 463.
B r i s s . tom, 1 , pag. 389 , pl. X X X I I , fig. la
femelle.
* Il eft à-peu-près de la groffeur de notre «W-
rillon. La partie fupérieure de la tête eft d’un
cendre foncé, avec un trait noir fur le milieu de
chaque plunie & fuivant la direftion de la tige ; les
joues font variées de blanchâtre & de cendré ;
tout le deffus du corps eft d’un roux - vineux,
varie fur le haut du dos & fur les plumes feapu-
Ates. ^e u l em e n t , d e ta c h e s n o ire s p la c é e s à l’e x -
trem ite d e c h a q u e p lum e -: la g o rg e & le d e v a n t
d u c o u fo n t d ’u n b la n c - fale t ir a n t fu r le v in e u x .
L a p o itr in e , le h a u t d u v e n tr e & les c ô té s fo n t
m o u c h e té s d e ta c h e s n o ire s o v a l e s , p la c é e s au
b o u t des p lum e s , fu r u n fo n d b la n c - fa le ; le b a s -
v e n t r e , le deffous de la q u e u e , le s j am b e s , fo n t
'c o u v e r ts d e p lum e s b lan ch e s : les p e n n e s d e l’a ile
f o n t n o i r e s , b o rd é e s d e b la n c h â tre à le u r b o u t .
L a q u e u e e f t m a r r o n , & les p lum e s e n fo n t
m a rq u é e s d e n o i r & d e b la n c à le u r e x tr ém ité .
L a d e fe r ip tio n q u ’o n v i e n t d e l ir e e f t c e lle d e la
fem e lle . L e m â le a m o in s d e tach e s n o ire s .
I l y a u n e diffé ren c e affez g ra n d e e n tr e la defe
r ip t io n d é ta illé e q u e M . B riffon d o n n e , t a n t de
la fem e lle q u e d u m â l e , & la figure r e p ré fe n té e ,
Pl. enl. 4 6 5 . M a is la d e fe r ip tio n d e M . Briffon n e
r e v i e n t p a s e x a& em e n t à la p la n c h e q u ’il a lu i-
m êm e fa it g r a v e r ; a infi il y a a p p a re n c e q u e c e t
o ife a u v a r ie b e a u c o u p , & q u ’o n e n d o n n e u n e
id é e d i f f é re n te , fu iv a n t le fu je t d ’a p rè s le q u e l o n
le d é c r it. Genre Vlll.
EMEU ( fauc. ) lignifie excrément, en termes
de fauconnerie.
E M E U T E R ( fauc. ) c’e f t , e n te rm e s d e fauc
o n n e r ie , r e n d r e fo n e x c rém e n t.
ÉMIGRATION.
Ce mot fignifie à-peu-près la même chofe que
patfage. C’eft le transport volontaire des oifeaux
d’une contrée en une autre. On s’en fert quelquefois
pour défigner le pajfage en lui-même ou
la faifon , dans laquelle il a lieu ; on dit, les émigrations
font une partie peu connue de Vhifoire des
oifeaux : dans la faifon ou le temps des émigrations.
EMOUCHET. Voyei C r e s s e r e l l e *
EMPELOTER (fauc. ) fe dit lorfqu’un oifeau
digère mal fes alimens , qui fe roulent en pelotons
dans le jabot ; on fe fert alors du défempletoir
pour les retirer.
EMPIETER (fauc. ) Ce mot exprime l’aélion
de l’oifeau qui enlève fa proie & l'emporte en
la tenant dans fes ferres.
ENCHAPERONNER ( fauc. ) Mettre le chaperon
fur la tête de l’oifeau.
ENDUIRE ( fauc. ) Ce mot eft pris en fauconnerie
pour digérer. Cet oifeau enduit bien^ c’eft-
à-dire, digère bien.
ENGOULEVENT ( !’ ).
Crapaud-volant. Pl. enl. 193 , fig. 2.
Tette-chêvre ou crapaud-volant. Briss. tom. I l ,
pag. 4 7 0 , pl. XL1V , Genre XXIX.
Effraye, {repaye. B e l . port, d’oif. pag. 28.
Suivant Salerne :
Chauche-branche en Sologne ;
Coucou rouge dans l’Orléanois :
On le nomme aufïi en différentes provinces i
Hirondelle d queue quarrèe 3
Corbeau de nuit 3
Engoulevent 3
En latin caprimulgus 3
Calcabotto en Italien ;
Koçodoy, en Polonois 3
Leleck en Ruffe ;
Natt-skiaerrd, natt-skraefwa en Suédois :
Goat-fueker, &c. en Anglois ;
fVilch-fuger, geifymelcher, &c. en Allemand.
t Les noms fous léfquels Xengoulevent eft le plus
généralement connu font ceux de crapaud-volant'
& de tette-chêvre. Le premier lui a été probablement
donné par le rapport qu’on a cru trouver entre
la large ouverture du bec de cet oileau, & celle
de la gueule du crapaud ; le nom de tette-chêvre'
eft fondé fur le préjugé populaire que cet oifeau
tette les chèvres , & que fa fuccion tarit leur
lait. M. de Montbeillard a rejetté ces noms , dont
le premier eft affez mal appliqué , & le fécond
n eft propre qu’à perpétuer une erreur ; il a rejetté
de meme ceux dlhirondelle à queue quarrée , de
corbeau de nuit, qui préfentent un faux rapport
de cet oifeau avec ceux dont on lui a donné les.
noms , & il a préféré celui d'engoulevent^ ufité
dans quelques provinces, parce qu’en effet, dit
M. de Montbeillard : « Ce nom, quoiqu’un peu
y> vulgaire, peint affez bien l’oifeau, lorfque les-
n ailes déployées, l’oeil hagard, & le gofier ouvert
n de toute fa largeur , il vole avec un bourdon-
» nement fourd a la rencontre des infeâes dont il
y> fait fa proie, & qu’il femble engouler par afpi—
» ration ».
Engoulevent paroit avoir le bec très-petit, quoî-
qu en effet il l’ait d’une prodigieufe grandeur, relativement
a fon ouverture ; mais lorfqu’il eft fermé,. &c
qu on n’apperçoit que les mandibules ou les parties,
faillantes, il paroît très-petit, très-foible , & il eft:
un peu crochu a fon extrémité ; l’ongle du doigt du»
m