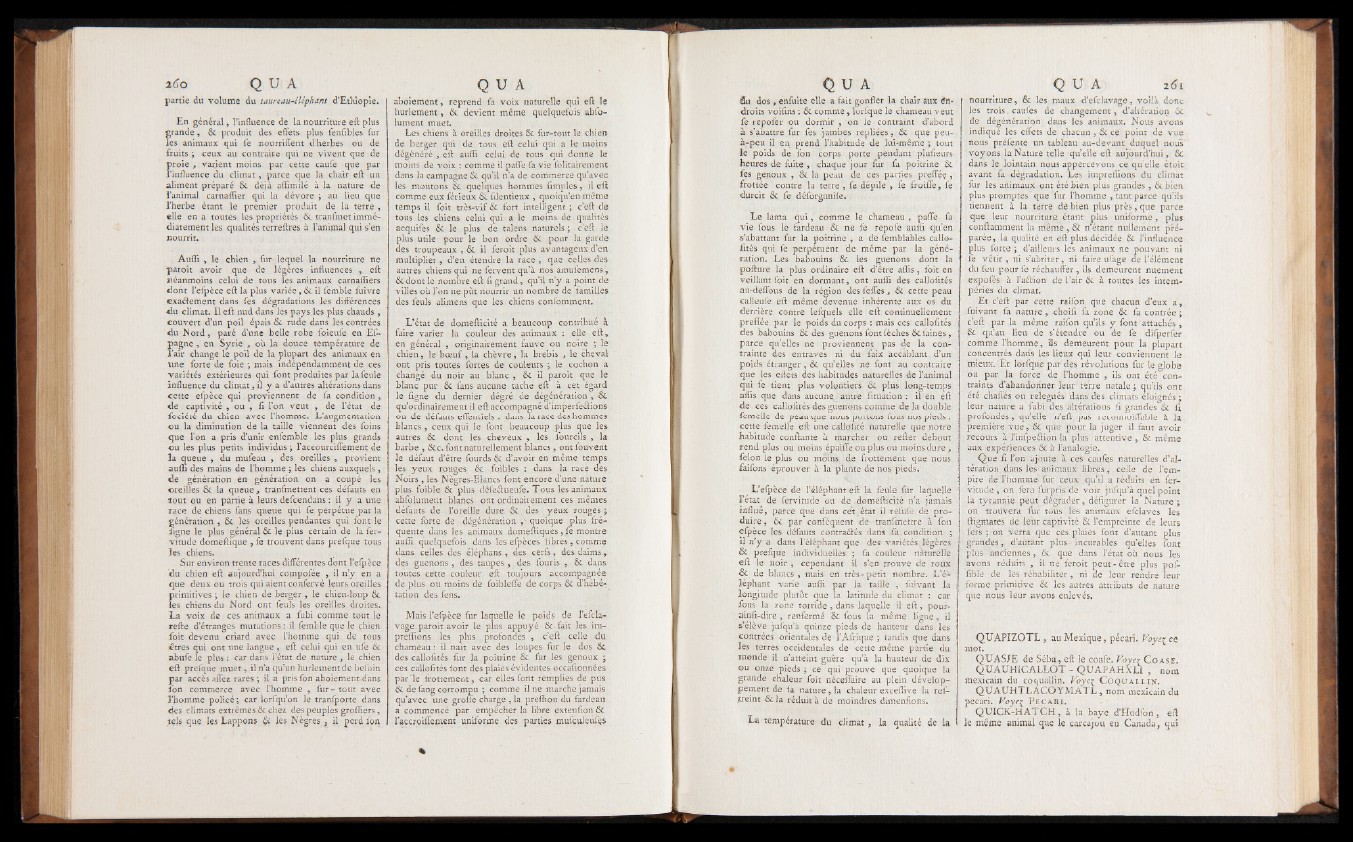
partie du volume du taureau-éléphant d’Ethiopie.
En général, l’influence de la nourriture eft plus
grande, 8c produit des effets plus fenfibles fur
les animaux qui fe nourriflent 'd’herbes ou de
fruits ; ceux au contraire qui ne vivent que de
proie , varient moins par cette caufe que par
l’influence du climat, parce que la chair eft un
aliment préparé & déjà aflimilé à la nature de
l’animal carnaflier qui la dévore ; au lieu que
l’herbe étant le premier produit de la terre ,
elle en a toutes les propriétés 8c tranfmet immédiatement
les qualités terreftres à l’animal qui s’en
nourrit.
Aufli , le chien > fur lequel la nourriture ne
paroît avoir que de légères influences , eft
néanmoins celui de tous les animaux carnafliers
dont l’efpèce eft la plus variée, & il femble fuivre
exactement dans fes dégradations les différences
du climat. Il eft nud dans les pays les plus chauds ,
couvert d’un poil épais 8c rude dans les contrées
du Nord, paré d’une belle robe foieufe en Espagne
, en Syrie , où la douce température de
l’air change le poil de la plupart des animaux en
une forte de foie ; mais indépendamment de ces
variétés extérieures qui font produites par la feule
influence du climat, il y a d’autres altérations dans
cette efpèce qui proviennent de fa condition,
de captivité , ou , fi l’on veut , de l’état de
fociété du chien avec l’homme. L’augmentation
ou la diminution de la taille viennent des foins
que l’on a pris d’unir enfemble les plus grands
ou les plus petits individus ; l’aceourciflement de
la queue , du mufeau , des oreilles , provient
auili des mains de l’homme ; les chiens auxquels ,
de génération en génération on a coupé les
oreilles 8c la queue , tranfmettent ces défauts en
tout q u en partie à leurs defcendans : il y a une
race de chiens fans queue qui fe perpétue par la
génération , 8c les oreilles pendantes qui font le
ligne le plus général 6c le plus certain de la fer-
vitude domeftique , fe trouvent dans prefque tous
les chiens.
Sur environ trente races différentes dont l’efpèce
du chien eft aujourd’hui compofée , il n’y en a
que deux ou trois qui aient confervé leurs oreilles
primitives ; le chien de berger , le chien-loup 8c
les chiens du Nord ont feuls les oreilles droites.
La voix de ces animaux a fubi comme tout le
refte d’étranges mutations : il femble que le chien
foit devenu criard avec l’homme qui de tous
«très qui ont une langue, eft celui qui en ufe &
abufe le plus : car dans l’état de nature , le chien
eft prefque muet, il n’a qu’un hurlement de befoin
par accès allez rares ; il a pris fon aboiement.dans
ion commerce avec l’homme , fur-tout avec
l’homme policé ; car lorfqu’on le tranfporte dans
des climats extrêmes 8c chez des peuples grofliers,
tels que les Lappons St les Nègres 9 il perd fon
aboiement, reprend fa voix naturelle qui eft le
hurlement, & devient même quelquefois abfo-
himent muet.
Les chiens à oreilles droites 8c fur-tout le chien
de berger qui de tous eft celui qui a le moins
dégénéré , eft aufli celui de tous qui donne le
moins de voix : comme il pafle fa vie folitairement
dans la campagne 8c qu’il n’a de commerce qu’avec
les moutons ëc quelques hommes Amples, il eft
comme eux férieux 6c filentieux , quoiqu’en même
temps il foit très-vif & fort intelligent ; c’eft de
tous les chiens celui qui a le moins de qualités
acquifes 6c le plus de talens naturels ; c’eft le
plus utile pour le bon ordre & pour la garde
des troupeaux , 6c il feroit plus avantageux d’en
multiplier , d’en étendre la race , que celles des
autres chiens qui ne fervent qu’à nos amufemens ,
& dont le nombre eft fi grand, qu’il n’y a point de
villes où l’on ne-pût nourrir un nombre de familles
des feuls alimens que les chiens confomment.
L’état de domefticité a beaucoup contribué à
faire varier la couleur des animaux : elle eft,
en général , originairement fauve ou noire ; le
chien, le boeuf , la chèvre, la brebis , le cheval
ont pris toutes fortes de couleurs ; le cochon a
changé du noir au blanc , 6c il paroît que le
blanc pur 6c fans aucune tache eft à cet égard
le ligne du dernier dégré de dégénération , 6c
qu’ordinairement il eft accompagné d’imperfeélions
ou de défauts eflentiels : dans la race des hommes
blancs , ceux qui le font beaucoup plus que les
autres 6c dont les cheveux , les fourcils , la
barbe , &c. font naturellement blancs, ontfouvent
le défaut d’être fourds & d’avoir en même temps
les yeux rouges & foibles : dans la race des
Noirs , les Nègres-Blancs font encore d’une nature
plus foible & plus défeclueufe. Tous les animaux
abfolument blancs ont ordinairement ces mêmes
défauts de l’oreille dure. 6c des yeux rouges ;
cette forte de dégénération ^ quoique plus fréquente
dans les animaux domeftiques , fe montre
aufli quelquefois dans les efpèces libres, comme
dans celles des éléphans , des cerfs, des daims,
des guenons , des taupes , des fouris , 6c dans
toutes cette couleur eft toujours accompagnée
de plus ou moins de foiblefle de corps 6c d’hébé-
tation des fens.
Mais l’efpèce fur laquelle le poids de l’efcîa-
vage paroît avoir le plus appuyé & fait les im-
preflions les plus profondes , c’eft celle du
chameau : il nait avec des loupes fur le dos 6c
des callofités fur la poitrine 6c fur les genoux ;
ces callofités lont des plaies évidentes occafionnées
parle frottement, car elles font remplies de pus
6c de fang corrompu ; comme il ne marche jamais
qu’avec une grofle charge , la preflion du fardeau
a commencé par empêcher là libre extenfion 8c
l’accroiflement uniforme des parties mufculeufes
€u dos, éftfuite elle a fait gonfler la chair aux Endroits
voifins : 6c comme, lorfque le chameau veut
fe repofer ou dormir , on le contraint d’abord
à s’abattre fur fes jambes repliées, 6c que peu-
à-peu il en prend l’habitude de lui-même ; tout
le poids de fon corps porte pendant plufieurs
heures de fuite , chaque jour fur fa poitrine 6c
fes genoux , 6c la peau de ces parties prefleç ,
frottée contre la terre , fe dépile , fe froifle, fe
durcit 6c fe déforganife.
Le lama qui, comme le chameau , pafle fa
vie fous le fardeau 6c ne fe repofe auili qu’en
s’abattant fur la poitrine , a de lemblables callofités
qui fe perpétuent de même par la génération.
Les babouins & les guenons dont la
pofture la plus ordinaire eft d’être aflis, foit en
veillant foit en dormant, ont aufli des callofités
au-deflous de la région des fefles, 6c cette peau
calleufe eft même devenue inhérente aux os du
derrière, contre lefquels elle eft continuellement
preflee par le poids du corps : mais ces' callofités
des babouins 6c des guenons font fèches & faines,
farce qu’elles ne proviennent pas de la contrainte
des entraves ni du faix accablant d’un
poids étranger, 6c qu’elles ne font au contraire
que les effets des habitudes naturelles de l’animal
qui fe tient plus volontiers 6c plus long-temps
aflis que dans aucune, autre fituation : il en eft
de ces callofités des guenons comme de la double
femelle de peau que nous portons fous nos pieds :
cette femelle eft une callofité naturelle que notre
habitude confiante à marcher ou relier debout
rend plus ou moins épaifle ou plus ou moins dure ,
félon le plus ou môinsv de frottement que nous
faifons éprouver à la plante de nos pieds.
L’efpèce de l’éléphant eft la feulé fur laquelle
letat de fervitude ou de ,domefticité n’a jamais
influé, parce que dans cet état ii refufe de produire,
6c par conféquent de tranfmettre à fon
efpèce les défauts contrariés dans fa,condition •
il n’y a dans l’éléphant que des variétés légères
&c prefque individuelles ; fa couleur naturelle
eft le noir , cependant il s’en trouve de roux
6c de blancs , mais en très-petit nombre. L’éléphant
varie aufli par la taille , fuivant la
longitude plutôt que la latitude du climat : car
fous la zone torride , dans laquelle il eft, pour-
ainfi-dire, renfermé '6c fous la même ligne, il
s’élève jufqu’à quinze pieds de hauteur dans les
contrées orientales de l’Afrique ; tandis que dans
les terres occidentales de cette même partie du
inonde il n’atteint guère qu’à la hauteur de dix
ou onze pieds ; ce qui prouve que quoique la
grande chaleur foit nécelfaire au plein développement
de fa nature, la chaleur exceflive la ref-
treint & la réduit à de moindres dimenfions.
La température du climat, la qualité de la
nourriture, 6c les maux d’efclavage, voilà donc
les trois. caufes de changement, d’altération 8c
de dégénération dans les animaux. Nous avons
indiqué les effets de chacun, 8c ce point de vue
nous préfente un tableau au-devant duquel nous”
voyons la Nature telle quelle eft aujourd’hui, 6c
dans le lointain nous appercevons ce qu elle étoit
avant fa dégradation. Les impreflions du climat
fur les animaux ont été bien plus grandes , 8c bien
plus promptes ’ que fur l’homme , tant parce qu’ils
tiennent à la terre dè bien plus près, que parce
que leur nourriture étant plus uniforme, plus
conftamment la m'ême , & n’étant nullement préparée,
la qualité en eft plus décidée 6c l’influence
plus forte ; d’ailleurs les animaux ne pouvant ni
fe vêtir , ni s’abriter, ni faire ufage de l’élément
du feu pour fe réchauffer , ils demeurent nuement
expofés à l’aélion1 de l ’air 8c à toutes les intempéries
du climat.
Et c’eft par cette raifort que chacun d’eux a ,
fuivant fa nature , choifl fa zone 6c fa contrée ;
c’eft, par la même raifon qu’ils y font attachés , 6c qu’au lieu de s’étendre ou de fe difperfer
comme l’homme, ils demeurent pour la plupart
concentrés dans les lieux qui leur conviennent le
mieux. Et lorfque par des révolutions fur le globe
ou par la force de l’homme , ils ont été contraints
d’abandonner leur terre natale; qu’ils ont
été chafl’és ou relégués dans, des climats éloignés ;
leur nature a fubi des altérations fl grandes 8c fi
profondes, qu’elle n’eft pas reconnoiflable à la
première vue, 8c que pour la juger il faut avoir
recours à l’inipeilion la plus attentive , 8c même
aux expériences 8c à l’analogie.
Que fi l’on. ajoute à ces caufes naturelles d’altération
dans, les: animaux libres , celle de l’empire
de Thomme: fur ceux qu’il a réduits en fervitude
, on fera fùrpris de voir jufqu’à quel point
la tyrannie peut dégrader, défigurer la Nature ;
on trouvera fur tous. les animaux efclaves les
ftigmates de leur captivité 6c l’empreinte de leurs
fers ; on verra que ces plaies font d’autant plus
grandes, d’autant plus- incurables qu’elles font
plus anciennes, 8c que dans l’état où nous les
avons réduits , il ne feroit peut - être plus pot-
fible de les réhabiliter, ni de leur rendre leur
forme primitive 8c- les autres attributs de nature
que nous leur ayons enlevés.
QUAPIZOTL , au Mexique, pécari. Voye^ ce
mot.
QU A S JE de Séba, eft le coafe. Voyez C o a s e .
QUAUHICALLOT - QUAPAHXLI , nom
mexicain du coquallin. Voye£ C o q u a l l in .
QUAUHTLACOYMATL, nom mexicain du
pécari. Voyeç P é c a r i .
QUICK-H A T CH , à la baye d’Hudfon , eft
le même animal que le carcajou en Canada, qui