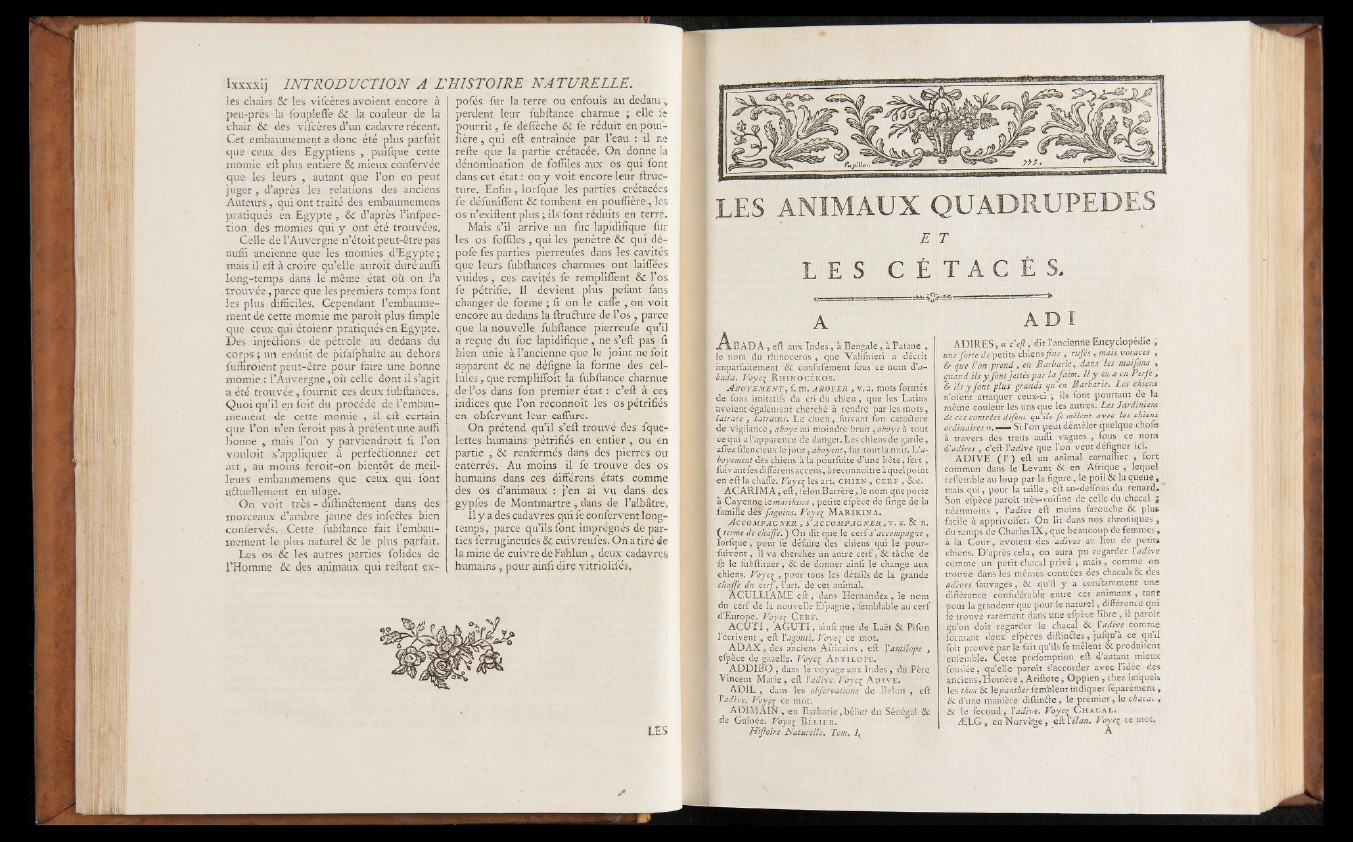
Ixxxxij IN TRO D U C T IO N A L\
les chairs &c les vilcères avoient encore à
peu-près la fouplefle & la couleur de la
chair 6c des vilcères d’un cadavre récent.
Cet embaumement a donc été plus parfait
que ceux des Egyptiens , puifque cette
momie eft plus entière & mieux confervée
que les leurs , autant que l’on en peut
ju g e r , d’après les relations des anciens
Auteurs, qui ont traité des embaumemens
pratiqués en Egypte , & d’après l’infpec-
tion des momies qui y ont été trouvées.
Celle de l’Auvergne n’étoit peut-être pas
auffi ancienne que les momies d’Egypte;
mais il eft à croire qu’elle auroit duré auffi
long-temps dans le même état bù on l’a
trouvée, parce que les premiers temps font
les plus difficiles. Cependant l’embaumement
de cette momie me paroît plus fimple
que ceux qui étoienr pratiqués en Egypte.
Des injections de pétrole au dedans du
corps ; un enduit de pifafphalte au dehors
fuffiroient peut-être pour faire une bonne
momie : l’Auvergne, oii celle dont il s’agit
a été trouvée, fournit ces deux fubftances.
Quoi qu’il en foit du procédé de l’embaumement
de cette momie , il eft certain
que l’on n’en feroit pas à préfent une auffi
bonne , mais l’on y parviendroit û l ’on
vouloit s’appliquer à perfectionner cet
a r t , au moins feroit-on bientôt' de meilleurs
embaumemens que ceux qui lont
adluellement en ufage.
On voit très - diftinûement dans des
morceaux d’ambre jaune des infeûes bien
çonfervés. Cette fubftance fait l’embaumement
le plus naturel & le plus parfait.
Les os & les autres parties foüdes de
l ’Homme &: des animaux qui relient gx-
' HISTOIRE N A TU R E L L E .
pofés fur la terre ou enfouis au dedans,
perdent leur fubftance charnue ; elle fe
pourrit, fe defîèche & fe réduit en pouf-
fière, qui eft entraînée par l’eau : il ne
relie que la partie crétacée. On donne la
dénomination de foffiles aux os qui font
dans cet état : on y voit encore leur ftruc-
tiire. Enfin, lorfque les parties crétacées
fe défunilfent & tombent en pouffière, les
os n’exiftent plus ; ils font réduits en terré.
Mais s’il arrive un fuc lapidifique fur
les os foffiles, qui les pénétré & qui dé-
pofe fes parties pierreufes dans les cavités
que leurs fubftances charnues ont lailfées
vuides , ces cavités fe remplilfent & l’os
fe pétrifie. Il devient plus pefant fans
changer de forme ; fi on le cafte , on voit
encore au dedans la ftruélure de l’os. , parce
que la nouvelle fubftance pierreufe qu’il
a reçue du fuc lapidifique, ne s’ell pas fi
bien unie à l’ancienne que le joint ne foit
apparent & ne défigne la forme des cellules,
que remplifloit la fubftance charnue
de l’os dans fon premier état : c’eft à ces
indices que l’on reconnoît les os pétrifiés
en obfervant leur caflitre.
On prétend qu’il s’ell trouvé des ,fque-
lettes humains pétrifiés en entier , ou en
partie , & renfermés dans des pierres ou
enterrés. Au moins il fe trouve des os
humains dans ces différens états comme
des os d’animaux : j’en ai vu dans des
gypfes de Montmartre, dans de l’albâtre.
Il y a des cadavres qui fe confervent longtemps,
parce qu’ils font imprégnés départies
ferrugineufes & cuivreufes. On a tiré de
la mine de cuivre de Fahlun , deux cadavres
humains , pour ainfi clire vitriolifés.
LÈS
/
LES ANIMAUX QUADRUPEDES
E T
L E S C É T A C É S .
A
 .B A D A , eft aux Indes, à Bengale, à Patane ,
le nom du rhinocéros , que Valifnieri a décrit
imparfaitement & confufément fous ce nom. d’<z-
bada. Voye£ Rhinocéros.
A b o y e m e n t , f. m. a b o y e r 3 v.a. mots formés
de fons imitatifs du cri du chien, que les Latins
avoient légalement cherché à rendre par les mots,
latrare 3 Latrâtus. Le chien, fuivant fon caractère
de vigilance, aboyé aii moindre bruit, aboyé à tout
ce qui a l’apparence de danger. Les chiens de garde,
allez filencieux le jour, aboyent, fur-tout la nuit. L'a-
boyement des chiens à la pourfuite d’une bête, fert ,
fuivant fes différens accens, àreconnoître à quel point
■ en eft la chafle. Voyeç les art. chien , cerf , 8cc.
ACARIMA, eft, félon Barrère, le nom que porte
à Cayenne le màrikina , petite efpèce de linge de la
famille dé? fagoins. Voyeç Mariicina.
A c c o m p a g n e r 3 s ’a c c o m p a g n e r , v. a. & n.
( terme de çhajfe. ) On dit que le cerf s'accompagne ,
lorfque, pour fe défaire- des chiens qui le pour-
fuivent, il va chercher un autre cerf, & tâche de - fe le fubftituer, 8c de donner ainli le change aux
chiens. Voye^ , pour tous les détails de la grande
.chaffe du cerf, l’art, de cet animal.
ACULL1AME eft , dans Hernandez , le nom
du cerf de la nouvelle Efpagne , femblable au cerf
d’Europe. Voyez C e r f .
A CU T I , A GUT I, ainfi que de Laët $c Pifon
l’écrivent , eft Xagouti, Voye^ ce mot.
A D A X , des anciens Africains, eft l’antilope 3
çfpè.ce de gazelle. Voye^ Antilope.
ADDIBO , dans le voyage aux Indes, du Père
Vincent Marie , eft Yadive. Voye£ A d i v e .
ADIL , dans les obfervatipns de Belon , eft
Yadive. Voypr ce mot.
ADIMÀIN, en Barbarie , bélier du Sénégal 8c
de Guinée. Voye^ Bélier.
Hifoire Naturelle. Tomt L
A D I
ADIRES, u c*efl, dit l’ancienne Encyclopédie ;
une forte de petits chiens fins , rufés , maisyoraces ,
& que l'on prend , en Barbarie, dans les maifons ,
quand ils y font jettés par la faim. Il y en a en Perfe 3
& ils y font plus grands qu en Barbarie. Les chiens
n’ofent attaquer ceux-ci ; ils font pourtant de la
même couleur les uns que les autres. Les Jardiniers
de ces contrées difent qu'ils fe mêlent avec les chiens
ordinaires n. — Si l’on peut démêler quelque chofe
à travers des traits auffi vagues , fous ce nom
à'adirés 3 c’eft Yadive que l’on veut defigner ici.
ADIVE ( 1’ ) eft un animal carnaffier , fort
commun dans le Levant & en Afrique , lequel
reflemble au loup par la figure, le poil & la queue 9
mais qui, pour la taille, eft au-deffous du renard*
Son efpèce paroît très-voifine de celle du chacal £
néanmoins , Yadive eft moins farouche & plu*
facile à apprivoifer. On lit dans nos chroniques ,
du temps de CharlesIX, que beaucoup de femmes ,
à la Cour, avoient des adives au lieu de petits
chiens. D’après cela, on aura pu regarder Yadive
comme un petit chacal privé ; mais, comme on
trouve dans les mêmes contrées des chacals & des
adives fauvages, &c qu’il y a conftamment une
différence confidérable entre c.es animaux , tant
pour la grandeur que pour le naturel, différence qui
1e trouve rarement dans une efpèce libre , il paroît .qu’on doit regarder le chacal & _ Yadive comme
-formant deux efpèces diftinftes, jufqu’à ce qu’il
foit prouvé par le fait qu’ils fe mêlent & produisent
enfe-mble. Cette préfomption eft d’autant mieux
fondée, quelle paroît s’accorder avec l’idée des
' anciens, Homère , Ariftote, Oppien, chez lelqueis
les thos & \epanther femblent indiquer féparément,
6c d’une manière diftinéle , le premier, le chaca* 9 & le fécond, Yadive. Voye^ Chacal.
ÆLG, en Norvège, eft Y élan. Voye£ ce mot.