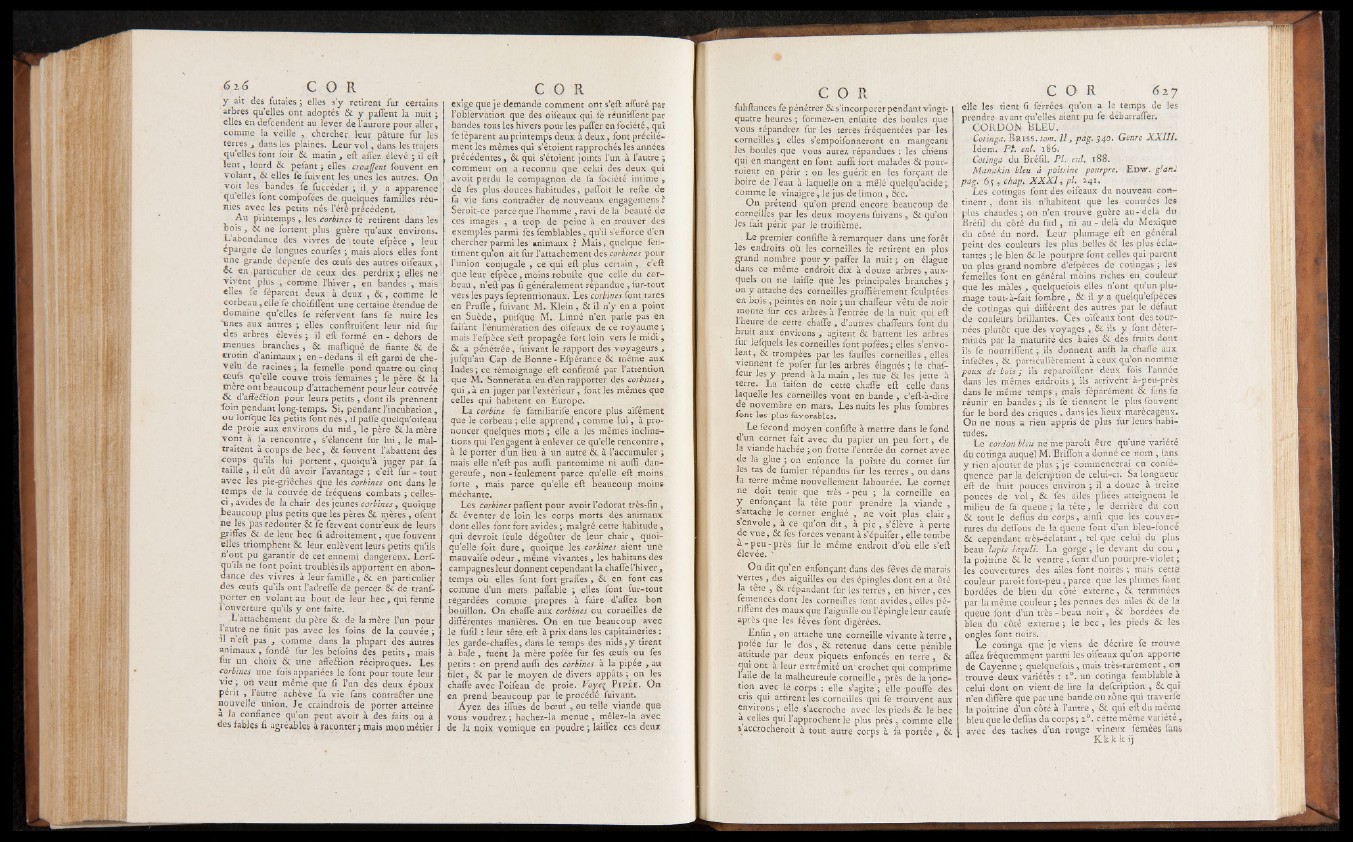
y ait des futaies ; elles s’y retirent, fur certains
arbres qu’elles ont adoptés & y paffent la nuit ;
elles en defcendent au lever de l’aurore pour aller,
comme la veille , chercher leur pâture fur les
terres , dans les plaines. Leur v o l, dans les trajets
qu’elles font foir & matin * eft allez élevé ; il eft
lent, lourd & pefant ; elles croafient fouvent en
volant, & elles fe |uivent les unes les autres. On
voit les bandes fe fuccéder ; il y a apparence
qu elles font compofées de, quelques familles réunies
avec les petits nés l’été précédent.
Au printemps, les corbines fe retirent dans les
bois , & ne fortent plus guère qu’aux environs.
L’abondance des vivres de ' toute efpèce , leur
épargne de longues courfes ; mais alors elles font
une grande dépenfe des oeufs des autres oifeaux,
en »particulier de ceux des. perdrix ; elles ne
vivent plus , comme l’hiver , en bandes , mais
elles fe féparent deux à deux , & , comme le
corbeau, elle fe choififfent une certaine étendue de
domaine qu’elles fe réfervent fans fe nuire les
'unes aux autres ; èlles conftruifent leur nid für
des arbres élevés ; il eft formé en - dehors de
menues branches , & maftiqué de fiante & de
crotin danimaux j en-dedans il eft garni de chevelu
de racines ; la femelle pond quatre ou cinq
oeufs qu’elle couve trois femaines ; le père & la
mere ont beaucoup d’attachement pour leur couvée
& d’affe&ion pour leurs petits , dont ils prennent
loin pendant long-temps. Si, pendant l’incubation,
ou lorfque les petits font nés, il paffe quelqu’oifeau
de proie aux environs du nid, le père &. la mère
vont à fa rencontre, s’élancent fur lui, le mal-'
traitent à coups de bec, & fouvent l’abattent des
coups qu’ils lui portent, quoiqu’à juger par fa
taille , il eût dû avoir l’avantage ; c’eft fur - tout
avec les pie-griêches que les corbines ont dans le
temps de la couvée de fréquens combats ; celles-
ci , avides de la chair des jeunes corbines p quoique
beaucoup plus petits que les pères & mères , ofent
ne les pas redouter & fe fervent contr’eux de leurs
griffes & de leur bec fi adroitement, que fouvent
elles triomphent & leur enlèvent leurs petits qu’ils
n ont pu garantir de cet ennemi dangereux. Lorf-
qu ils ne font point troublés ils apportent en abondance
des vivres à leur famille, & en particulier ;
des oeufs qu’ils ont l’adreffe de percer & de tranf- j
porter èn volant au bout de leur bec, qui ferme
l ’ouverture qu’ils y ont faîte.
L’attachement du père & de la mère l’un pour
l’autre ne finit pas avec les foins de la couvée ;
il n’eft pas , comme dans la plupart des autres
animaux, fondé fur les befoins des petits, mais
fur un choix & une âffe&ion réciproques. Les
corbines une fois appariées le font pour toute leur
vie ; on veut même que fi l’un des deux épOux
périt , 1 autre achève fa vie fans contraéier une
nouvelle union. Je craindrois de porter atteinte
a la confiance qu’qn peut avoir à des faits ou à
des fables fi agréables à raconter ; mais mon métier
exige que je demande comment ont s’eft affuré par
l’oblervation que des oifeaux qui fe réunifient par
bandes tous les hivers pour les paffer en fociété, qui
fe féparent au printemps deux à deux, font précisément
les mêmes qui s’étoient rapprochés les années
\ précédentes, & qui s’étoient joints l’un à l’autre ;
comment on a reconnu que, celui des deux qui
. avoit perdu le. compagnon de fa fociété intime ,
de fes plus douces habitudes, paffoit le refte de
fa vie fans contraâer de nouveaux engagemens?
Seroit-ce parce que l’homme , ravi de la beauté de
ces images , a trop de peine à en .trouver des
exemples parmi fes femblables, qu’il s’efforce d’en
chercher parmi les animaux ? Mais,' quelque fen-
timent qu’on ait fur l’attachement des corbines pour
l’iinion conjugale , ce qui eft plus certain , c’eft
que leur efpèce, moins robufte que celle du corbeau
, n’ef^ pas fi généralement répandue , fur-tout
vers les pays feptentrionaux. Les corbines font rares
en Prufl'e , fuivant M. Klein , & il n’y en a point
en Suède, puifque M. Linné n’en parle pas en
faifant l’énumération des oifeaux de ce royaume ;
mais l’efpèce s’eft propagée fort loin vers le midi ,
& a pénétrée, fuivant le rapport des voyageurs,
jufqu’au Cap de Bonne - Efpérance & même aux
Indes ; ce témoignage eft confirmé par l’attention
que M. Sonnerat a eu d’en rapporter des corbines ,
qui, à en juger par l’extérieur, font les mêmes que
celles qui habitent en Europe.
La corbine fe familiarife encore plus aifément
que le corbeau ; elle apprend , comme lu i, à prononcer
quelques mots ; elle a les mêmes inclinations
qui l’engagent à enlever ce qu’elle rencontre ,
à lé porter d’un lieu à un autre & à l’accumuler ;
mais elle n’eft pas aufli pantomime ni aufli dan-
gereufe, non - feulement parce qu’elle eft moins
forte , mais parce qu’elle eft beaucoup moins
méchante.
Les corbines paffent pour avoir l’odorat très-fin ,
& éventer de loin les corps morts des animaux
dont elles font fort avides ; malgré cette habitude ,
qui devroit feule dégoûter de leur chair , quoiqu’elle
foit dure, quoique les corbines aient une
mauvaife odeur , même vivantes , les habitans des
campagnes leur donnent cependant la chaffe l’hiver ,
temps oh elles font fort graffes, & en font cas
comme d’un mets paffable ; elles font îur-tout
regardées comme propres à faire d’affez bon
bouillon. On chaffe aux corbines ou corneilles de
différentes manières. On en tue beaucoup avec
le fufil : leur tête, eft à prix dans les capitaineries :
les garde-chaffes, dans le temps des nids,y tirent
à baie, tuent la mère pofée fur fes oeufs, ou fes
petits : on prend aufli des corbines à la pipée , au
met, & par le moyen de divers appâts; on les
chaffe avec l’oifeau de proie. V o y e^ P i p é e . On
en prend beaucoup par le procédé fuivant.
Ayez des îffnës de boeuf , pu telle viande que
vous- voudrez ; hachez-la menue , mêlez-la avec
de la noix vomique en poudre ; laiffez ces deux.
fubftances fe pénétrer & s’incorporer pendant vingt-
quatre heures ; formez-en enfuite des boules que
vous répandrez fur les terres fréquentées par les
corneilles ; elles s’empoifonneront en mangeant
les boules que vous aurez répandues : les chiens
qui en mangent en font aufli fort malades & pourvoient
en périr : on les guérit en les forçant de
boire de l’eau à laquelle on a mêlé quelqu’acide;
comme le-vinaigre, le jus de limon , &c.
On prétend qu’on prend encore beaucoup de
corneilles par les deux moyens fuivans , & qu’on
les fait périr par le troifième.
Le premier conftfte à remarquer dans une forêt
les endroits ou les corneilles fe retirent en plus J
grand nombre pour y paffer la nuit ; on élague
dans ce même endroit dix à douze arbres , auxquels
on ne laiffe qüè les principales branches ;
on y attache des corneilles grofliërement fculptées
en bois , peintes en noir ; un chaffeur vêtu de noir
monte fur ces arbres à l’entrée de la nuit qui eft
l’heure de cette chaffe , d’autres chaffeurs font du
bruit aux environs, agitent & battent les arbres
lur lefquels les corneilles font pofées ; elles s’envolent,
& trompées par les fauffes corneilles , elles
viennent fe pofer fur les arbres élagués ; le chaf-
feur les y prend à la main , les .tue & les jette à
terre. La faifon de cette chaffe eft celle dans
laquelle les corneilles vont en bande, c’eft-à-dire
de novembre en mars. Les nuits les plus fombres
font les plus favorables.
| fécond moyen conftfte à mettre dans le fond
d’un cornet fait avec du papier un peu fort , de
la viande hachée ; on frotte l’entrée du cornet avec
de la glue ; on/ enfonce la pointe du cornet fur
les tas de fumier répandus fur les terres , ou dans
la terre même nouvellement labourée. Le cornet
ne doit tenir que très - peu ; la corneille en
y enfonçant la tête pour prendre la viande ,
-s’attache le cornet' englué , ne voit plus clair,
s envole, à ce qu’on dit, à pic , s’élève à perte :
de vue, & fes forces venant à s’épuifer, elle tombe
a - peu - près fur le même endroit d’oû elle s’eft
élevée. N
On dit qu’en enfonçant dans des fèves de marais
Vertes , des aiguilles ou des épingles dbnt on a ôté
la tete , &. répandant "fur les terres, en hiver , ces
femences dont les corneilles font avides, elles pé-
riffent des maux que l’aiguille ou l’épingle leur caufe
après que les fèves font digérées.
Enfin , on attache une corneille vivante à terre ,
pofee fur le dos, & retenue dans cette pénible
attitude par deux piquets enfoncés en terre , &
qui ont a leur extrémité un' crochet qui comprime 1 aile de la malheureule corneille , près de la jonction
avec le corps : elle s’agité ; elle pouffe des
cris qui attirent les corneilles qui fe trouvent aux
environs; elle s’accroche avec les pieds & le bec
a celles qui l’approchent le plus près , comme elle
saccrocheroit à tout autre corps à fa portée , 6c
elle les tient fi ferrées, qu’on a le temps de les
prendre avant qu’elles aient pu fe débarraffer.
CORDON BLEU.
Cotinga. Briss. torn. I l , pag. 340. Genre XXIII.
Idem. Pt. enl. 186.
Cotinga du Bréfil. PL enl. 188.
Manakin bleu à poitrine pourpre. Edw. glatti
pag. 6 5 , c/iap. X X X I , pl. 241.
Les cotingas font des oifeaux du nouveau continent
, dont ils n’habitent que les contrées les
plus chaudes.; on n’en trouve guère au-delà du
Bréfil du côté du fud , ni au - delà du Mexique
du côté du nord. Leur plumage eft en général
peint des couleurs les plus,belles & les plus éclatantes
; le bleu &. le pourpre font celles qui parent
un plus grand nombre d’efpèces de' cotingas ; les
femelles font en général moins riches en couleur1 -que les mâles, quelquefois elles n’ont qu’un plu-*
mage tout-à-fait fombre , & il y a quelqu’efpèces
de cotingas qui différent des autres par le defaut
de couleurs brillantes. Ces oifeaux font des tournées
plutôt que des voyages , & ils y font déterminés
par la maturité des baies & dès fruits dont
ils fe nourriffent ; ils donnent aufli la chaffe aux
infe&es , & particulièrement à céüx qidon nomme-
poux de bois; ils reparoiffent deux fois l’année
dans les mêmes endroits ; ils arrivent à-peu-près
dans le même temps ; mais féparément & fans fe
réunir en bandes ; ils fe tiennent le plus fouvent
fur le bord des criques , dans les lieux marécageux.
On ne nous a rien appris de plus fur leurs habi-
tudes.
Le cordon bleu néme paroît être qu'une variété
du cotinga auquel M. Brillon a donné ce nom , (ans
y rien ajouter de plus ; je commencerai en coulé-
quence par la description de celui-ci. Sa longueur
eft de huit pouces environ ; il a doùze à treize
pouces de vol, & fes. ailes pliées atteignent le
milieu de fa queue ; la tête, le derrière du cou
& tout le deffus du corps, ainfi que les couvertures
du deffous de la queue font d’un bleu-foncé
& cependant très-édatant, tel que celui du plus
beau lapis la^ulï. La gorge , le devant du cou ,
la poitrine & le ventre , font d’un pourpre-violet ;
les couvertures des ailes font noires ; mais cette
couleur paroît fort-peu, parce que les plumes font
bordées de bleu du côté externe, & terminées
par la même couleur ; les pennes des ailes & de la
queue font d’un très - beau noir, & bordées de
bleu du côté externe ; le bec, les pieds & les
ongles font noirs. .
Le cotinga que je viens de décrire fe trouve
allez fréquemment parmi les oifeaux qu’on apporte
de Cayenne ; quelquefois, mais très-rarement, on
trouve deux variétés : i°. un cotinga femblable a
celui dont on vient de lire la defcription , & qui
n’en diffère qile par une bande ou zone qui traverfe
la poitrine d’un côté à l’autre , & qui eft du meme
; bleu que le deffus du corps ; 20. cette même variété,
avec des taches d’un rouge vineux femées fans
Kk k k i j