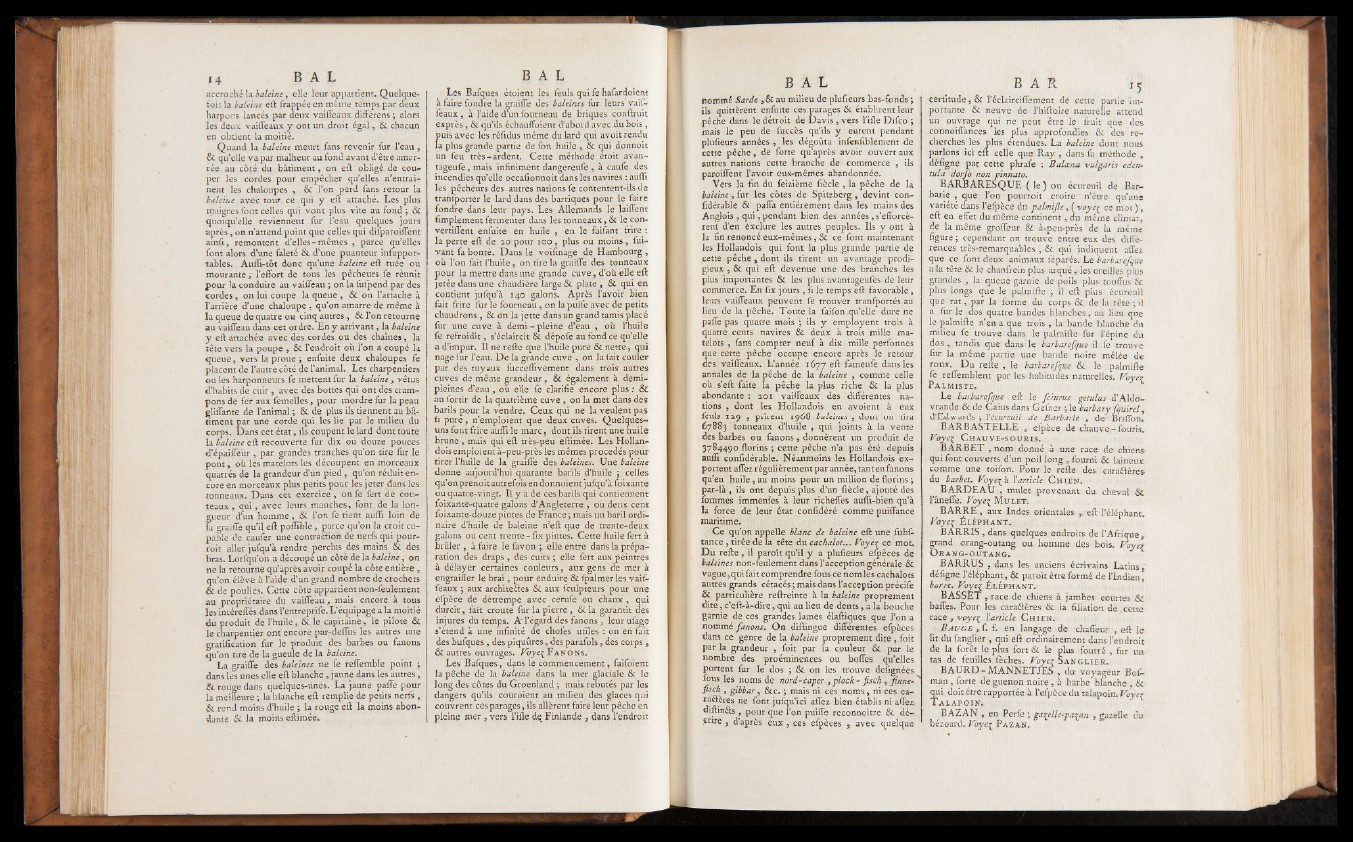
accroché la b a le in e , elle leur appartient. Quelquefois
la baleine eft frappée en même temps par deux
harpons lancés par deux vaiffeaüx différens ; alors
les deux vaiffeaüx y ont un droit égal, & chacun
en obtient la moitié.
Quand la baleine meurt fans revenir fur l’eau,
8c qu’elle va par malheur au fond avant d’être amarrée
au côté du bâtiment, on eft obligé de cou**
per les cordes pour empêcher qu’elles n’entraînent
les chaloupes , & l’on perd fans retour la
baleine avec tout ce qui y eft attaché. Les plus
maigres font celles qui vont plus vite au fond ; &
quoiqu’elle reviennent fur l’eau quelques jours
après, on n’attend point que celles qui difparoiffent
ainft, remontent d’elles-mêmes , parce qu’elles
font alors d’une faleté &. d’une puanteur infuppor-
tables. Aufli-tôt donc qu’une baleine eft tuée ou
mourante, l’effort de tous les pêcheurs fe réunit
pour la conduire au vaiffeau ; on la lufpend par des
cordes, on lui coupe la queue , & on l’attache à
l’arrière d’une chaloupe « qu’on amarre de même à
la queue de quatre ou cinq autres, 8c l’on retourne
au vaiffeau dans cet ordre. En y arrivant, la baleine
y eft attachée avec des cordes ou des chaînes, la
tête vers la poupe , 8c l’endroit où l’on a coupé la
queue, vers la proue ; enfuite deux chaloupes fe
placent de l’autre côté de l’animal. Les charpentiers
ou les harponneurs fe mettent fur la baleine , vêtus
d’habits de cuir , avec des bottes qui ont des crampons
de fer aux femelles, pour mordre fur la peau
gliffante de l’animal ; & de plus ils tiennent au bâtiment
par une corde qui les lie par le milieu, du
corps. Dans cet état, ils coupent le lard dont toute
la baleine eft recouverte fur dix ou douze pouces
d’épaiffeùr , par grandes tranches qu’on tire ftir le
pont, où les matelots les découpent en morceaux
quarrés de la grandeur d’un pied, qu’on réduit encore
en morceaux plus petits pour les jeter dans les
tonneaux. Dans cet exercice, on fe fert de couteaux
, qui, avec leurs manches, font de la lon-
Eueur d’un homme, & Ton fe tient aufli loin de
i graiffe qu’il eft poflible, parce qu’on la croit capable
de caufer une contraction de nerfs qui pour-
roit aller jufqu’à rendre perclus des mains 8c des
bras. Lorfqu’on a découpé un côté de la b a le in e , on
ne la retourne qu’après avoir coupé la côte entière ,
qu’on élève à l’aide d’un grand nombre de crochets
&de poulies. Cette côte appartient non-leulement
au propriétaire du vaiffeau, mais encore à tous
les intéreffés dans l’entreprife. L’équipage a la moitié
du produit de l’huile, & le capitaine, le pilote &
le charpentier ont encore par-deffus les autres une
gratification fur le produit des barbes ou fanons
qu’on tire de la gueule de la baleine.
La graiffe des baleines ne fe reffemble point ;
dans les unes elle eft blanche, jaune dans les autres,
& rouge dans quelques-unes. La jaune paffe pour
la meilleure ; la blanche eft remplie de petits nerfs ,
& rend moins d’huile ; la rouge eft la moins abondante
& la moins eftimée.
Les Bafques étoient les feuls qui fe hafardoient
à faire fondre la graiffe des baleines fur leurs vaif-
ièaux, à l’aide d’un fourneau de briques conftruit
exprès, & qu’ils échauffoient d’abord avec dubois,
puis avec les réfidus même du lard qui avoit rendu
la plus grande partie de fon huile , 8c qui donnoit
un feu très-ardent. Cette méthode étoit avan-
tageufe, mais infiniment dangereufe , à caufe des
incendies qu’elle occafionnoit dans les navires :.auffi
les pêcheurs des autres nations fe contentent-ils de
tranfporter le lard dans des barriques pour le faire
fondre dans leur pays. Les Allemands le laiffent
fimplement fermenter dans les tonneaux, & le con-
vertiffent enfuite en huile , en le faifant frire :
la perte eft de 20 pour 100, plus ou moins, fui-
vant fa bonté. Dans le voifinage de Hambourg,
où l’on fait l’huile, on tire la graiffe des tonneaux
pour la mettre dans une grande cuve, d’où elle eft
jetée dans une chaudière large 8c plate , &. qui en
contient jufqu’à 140 galons. Après l’avoir bien
fait frire fur le fourneau, on lapuîfe avec de petits
chaudrons , & o'n la jette dans un grand tamis placé
fur une cuve à demi - pleine d’eau , où l’huile
fe refroidit, s’éclaircit & dépofe au fond ce qu’elle
a d’impur. Il ne refte que l’huile pure 8c nette, qui
nage fur l’eau. De la grande cuve , on la fait couler
par des tuyaux fucceflivement dans trois autres
cuves de même grandeur, & également à demi-
pleines d’eau, où elle fe clarifie encore plus : 8c
au fortir de la quatrième cuve , on la met dans des
barils pour la vendre. Ceux qui ne la veulent pas
fi pure, n’emploient que deux cuves. Quelques-
uns fontTrire aufli le marc, dont ils tirent une huile
brune, mais qui eft très-peu eftimée. Les Hollan-
dois emploient à-peu-près les mêmes procédés pour
tirer l’huile de la graiffe des baleines. Une baleine
donne aujourd’hui quarante barils d’huile ; celles
qu’on prenoit autrefois en donnoient jufqu’à foixante
ou quatre-vingt. Il y a de ces barils qui contiennent
fpixante-quatre galons d’Angleterre , ou deux cent
foixante-douze pintes de France ; mais un baril ordinaire
d’huile de baleine n’eft que de trente-deux
galons ou cent trente - fix pintes. Cette huile fert à
brûler , à faire le favon ; elle entre dans la préparation
des draps, des cuirs ; elle fert aux peintres
à délayer certaines couleurs, aux gens de mer à
engraiffer le brai, pour enduire 8c fpalmer les vaif-
feaux ; aux archite&es 8c aux fculpteurs pour une
efpèce de détrempe avec cerufe ou chaux , qui
durcit, fait croûte fur la pierre, & la garantit des
injures du temps. ATégard des fanons, leur ufage
s’étend à une infinité de chofes utiles : on en fait
des bufques, des piquûres, des parafols, des corps ,
& autres ouvrages. Voyez F a n o n s .
Les Bafques, d^ns le commencement, faifoient
la pêche de la baleine dans la mer glaciale & le
long des côtes du Groenland ; mais rebutés par les
dangers qu’ils couroient au milieu des glaces qui
couvrent ces parages, ils allèrent faire leur pêche en
pleine mer, vers l’ille de. Finlande , dans l’endroit
nommé Sarde , & au milieu de plufieurs bas-fonds ;
ils quittèrent enfuite ces parages &c établirent leur
pêche dans le détroit de Davis, vers Tille Difco ;
mais le peu de fuccès qu’ils y eurent pendant
plufieurs années , les dégoûta infenfiblement de
cette pêche, de forte qu’après avoir ouvert aux
autres nations cette branche de commerce , ils
paroiffent l’avoir eux-mêmes abandonnée.
Vers la fin du feizième fiècle , la pêche de la
b a le in e , fur les côtes de Spitzberg, devint con-
fidérable & paffa entièrement dans les mains des
Anglois , qui, pendant bien des années, s’efforcèrent
d’en exclure, les autres peuples. Ils y ont à
la fin renoncé eux-mêmes, 8c ce font maintenant
les Hollandois qui font la plus grande partie de
cette pêche, dont ils tirent un avantage prodigieux
, 8c qui eft devenue une des branches les
plus importantes & les plus avantageufes de leur
commerce. En fix jours, fi le temps eft favorable,
leurs vaiffeaüx peuvent fe trouver tranfportés au
lieu de la pêche. Toute la faifon-qu’elle dure ne
paffe pas quatre mois ; ils y employent trois à
quatre, cents navires 8c deux à trois mille matelots
, fans compter neuf à dix mille perfonnes
que cette pêche occupe encore après , le retour
des vaiffeaüx. L’année 1677 eft fameufe dans les
annales de la pêche de la baleine , comme celle
où s’eft faite la pêche la plus riche 8c la plus
abondante : 201 vaiffeaüx des différentes nations
, dont les Hollandois en avoient à eux
feuls 129 , prirent 1968 baleines , dont on tira
67883 tonneaux d’huile , qui joints à la vente
des barbes ou fanons , donnèrent un produit de
3784490 florins ; cette pêche n’a pas été depuis
suffi confidérable. Néanmoins les Hollandois exportent
affez régulièrement par année, tant en fanons,
qu’en huile, au moins pour un million de florins \
par-là, ils ont depuis plus d’un fiècle, ajouté des
fommes immenfes à leur richeffes aufli-bien qu’à
la force de leur état confidéré comme puiffance
maritime.
Ce qu’on appelle b la n c de baleine eft une fubf-
tance , tirée de la tête du ca ch a lo t... V o y e z ce mot.
Du refte , il paroît qu’il y a plufieurs efpèces de
baleines non-feulement dans l’acception générale 8c
vague,qui fait comprendre fous ce nom les cachalots
autres grands cétacés ; mais dans l’acception précife
& particulière reftreinte à la baleine proprement
dite, c’eft-à-dire, qui au lieu de dents, a la bouche
garnie de ces grandes lames élaftiques que Ton a
nommé fa n o n s . On diftingue différentes efpèces
dans ce genre de la baleine proprement dite, foit
par la grandeur , foit par la couleur 8c par le
nombre des proéminences ou boffes qu’elles
portent fur le dos ; & on les trouve defignées
fous les noms de n ord-caper , p lo ck - fis c h , fin n e- v
f i sch , gibb ar , &c. ; mais ni ces noms, ni ces caractères
ne font jufqu’ici affez bien établis ni affez.
diftin&s , pour que Ton puiffe reconnoître & dé-
cnre a d’après eux , ces efpèces , avec quelque
certitude, 8c Téclairciffement de cette partie importante
8c neuve de Thiftoire naturelle attend
un ouvrage qui ne peut être le fruit que des
connoiffances les plus approfondies & des recherches
les plus étendues. La baleine dont nous
parlons ici eft celle que Ray, dans fa méthode ,
défigne par cette phrafe : Balcena vulgar is eden-
tu la dorfo non p in n a to .
BARBARESQUE (l e) ou écureuil de Barbarie
, que Ton pourroit croire ' n’étre qu’une
variété dans Tefpèce du p a lm ifie , ( v o y e z ce mot ) ,
eft en effet du même continent, du même climat,
de la même groffeur 8c à-peu-près de la même
figure ; cependant on' trouve entre eux des différences
très-remarquables , 8c qui indiquent affez
que ce font deux animaux féparés. Le barbarefque
a la tête & le chanfrein plus arqué, les oreilles plus
grandes , la queue garnie de poils plus touffus &
plus longs que le palmifte ; il eft plus écureuil
que rat, par la forme du corps 8c delà tête ; il
a fur le dos quatre bandes blanches, au lieu que
le. palmifte n’en a que trois , la bande blanche du
milieu fe trouve dans le palmifte fur l’épine du
dos., tandis que dans le barbarefque il fe trouve
fur la même partie une bande noire mêlée de
roux. Du refte , le barbarefque 8c le palmifte
fe reffemblent par les: habitudes naturelles. V o y e z
Pa l m i s t e .
Le barbarefque eft le fc iu r u s getulus d’Aldo-
vrande 8c de Caïus dans Gefner j le ba rb a ry fq u ir e ly
d’Edwards ; Xécureuil de Barbar ie ,' de Briffon*
BARBASTELLE , efpèce de chauve - fouris*
V o y e z C h a u v e t S O u r i s .
BARBET , nom donné à une race de chiens-
qui font couverts d’un poil long , fourni & laineux
comme une toifon. Pour le refte des caraélères-
du barbet. V o y e z à Y article C h i e n .
BARDEAU , mulet provenant du- cheval 8c
Tâneffe. Voy ez M u l e t .
BARRE, aux Indes orientales eft l’éléphant»
V o y e z É l é p h a n t . .
BARRIS , dans quelques endroits de l’Afrique,
grand orang-outang ou homme des bois. V o y e r
O r a n g - o u t a n g .
BARRUS , dans les anciens écrivains Latins,
défigne l’éléphant, & paroît être formé de l’Indien,
barre. V oyer É L É P H A N T .
BASSET , race de chiens à jambes courtes 8c
baffes. Pour les caraâères 8c la filiation de .cette
race 3 voye% Xarticle C h i e n .
B a u g e , f . f . e n l a n g a g e d e c h a f f e u r , e f t l e
l i t d u f a n g h e r , q u i e f t o r d i n a i r e m e n t d a n s l ’ e n d r o i t
d e l a f o r ê t l e p l u s f o r t & l e p l u s f o u r r é , f u r u n
t a s d e f e u i l l e s f è c h e s . V o y e z S a n g l i e r .
BAURD - MANNETJES , du- voyageur Bol—
man, forte de guenon noire , à barbe blanche , 8c
qui doit être rapportée à Tefpèce du talapoin. V o y e r T a l a p o i n .
BAZAN , en Perfe ; gazelle-pa^an , gazelle du
bézoard. Voye£ P a z a n ,.