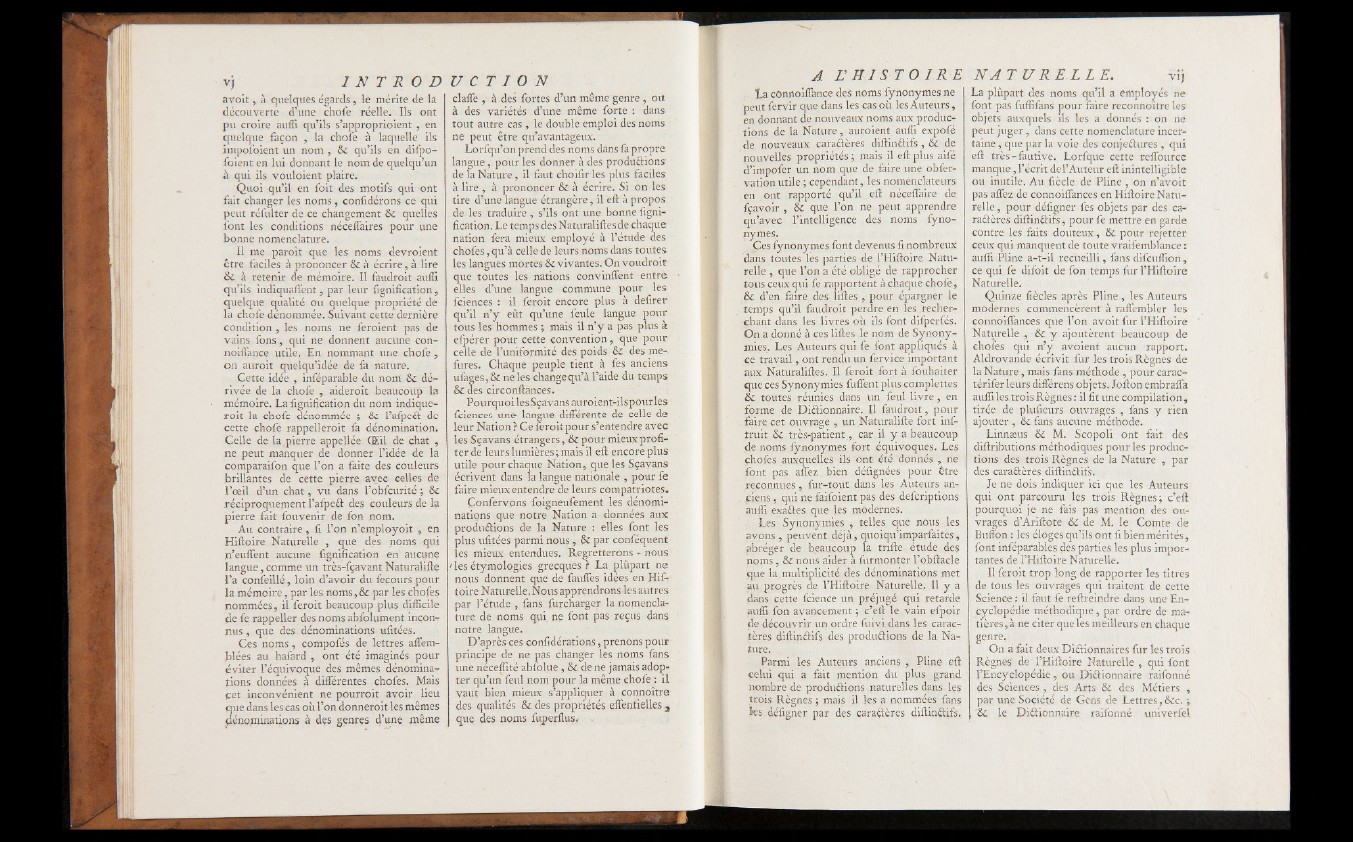
a v o it , à quelques égards, le mérite de la
découverte d’une chofe réelle. Ils ont
pu croire aufli qu’ils s’approprioient , en
quelque façon , la chofe à laquelle ils
impofoient un nom , & qu’ils en difpo-
foient en lui donnant le nom de quelqu’un
à qui ils vouloient plaire.
Quoi qu’il en foit des motifs qui ont
fait changer les noms, confidérons ce qui
peut réfulter de ce changement 6c quelles
font les conditions néceffaires pour une
bonne nomenclature.
Il me paroît que les noms devroient
être faciles à prononcer & à écrire, à lire
6c à retenir de mémoire. Il faudrait aulîi
qu’ils indiquaffent, par leur fignification,
quelque qualité ou quelque propriété de
la chofe dénommée. Suivant cette dernière
condition, les noms ne feraient pas de
vains fons, qui ne donnent aucune con-
noiffance utile. En nommant une chofe,
on aurait qüelqu’idée de fa nature.
Cette idée , inféparable du nom 6c dérivée
de la chofe , aideroit beaucoup la
mémoire. La lignification du nom indiquera
it la chofe dénommée ; 6c l’afpeCt de
cette chofe rappellerait fa dénomination.
Celle de la pierre appellée CEil de chat ,
ne peut manquer de donner l’idée de la
comparaifon que l’on a faite des couleurs
brillantes de cette pierre avec celles de
l ’oeil d’un ch at, vu dans l’obfcurité ; 6c
réciproquement l’afpeÇt des couleurs de la
pierre fait fouvenir de fon nom.
Au contraire, fi l’on n’employoit , en
Hiftoire Naturelle , que des noms qui
p’euffent aucune fignification en aucune
langue, comme un très-fçavant Naturalifte
l ’a confeillé, loin d’avoir du fecours pour
la mémoire, par les noms, & par les chofes
nommées, il ferait beaucoup plus difficile
de fe rappeller des noms abfolument inconnus
, que des dénominations ufitées.
Ces noms , compofés de lettres affem-
filées au hafard , ont été imaginés pour
éviter l’équivoque des mêmes dénominations
données à différentes chofes. Mais
cet inconvénient ne pourrait avoir lieu
que dans les cas oit l’on donnerait les mêmes
dénominations à des genres d’une même
claffe , à des fortes d’un même genre, oit
à des variétés d’une même forte : dans
tout autre cas , le double emploi des noms
ne peut être qu’avantageux.
Lorfqu’on prend des noms dans fa propre
langue, pour les donner à des productions
de la Nature, il faut choifir les plus faciles
à lire , à prononcer 6c à écrire. Si on les
tire d’une langue étrangère, il eft à propos
de les traduire, s’ils ont une bonne fignification.
Le temps des Naturaliftes de chaque
nation fera mieux employé à l’étude des
chofes, qu’à celle de leurs noms dans toutes
les langues mortes & vivantes. On voudrait
que toutes les nations convinffent entre
elles d’une langue commune pour les
fciences : il ferait encore plus à defirer
qu’il n’y eût qu’une feule langue pour
tous les hommes ; mais il n’y a pas plus à
efpérer pour cette convention, que pour
celle de l ’unifcrmité des poids 6c des me--
fures. Chaque peuple tient à fes anciens
ufages,& ne les change qu’à l’aide du temps
6c des circonflances.
Pourquoi les Sçavans auraient-ils pour les
fciences une langue différente de celle de
leur Nation ? Ce ferait pour s’entendre avec
les Sçavans étrangers, 6c pour mieux profiter
de leurs lumières ; mais il eft encore plus
utile pour chaque Nation, que les Sçavans
écrivent dans la langue nationale , pour fe
faire mieux entendre de leurs compatriotes.
Çonfervons foigneufement les dénominations
que notre Nation a données aux
productions de la Nature ; elles font les
plus ufitées parmi nous, 6c par conféquent
les mieux entendues. Regretterons - nous
'lesétymologies grecques? La plupart ne
nous donnent que de fauffes idées en Hiftoire
Naturelle. Nous apprendrons les autres
par l’étude , fans furcharger la nomenclature
de noms qui ne font pas reçus dans
notre langue.
D ’après ces confidérations, prenons pour
principe de ne pas changer les noms fans
une néceflité abfolue, 6c de né jamais adopter
qu’un feul nom pour la même chofe : il
vaut bien mieux s’appliquer à connoîtra
des qualités 6c des propriétés effentielles 3
que des noms fuperflus. .
La connoiflhnce des noms fynonymes ne
peut fervir que dans les cas où les Auteurs,
en donnant de nouveaux noms aux productions
de la Nature, auraient auffi expofé
de nouveaux caractères diftinCtifs , de
nouvelles propriétés ; mais il efl plus aifé
d’impofer un nom que de faire une obfer-
vationutile ; cependant, les nomênclateurs
en ont rapporté qu’i l , efl néceffaire de
fçavoir , 6c que l’on ne peut apprendre
qu’avec l’intelligence des noms fyno-
nymes.
Çes fynonymes font devenus fi nombreux
dans toutes les parties de l’Hiftoire Naturelle
, que l ’on a été obligé de rapprocher
tons ceux qui fe rapportent à chaque chofe,
6c d’en faire des liftes , pour épargner le
temps qu’il faudrait perdre en les recherchant
dans les livres où ils font difperfés. '
On a donné à ces liftes le nom de Synonymies.
Les Auteurs qui fe font appliqués à
çe tra va il,. ont rendu un fervice important
aux Naturaliftes. Il ferait , fort à fouhaiter
que ces Synonymies fuffent plus complettes
6c toutes réunies dans un feul liv r e , en
forme de Dictionnaire. Il faudrait, pour
faire, cet ouvrage , un Naturalifte fort inf-
truit 6c très-patient, car il y a beaucoup
de noms fynonymes fort équivoques. Les
chofes auxquelles, ils ont été donnés ,. ne
font pas . aftez , bien défignées. pour être
reconnues , fur-tout dans les Auteurs anciens
, qui ne faifoient pas des defcriptions
auffi exaCles que les modernes.
Les Synonymies , telles que nous les
avons , peuvent déjà, quoiqu’imparfaites,
abréger de beaucoup la trille étude des
noms, 6c nous aider à furmonter l’obftacle
que la.multiplicité des dénominations met
au progrès de l’Hiftoire Naturelle. Il y a
dans cette fcience un préjugé qui retarde
auffi fon avancement ; c’eft le vain efpoir
de découvrir un ordre fuivi dans les caractères
diftinCtifs des productions de la Nature.
Parmi les Auteurs anciens , Pline eft
celui qui a fait mention du plus grand
nombre de productions naturelles dans les
trois Règnes ; mais il les a nommées fans
les défigner par des caractères diftinCtifs,
La plupart des noms qu’il a employés ne
font pas fuffifans pour faire reconnoître les
objets auxquels ils les a donnés : on ne
peut juger, dans cette nomenclature incertaine
, que par la voie des conjectures , qui
eft très-fautive. Lorfque cette reffource
manque, l’écrit de l’Auteur eft inintelligible
ou inutile. Au fiècle de Pline , on n’avoit
pas aftez de connoiflances en Hiftoire Naturelle
, pour défigner fes objets par des caractères
diftinCtifs, pour fe mettre en garde
contre les faits douteux, 6c pour rejetter
ceux qui manquent de toute vraifemblance :
aufli Pline a-t-il recueilli, fans difcuflion ,
ce qui fe difoit de fon temps fur l’Hiftoire
Naturelle.
Quinze fiècles après Pline, les Auteurs
modernes commencèrent à raflèmbler les
connoiflances que l ’on avoit fur l’Hiftoire
Naturelle , 6c y ajoutèrent beaucoup de
chofes qui n’y avoient aucun rapport.
Aldrovande écrivit fur les trois Règnes de
la Nature, mais fans méthode , pour carac-
térifer leurs différens objets. Jofton emb rafla
aufli les trois Règnes : il fit une compilation,
tirée de plufieurs ouvrages ., fans y rien
ajouter , 6c fans aucune méthode.
Linnæus & M. Scopoli ont fait des
diftributions méthodiques pour les productions
des trois Règnes de la Nature , par
des caractères diftinCtifs.
Je ne dois indiquer ici que les Auteurs
qui ont parcouru les trois Règnes; c’eft
pourquoi je ne fais pas mention des ouvrages
d’Ariftote 6c de M. le Comte de
Buffon :les éloges qu’ils ont fi bien mérités,
font inféparables des parties les plus importantes
de l ’Hiftoire Naturelle.
Il feroit trop long de rapporter les titres
de tous les ouvrages qui traitent de cette
Science : il faut fe reftreindre dans une Encyclopédie
méthodique, par ordre de matières,
à ne citer que les meilleurs en chaque
genre,
On a fait deux Dictionnaires fur les trois
Règnes: de l’Hiftoire Naturelle , qui font
l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raifonné
des Sciences , des Arts 6c des Métiers ,
par une Société de Gens de Lettres,&c. ;
'6c le Dictionnaire raifonné univerfel