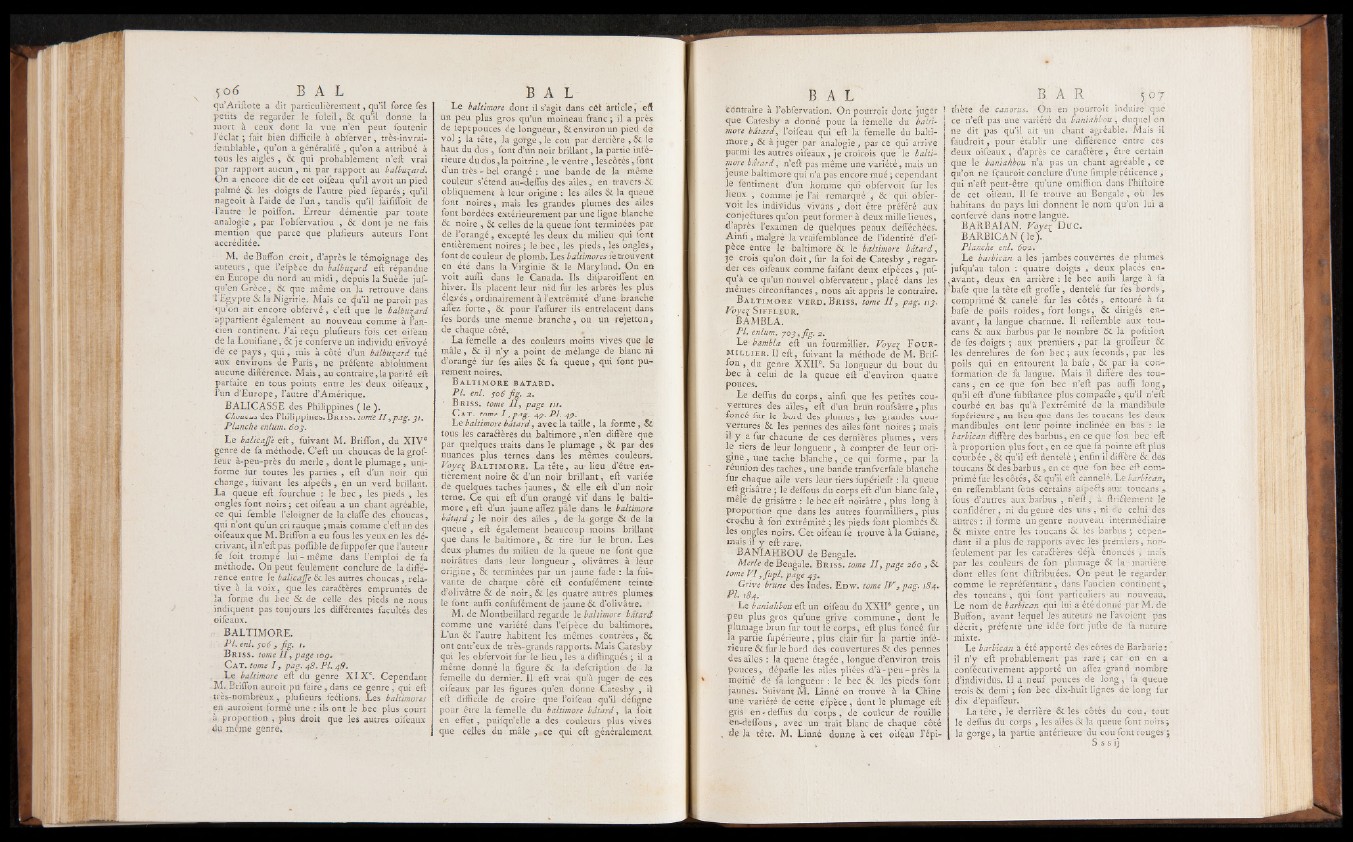
qu’Ariftote a dit particulièrement, qu’il force fes
petits de regarder le foleil,. & qu’il donne la
mort à ceux dont la vue n’en peut foutenir
l’éclat ; fait bien difficile à obferver, très-invrai-
iemblable, qu’on a généralifé , qu’on a attribué à
tous les aigles , & qui probablement n’eft vrai
par rapport aucun , ni par rapport au b albumen d.
On a encore dit de cet oifeau qu’il avoit un pied
palmé &. les doigts de l’autre pied féparés; qu’il
nageoit à l’aide de l’un, tandis qu’il l'aififlbit de
l’autre le poiffon. Erreur démentie par toute
analogie-, par l’obfervatiou , & dont je ne fais
mention que parce que plufieurs auteurs l’ont
accréditée.
M. de Buffon croit, d’après le témoignage des
auteurs , que l’efpèce du balbuzard eft répandue
e'n Europe du nord au midi, depuis la Siiède jüfi-
qu’en Grèce, & que même on la retrouve dans 1 Egypte St la Nigritie. Mais ce qu’il ne paroît pas
qu’on ait encore obfervé, c’eft que le balbuzard
appartient également au nouveau comme à l’ancien
continent. J’ai reçu plufieurs fois cet oifeau
de la Louifiane, & je conferve un individu envoyé
de ce pays, qui, mis à côté d’un balbuzard tué
aux environs de Paris, ne préfente abfolument
aucune différence. Mais, au contraire, la parité eft
parfaite en tous points entre les' deux oifeaux,
l’un d’Europe, l’autre d’Amérique.
BALICASSE des Philippines ( le ).
Choucas des Philippines. B r i s s . toniè I I , pag. 31.
Planche enlum. 60
Le balicajje eft, fuivant M. Briflon, du XIVe
genre de fa méthode. C’eft un choucas de la grof-
feur à-peu-près du merle , dont le plumage, uniforme
fur toutes les parties , eft d’un noir qui
change, fuivant les afpeéls, en un verd brillant.
La queue eft fourchue : le bec , les pieds , les
ongles font noirs; cet oifeau a un chant agréable,
ce qui femble l’éloigner de la clafle des choucas,
qui n’ont qu’un cri rauque ; mais comme c’eft un des
oifeaux que M. Brifton a eu fous les yeux en les décrivant,
il n’eft pas poffible defuppofer que l’auteur
fe foit trompé lui - même dans l’emploi de fa
méthode. On peut feulement conclure de la différence
entre le balicajfe & les autres choucas , relative
à la voix, que les caraétères empruntés de
la forme du bec & de celle des pieds ne nous
indiquent pas toujours les différentes facultés des
oifeaux.
BALTIMORE.
PL enl. 306 , fig. /,
B r i s s . tome II, page 109* ^
C a t . tome 7 , pag: 48. PL 48.
.Le baltimore eft du genre X IX e. Cependant
-M.,Briflon auroit pu faire, dans ce genre, qui eft
très-nombreux, plufieurs ferions. Les baltimores
en aurpient formé une r ils ont le bec plus court
à proportion , plus droit que les autres oifeaux
du mêipe genre.
Le baltimore dont il s’agit dans cêt article, eft
un peu plus gros qu’un moineau franc ; il a près
de lèpt pouces de longueur, & environ un pied dé
vol ; la tête, la gorge, le cou par derrière , St le
haut du dos , font d’un noir brillant, la partie inférieure
du dos , 1a poitrine , le ventre, les côtés, font
d’un très - bel orangé : une bande de la même
couleur s’étend au-deflus des ailes, en travers &
obliquement à leur origine : lés ailes & la queue
font noires, mais les grandes plumes des ailes
font bordées extérieurement par une ligne blanche
& noire , 8t celles de la queue font terminées par
de l’orangé, excepté les deux du milieu qui font
entièrement noires ; le bec, les pieds, les ongles,
font de couleur de plomb. Les baltimores fe trouvent
en été dans la Virginie & le Maryland. On en
voit auffi dans le Canada. Ils difparoiflent en
hiver. Ils placent leur nid fur les arbrès les plus
élevés , ordinairement à l’extrémité d’une branche
aflez forte, & pour l’aflurer ils entrelacent dans
fes bords une menue branche, ou un rejetton,
de chaque côté.
La femelle a des couleurs moins vives que le
mâle, & il n’y a point de mélange de blanc ni
d’orangé fur fes ailes ôt fa queue, qui font purement
noires.
B a l t im o r e b a t a r d *
PL enl. ƒ 06 fig. 2.
’ B riss. tome II, page ht.
C a t . tome I,pag. 4p. Pl. 49.
Le baltimore bâtard, avec la taille, la forme
tous les caraâères du baltimore , n’en diffère que
par quelques traits dans le plumage , St par des
nuances plus ternes dans les mêmes couleurs.
Voyeç Ba l t im o r e . La tête, au- lieu d’être entièrement
noire & d’un noir brillant, eft variée
de quelques taches jaunes, & elle eft d’un noir
terne. Ce qui eft d’un orangé vif dans le baltimore
, eft d’un jaune aflez pâle dans le baltimore
bâtard ; le noir des ailes , de la gorge & de la
queue , eft également beaucoup moins brillant
que dans le baltimore& tire fur le brun. Les
deux plutnes du milieu de la queue ne font que
noirâtres dans leur longueur , olivâtres à leur
origine, & terminées par un jaune fade : la fui-
vante de chaque côté eft confufément teinte
d’olivâtre & de noir, & Ips quatre autres plumes
le font auffi confufément de jaune & d’olivâtre. r
M. de Montbeillard regarde le baltimore bâtard
comme une variété dans l’efpèce du baltimore.
L’un & l’autre habitent les mêmes contrées, &
ont entr’eux de très-grands rapports. Mais Çatesby
qui les obfervoit fur le lieu, les a diftingués ; il a
même donné la figure & la -defeription de Ta
femelle du dernier. Il eft vrai qu’à juger de ces
oifeaux par les figures qu’en donne Catesby , il
eft difficile de croire que l’oifeau qu’il déftgne
pour être la femelle du baltimore bâtard, la fort
en effet, puifqu’elle a des couleurs plus vives
que celles du mâle , - ce qui eft généralement
contraire à l’obfervation. On pourront donc juger j
que Catesby a donné pour la femelle du balti- 1
more bâtard, l’oifeau qui eft la" femelle du baltimore
, & à juger par analogie, par ce qui arrive
parmi les autres oifeaux, je croirois que le baltimore
bâtard, n’eft pas même une variété, niais un
jeune baltimore qüi n’a pas encore mué ; cependant
le fentiment d’un homme qiti- obfervoit fur les
lieux , comme' je l’ai remarqué ,• & qui obfervoit
les individus vivans , doit être préféré aux
conjeélures qu’on peut former à deux mille lieues ,
d’après l’examen de quelques peaux defféchées.
Ainfi, malgré la vraifemblance de l’identité d’efi-
pece entre le baltimore & le baltimore bâtard,
je crois qu’on doit, fur la foi de Catesby , regarder
ces oifeaux comme faifant deux efpèces, juf- J
qu’a ce qu’un nouvel obfervateur, placé dans les
memes circonftances , nous ait appris le contraire.
B a l t im o r e v e r d . Br iss, tome II, pag. 113.
Voye£ SlFFLEUR.
BAMBLA.
r PI- enlum. 703, fig. 2.
Le bambla eft un fourmfllier. Voye{ Four- Millier. Il eft, fuivant la méthode de M. Brif-
fon , du genre XXII®. Sa longueur du bout du
bec a celui de la queue eft d’environ quatre
pouces.
Le deflus du corps, ainfi que les petites couvertures
des ailes, eft d’un brun roufsâtre, plus
foncé fur le bord des plumes; les grandes couvertures
&. les pennes des ailes font noires ; mais
il y a fur chacune de ces dernières plumes, vers
le tiers de leur longueur, à compter de leur origine
, une tache blanche, , ce qui forme, par la
reunion des taches, une bande tranfverfale blanche
fur chaque aile vers leur tiers fupérieiîr : la queue
eft grisâtre ; le deffous du corps eft d’un blanc fale,
mêlé de grisâtre : le bec eft noirâtre , plus long à
proportion que dans les autres fourmilliers, plus
crochu à fon extrémité-; les pieds font plombés &.
les ongles noirs. Get oifeau fe trouve à la Guiane,
mais il y eft rare.
BANIAHBOU de Bengale.
Merle de Bengale. Briss. tome II, page 260 , &
tome VI 3fiupl. page 43.
Grive brune dès Indes. Edw. tome IV, pag. 184.
PL 184.
Le baniahbou eft un oifeau du XXIIe genre , un
peu plus gros qu’une grive commune, dont le
plumage brun fur tout le corps, eft plus foncé fur
la partie fupérieure, plus clair fur la partie infé-
rieure & fur le bord des couvertures & des pennes i
des ailes : la queue étagée , longue d’environ trois
pouces, dépaffe les ailes pliées d’à-peu-près la
moitié de fa longueur : le bec ôt les pieds font
jaunes. Suivant M. Linné on trouve à la Chine
une variété de cette efpèce, dont le plumage eft
gris en r deflus du corps, de couleur de rouille
en-deffous, avec un trait blanc de chaque côté
dç la t,ête. M, Linné donne à cet oifeau l’épithète
de canorus. On en pourroit induire que
ce n’eft pas une variété du baniahbou, duquel on
ne dit pas qu’il ait un chant agréable. Mais il
faudroit, pour établir une différence entre ces
deux oifeaux, d’après ce caraélère, être certain
que le baniahbou n’a pas un chant agréable, ce
qu’on ne fçauroit conclure d’une Ample réticence ,
qui n’eft peut-être qu’une omiffion dans l’hiftoire
de cet oifeau. Il fe trouve au Bengale, oh les
habitans du pays lui donnent le nom qu’on lui a
confervé dans notre langue.
BARBAI A N. Voye^ Duc.
BARBICAN (le).
Planche enl. 602.
Le barbie an a les jambes couvertes de plumes
jufqu’au talon : quatre doigts , deux placés en-
•avant, deux en arrière : le bec auffi large à fa
bafe que la tête éft groffe , dentelé fur fes bords ,
comprimé & canelé fur les côtés, entouré à fa
bafe de poils roides, fort longs , St dirigés en-
avant, la langue charnue. Il reffemble aux toucans
& aux barbus par le nombre & la pofttion
de fes doigts ; aux premiers , par la groffeur &
les dentelures de fon bec ; aux féconds, par les
poils qui en entourent la bafe , & par la conformation
de fa langue. Mais il diffère des toucans
j en ce que fon bec n’eft pas auffi long,
qu’il eft d’une fubftance plus compare , qu’il n’eft:
courbé en bas qu’à l’extrémité de la mandibule
fupérieure, au lieu que dans les toucans les deux
mandibules ont leur pointe inclinée en bas : le
barbican diffère des barbus, en ce que fon bec eft
à proportion plus fort, en ce que fa pointe eft plus
courbée , & qu’il eft dentelé ; enfin il diffère & des
toucans & des barbus , en ce que fon bec eft . comprimé
fur les côtés , & qu’il eft cannelé. Le barbican,
en reflemblant fous certains afpeéls aux toucans
fous d’autres aux barbus , n’eft, à ftn élément le
confidérer , ni du genre des uns , ni de celui des
autres : il forme un genre nouveau intermédiaire
& mixte entre les toucans St les barbus ; cependant
il a plus de rapports avec les premiers, non-
feulement par les caraélères déjà énoncés -, mais
par les couleurs de fon plumage & la manière
dont elles font diftribuées. On peut le regarder,
comme le repréfentant, dans l’ancien continent ,
des toucans , qui font particuliers au nouveau.
Le nom de barbican qui lui a été donné par M. de
Buffon, avant lequel les auteurs ne l’avoient pas
décrit, préfente une idée fort jufte de fa nature
mixte.
Le barbican â été apporté des côtes de Barbarie :
il n’y eft probablement pas rare;.çar on en a
confécutivement apporté un aflez 'grand nombre
; d’individüs, Il a neuf pouces de long, fa queue
! trois & demi ; fon bec dix-huit lignes de long fur
dix d’épaiffeur.
La tête, le derrière & les côtés du cou, tout
le deflus du corps , les ailés & la queue font noirs ;
la gorge, la partie antérieure du cou font rouges ;
S s s ij