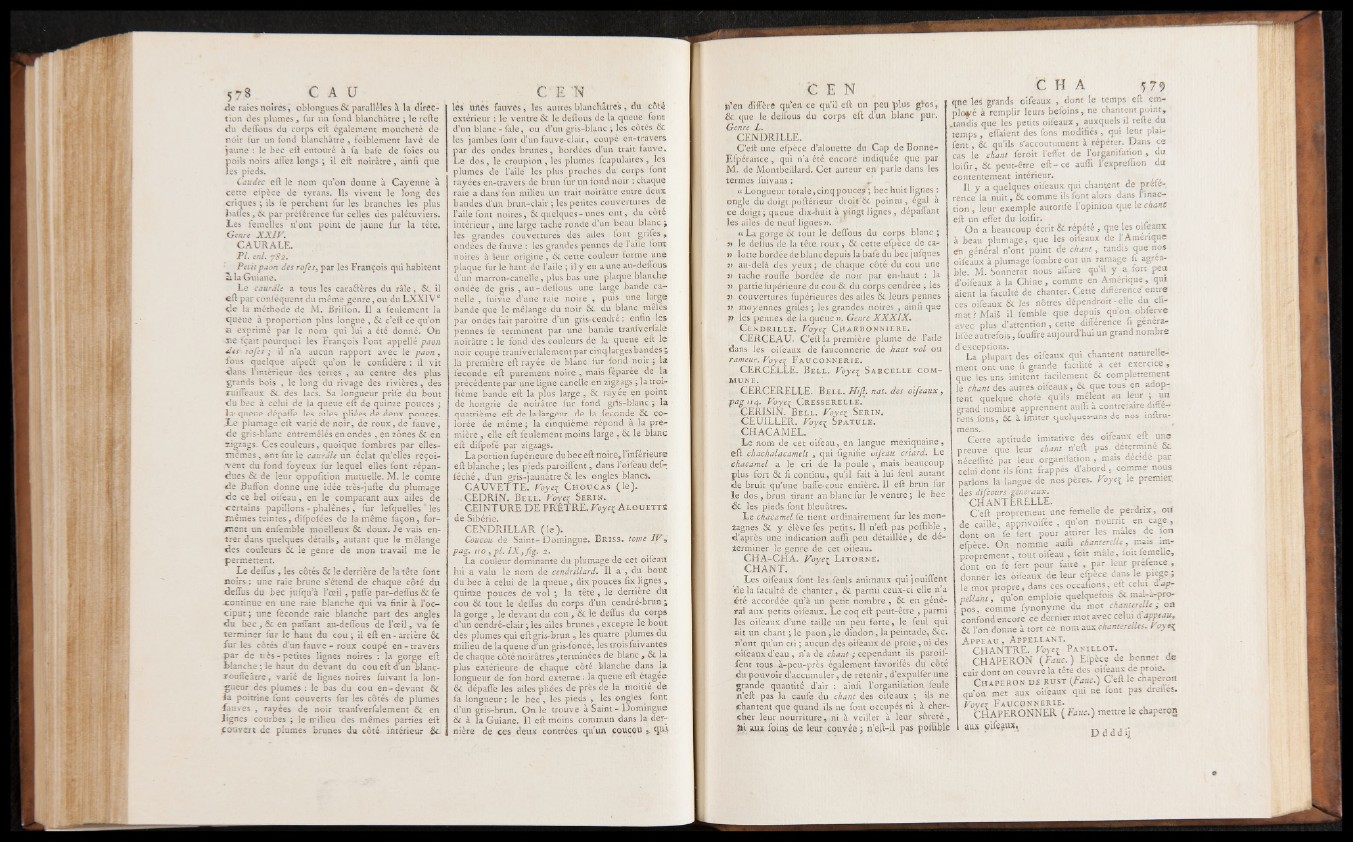
57.3 C A U
•de raies noirés, oblongues^ôc parallèles à la clîréc-?
tion des plumes , fur un fond blanchâtre ; le refte
du deffous du corps eft également moucheté de
noir fur un fond blanchâtre, foiblement lavé de
jaune : le bec eft entouré à fa bafe de foies ou
poils noirs allez longs ; il eft noirâtre, ainfi que
les pieds.
Caudec eft le nom qu’on donne à Cayenne à
cette efpèce de tyrans. Ils vivent le long des
criques ; ils fe perchent fur les branches les plus
baffes j & par préférence fur celles des palétuviers.
Les femelles n’ont point de jaune fur la tête.
Genre XXIV.
CAURALE.
PI. enl. 78 2.
Petit paon des rofes, par les François qui habitent
a la Guiane.
Le caurâle a tous les caraélères du râle, &_ il
eft par conléquent du même genre, ou du LXX1V®
<le la méthode de M. Briffon. Il a feulement la
queue à proportion plus longue, & c’eft ce qu’on
a exprimé par le nom qui lui a été donné. On
ne içait pourquoi les François l’ont appellé paon
des rofes ; il n’a aucun rapport avec le paon,
lous quelque afpeô qu’on le conlidère : il vit
dans l’intérieur des terres , au centre des plus
grands bois , le long du rivage des rivières, des
ruiffeaux &_ des lacs. Sa longueur prife du bout
du bec à celui de la queue eft de quinze pouces ;
la* queue dépaffe les ailes- pliées de deux pouces.
L e plumage eft varié de noir, de roux, de fauve,
de gris-blanc entremêlés en ondes , en zones & en
zigzags. Ces couleurs, quoique fombres par elles-
mêmes , ont fur le caurâle un éclat qu’elles reçoivent
du fond foyeux fur lequel elles font répandues
& de leur oppofition mutuelle. M. le comte
de Buffon donne une idée très-jufte du plumage
de ce bel oifeau, en le comparant aux ailes de
certains papillons - phalènes , fur lefqueiles ’ les
mêmes teintes, difpofées de la même façon, forment
un enfemble moëlleux & doux. Je vais entrer
dans quelques détails , autant que le mélange
des couleurs & le genre de mon travail me le
permettent.
Le deflus , les côtés & le derrière de la tête font
noirs: une raie brune s’étend de chaque côté du
deflus du bec jufqu’à l’oe il, paffe par-deflus & fe
-continue- en une raie blanche qui va finir à l’occiput
; une fécondé raie blanche part des angles
du bec y & en paffant au-deflous de l’oe il, va fe
terminer fur le haut du cou ; il eft en - arrière &
iur les côtés d’un fauve - roux coupé en - travers
par de très - petites lignes noires : la gorge eft
blanche; le haut du devant du cou eft d’un blanc-
rouffeâtre, varié de lignes noires fuivant la longueur
des plumes : le bas du cou en - devant &
la poitrine font couverts fur les côtés de plumes
fauves , rayées de noir tranfverfalement & en
lignes courbes ; le milieu des mêmes parties eft
couvert de plumes brunes du côté intérieur &.
C E ' N
lès unes fauves, les autres blanchâtres, du côté
extérieur : le ventre & le deflous de la queue font
d’un blanc - fale, ou d’un gris-blanc ; les cotés 8c.
les jambes font d’un fauve-clair, coupé en-travers
par des ondes brunes, bordées d’un trait fauve.
Le dos, le croupion , les plumes fcapulaires, les
plumes de l’aile les plus proches du corps font
rayées en-travers de brun fur un tond noir : chaque
raie a dans* fon milieu un trait noirâtre entre deux
bandes d’un brun-clair ; les petites couvertures de
l’aile font noires, & quelques-unes ont, du coté
intérieur, une large tache ronde d’un beau blanc ;
les grandes couvertures des ailes font grifes ,
ondées de fauve : les grandes pennes de l’aile lont
noires à leur origine, & cette couleur torme une
plaque fur le haut de l’aile ; il y en a une au-deflous
d’un marron-canelle, plus bas une plaque blanche
ondée de gris , au - deffous- une large bande candie
, fuivie d’une raie noire , puis une largue
bande que le mélange du noir Si du blanc meles
par ondes fait paroître d’un gris-cendre: enfin les
pennes fe terminent par une bande tranlverfale
noirâtre : le fond des couleurs de la queue eft le
noir coupé tranfverlalement par cinq larges bandes J
la première eft rayée de blanc fur fond noir ; la
fécondé eft purement noire , mais feparee de la
précédente par une ligne canelle en zigzags ; la troi-
lième bande eft la plus large, & rayée en point
de hongrie de noirâtre fur fond gris-blanc.; la
quatrième eft de la largeur de la leconde & colorée
de même ; la cinquième, répond à la première
, elle eft feulement moins large , & le blanc
eft difpofé par zigzags.
La p o r tio n fu p é r ieù re du b e c e f t n o ir e , l’in fé r ieu re
e f t b la n ch e ; le s pied s p a r o i f fe n t , dans l’o ife au def-,
f é c h é , d’un gris-j aunâtre& le s ongles, b la n c s .
CAUVETTE. Voyez C h o u c a s ( l e ) .
. CEDRIN. B e l l . Voyez S e r i n .
CEINTURE DE PRÊTRE. Voyez A l o u e t t s
de Sibérie.
CENDRILLAR ( le ) .
Coucou de Saint-Domingue. B r i s s . tome IV 9
pag. no , pl. iXyfig. 2.
La couleur dominante du plumage de cet oifeau
lui a valu le nom de cendrillard. Il a , du bout
du bec à celui de la queue, dix pouces ftx lignes ,
quinze pouces de vol ; la tête , le derrière du
cou & tout le deflus du corps d’un cendré-brun j
la gorge , le devant du cou , 8c le deflus du corps
d’un cendré-clair ; les ailes brunes , excepte le bout
des plumes qui eft gris-brun , les quatre plumes du
milieu de la queue d’un gris-foncé, les trois fuivantes
de chaque coté noirâtresterminées de blanc , 8c la
plus extérieure-de chaque côté blanche dans la
longueur de fon bord externe : la queue eft etagee
& dépaffe les ailes pliées de près de la moitié de
fa longueur : le bec, les pieds les ongles font
d’un gris-brun. On le trouve à Saint - Domingue
& à la Guiane. Il eft moins commun dans la dernière
de ces deux contrées qu’un coucou > qui.
C E N
n’en diffère qu*en ce qu’il eft un peu plus gl*os,
& que le deffous du corps eft d’un blanc pur.
Genre L.
CENDRILLE.
C ’eft: une efpèce d’alouette du Cap de Bonne-
Efpérance, qui n’a été encore indiquée que par
M. de Montbeillard. Cet auteur en parle dans les
termes fuivans :
« Longueur totale, cinq pouces ; bec huit lignes :
ongle du doigt poftérieur droit '& pointu , égal à
ce doigt ; queue dix-huit à vingt lignes, dépaffant
les ailes de neuf lignes».
a La gorge & tout le deffous du corps blanc ;
« le delliis de la tête roux, 8c cette efpèce de ca-
» lotte bordée de blanc depuis la bafe du bec jufques 3> au-delà des yeux; de chaque côté du cou une 3> tache rouffe bordée de noir par en-haut : la 3> partie fupérieure du cou 8c du corps cendrée ; les
V couvertures fupérieures des ailes & leurs pennes
v moyennes grifes ; les grandes noires , ainfi que
?> les pennes de la queue ». Genre XXXIX.
C eNDRILLE. Voyez CHARBONNIERE.
CERCEAU. C’eft la première plume de l’aile
«dans les oifeaux de fauconnerie de haut vol ou
rameur. Voyez F a u c o n n e r i e .
. CERCELLE. B e l l . Voyez S a b c e l l e c o m m
u n e .
CERCERELLE. Be l l . Hifl. nat. des oifeaux,
pag ii4. Voyez C r es ser e lle.
CERISIN. Be l l . Voyez Se r in .
CEUILLER. Voyez Sp a t u l e .
CHACAMEL.
Le nom de cet oifeau, en langue mexiquaine,
eft chachalacamelt , qui Lignifie oifeau criard. Le
chacamel a le cri de la poule , mais beaucoup
plus fort 8c fi continu, qu’il fait à lui feul autant
«de bruit qu’une baffe-çour entière. Il eft brun fur
le dos, brun tirant au blanc fur le ventre ; le bec 6c les pieds font bleuâtres.
Le chacamel fe tient ordinairement fur les montagnes
Sc y élève fes petits. 11 n’eft pas poflible ,
d’après une indication .aufli peu détaillée, de déterminer
le genre de cet oifeau.
CHA-CHA. Voyez Litorne.
CHANT.
Les oifeaux font les feuls animaux qui j ouiffent
rie la faculté de chanter , 8c parmi ceux-ci elle n’a
.été accordée qu’à un petit nombre , 8c en général
aux petits oifeaux. Le coq eft peut-être , parmi
les oifeaux d’une taille un peu forte, le feul qui
ait un chant ; le paon, le dindon, la pèintade, Sec.
n’ont qu’un cri ; aucun des oifeaux de proie, ni des
©ife aux d’eau , n’a de chant ; cependant ils par cillent
tous- à-peu-près également favorifés du côté
du pouvoir d’accumuler, de retenir, d’expulfer une
grande quantité d’air : ainfi l’organifation feule
n’eft pas la caufe du chant des oifeaux ; ils ne
.«chantent que quand ils ne font occupés ni à chercher
leur nourriture, ni à veiller à leur sûreté ,
Sri ,aux fpin$ de leur couvée ; n’eft-il pas poflible
C H A 579
que lés grands oifeaux , dont le temps eft employé
à remplir leurs befoins, ne chantent point,
.tandis que les petits oifeaux , auxquels il refte du
temps, effaient des fons modifiés, qui leur plai-
fent, 8c qu’ils s'accoutument à répéter. Dans ce
cas le chant feroit l’effet de l’organifation , du
loifir, & peut-être eft-ce aufli fexpreflion du
contentement intérieur.
Il y a quelques oifeaux qui chantent de prete-
rence la nuit, 8c comme ils font alors dans l’inaction
, leur exemple autorife l’opinion que le chant
eft un effet du loifir.
On a beaucoup écrit 8c répété , que les oifeaux
à beau plumage, que les oifeaux de 1 Amérique
en général n’ont point de chant ,• tandis que nos
oifeaux à plumage fombre ont un ramage fi agréable.
M. Sonnerat nous allure qu’il y a fort peu.
d’oifeaux à la Chine, comme en Amérique, qui
, aient la faculté de chanter. Cette différence entre
ces oifeaux & les nôtres dépendroit - elle du cli-
; mat? Mai5 il fernble que depuis qu’on, oblerve
j avec plus d’aftention, cette différence u genera-
lifée autrefois, fouffre aujourd’hui un grand nombre
d’exceptions. .. .
La plupart des oifeaux qui chantent naturellement
ont une fi grande facilite à cet exercice ,
que les uns imitent facilement 8c complettement
le chant des autres oifeaux, 8c que tous en adoptent
quelque chofe qu'ils mêlent au leur ; un
grand nombre apprennent aufli à contrelaire diffe-
rens fons, 8c à imiter quelques-uns de nos inftra-
mens.^ -
Cette aptitude imitative des oifeaux elt une
preuve que leur chant n’eft pas déterminé 8c
néceflité par leur organilation , mais décidé par
celui dont ils font frappés d’abord ; comme nous
parlons la langue de nos pères. Voyez le premier
des difeours généraux.
CHANTERELLE.
C ’eft proprement une femelle de perdrix, ou
de caille, apprivoifée , qu’on nourrit en cage ,
dont on fe fert pour attirer les mâles de fon
efpèce. On nomme aufli chanterelle, mais improprement
, tout oifeau , foit mâle, loir femelle,
dont on fe fert pour faire , par leur prefence ,
donner les oifeaux de leur efpèce dans le piege ;
le mot propre, dans ces occafions, eft celui àap-
pellaht, qu’on emploie quelquefois & mal-a-pro-
: pos, comme fynonyme du mot chanterelle ; on
confond encore ce dernier mot avec celui d appeau,
& l’on donne à tort ce nom aux chanterelles. Voye^
A p p e a u , A p p e l l a n t .
CHANTRE, f o y c ï P a n i l l o t .
CHAPERON {Fauc.) Efpèce de bonnet ce
cuir dont on couvre la tête des oifeaux de proie.
C h a p e r o n d e r u s t (Fauc.) C e ft le c h a p e ro n
qu ’ o n m e t a u x o ife a u x q u i n e fo n t p a s d r e ile s .
Foyer F a u c o n n e r i e .
CHAPERONNER ( Fauc.) mettre le chaperon
aux oifeaux. , ,..
■ D d d d ij