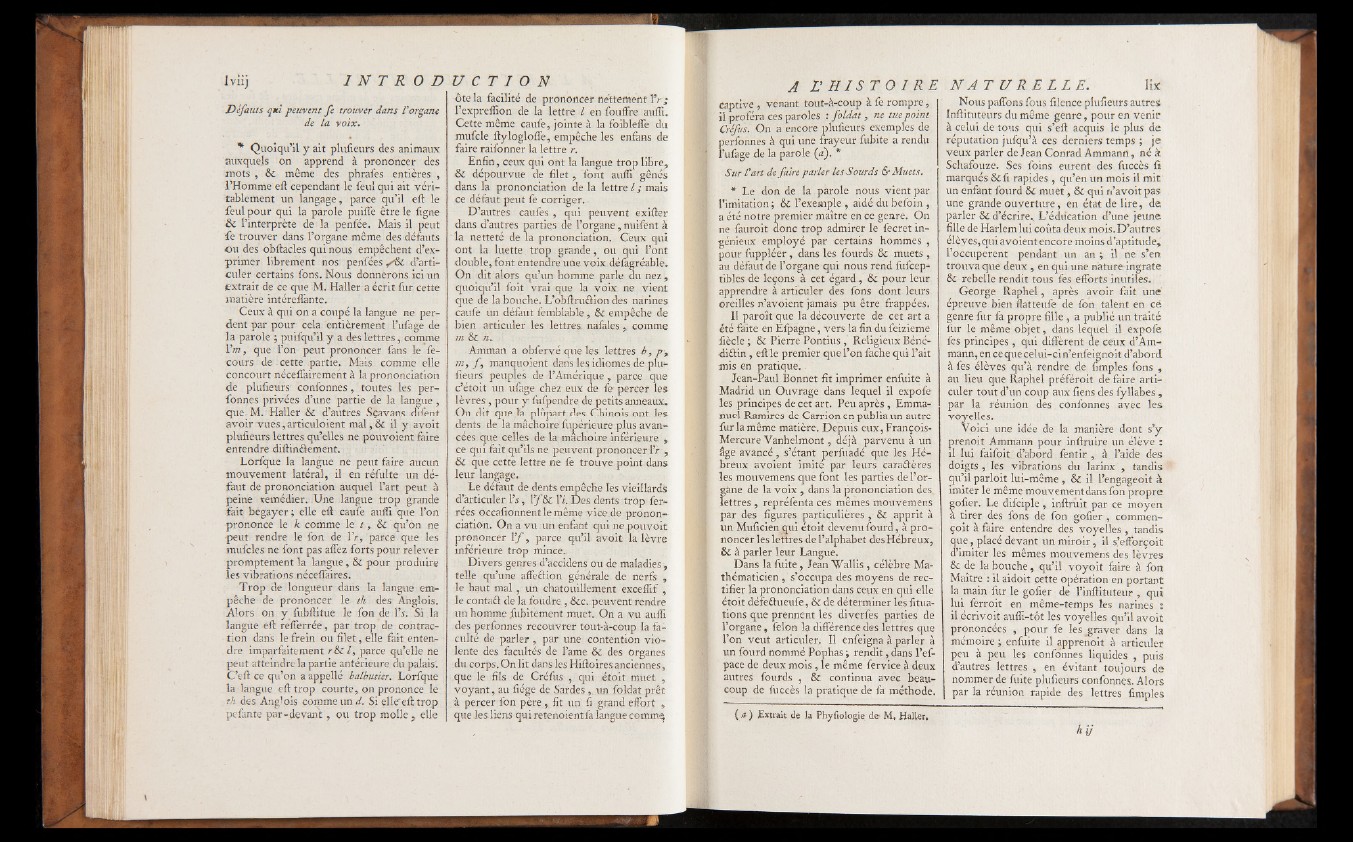
Défauts qui peuvent fe trouver dans l'organe
de la voix.
* Quoiqu’il y ait plulieurs des animaux
auxquels on apprend à prononcer des
mots , & même des phrafes entières ,
l ’Homme eft cependant le feul qui ait véritablement
un langage, parce qu’il eft le
feul pour qui la parole puifl'e être le ligne
Sc l’interprète de la penfée. Mais il peut
le trouver dans l’organe même des défauts
o u des obftacles qui nous empêchent d’exprimer
librement nos penfées /Sc d’articuler
certains fons. Mous donnerons ici un
extrait de ce que M. Haller a écrit fur cette
matière intéreffante.
Ceux à qui on a coupé la langue ne perdent
par pour cela entièrement l’ufage de
la parole ; puifqu’il y a des lettres, comme
Vm, que l’on peut prononcer fans le fe-
cours de - cette partie. Mais comme elle
concourt néceffairemeht à la prononciation
de plufieurs confonnes , toutes Tes personnes
privées d’une partie de là langue,
que M. Haller & d’autres Sçavans. difent
avoir vues, articuloient m a l,& il y avoit
plulieurs lettres qu’elles ne pouvoient faire
entendre diftinâement.
Lorfque la langue ne peut faire aucun
mouvement latéral, il en réfulte un défaut
de prononciation auquel l’art peut à
peine remédier. Une langue trop grande
fait begayer ; elle eft caufe aulîi que l’on
prononce le k comme le t , Sc qu’on ne
-peut rendre le fon de IV, parce que les ;
mufcles ne font pas allez forts pour relever
promptement la langue, Sc pour produire
les vibrations néceffaires.
Trop:de longueur dans la langue-empêche
de prononcer le th des Anglois.
Alors on y fubftitue le fon de IV. Si la
langue eft refferrée, par trop de contraction
dans le frein ou filet, elle fait entendre
imparfaitement rS c l, parce qu’elle ne
peut atteindre la partie antérieure nu palais.
C ’eft ce qu’on a appelle balbutier. Lorfque
la langue eft trop courte, on prononce le
th des Angl ois comme un d. Si elle"eft trop
pefante par-devant, ou trop molle, elle
ôte la facilité de prononcer nettement IV;
l’expreflion de la lettre l en fouffre aufîî.
Cette même caufe, jointe à la foibleffe du
mufcle ftylogloffe, empêche les enfans de
faire raifonner la lettre r.
Enfin, ceux qui ont la langue trop libre,
Sc dépourvue de filet , font auffi gênés
dans la prononciation de la lettre / ; mais
ce défaut peut fe corriger.
D ’autres caufes , qui peuvent exifter
dans d’autres parties de l’organe, nuifent à
la netteté de la prononciation. Ceux qui
ont la luette trop grande, ou qui l’ont
double, font entendre une voix défagréable.
On dit alors qu’un homme parle du nez,
quoiqu’il foit vrai que la voix ne vient
que de la bouche. L’obftruélion des narines
caufe un défaut femblable, & empêche de
bien articuler les lettres nafales,. comme
m Sc n.
Amman a obfervé que les lettres b, p ,
m, ƒ , manquoient dans les idiomes de plu*-
fieurs peuples de l’Amérique, parce que
c’étoit tin ufage chez eux de fe percer les
lè v re s, pour y fufpendre de petits anneaux.
On dit que la plupart des Chinois ont les
dents de la mâchoire.fupérieure plus avancées,
que celles de la-mâchoire inférieure ,
ce qui fait qu’ils ne peuvent prononcer IV ,
& que cette lettre ne fe trouve point dans
leur langage.
Le défaut de dents empêche lés vieillards
d’articuler IV, lj f& l’i. Des dents trop ferrées
occafionnent le même vice de prononciation.
On a vu un enfant qui ne pouvoit
prononcer 1’/ , parce qu’il avoit la lèvre
inferieure trop mince-
Divers genres d’accidens ou de maladies^
telle qu’une affeflion générale de nerfs ,
le haut mal , un chatouillement exceffif ,
le contaél de la foudre, &c.. peuvent rendre
un homme /ubitement muet. On a vu auffi
des perfonnes recouvrer tout-à-coup la faculté
de parler , par une contention v iolente
des facultés de l’ame & des organes
du corps.On lit dans les Hiftoiresanciennes,
que le fils de Créfus , qui étoit muet ,
voyant, au fiége de Sardes ,. un foldat prêt
à percer fon père, fit un fi grand effort ,
que les liens qui retenoientfa langue comm$
captive, venant tout-à-coup à fe rompre,
il proféra ces paroles : foldat , ne tue point
Créfus. On a encore plufieurs exemples de
perfonnes à qui une frayeur fubite a rendu
l’ufage de la parole (a). *
Sur l'art de faire parler les Sourds & Muets.
* Le don de la parole nous vient par
l’imitation ; Sc l’exemple , aidé du befoin ,
a été notre premier maître en ce genre. On
ne fauroit donc trop admirer le fecret in- ,
génieux employé par certains hommes ,
pour fuppléer, dans les fourds Sc muets ,
au défaut de l’organe qui nous rend fufcep-
tibles de leçons à cet égard, Sc pour leur
apprendre à articuler des fons dont leurs
oreilles n’avoient jamais pu être frappées.
Il paroît que la découverte de cet art a
été faite en Efpagne, vers la fin du feizieme
fiècle ; Sc Pierre Pontius, Religieux Béné-
d iûin, eft le premier que l’on fâche qui l’ait
mis en pratique..
Jean-Paul Bonnet fit imprimer enfuite à
Madrid un Ouvrage dans lequel il expofe
les principes de cet art. Peu après, Emmanuel
Ramires de Carrion en publia un autre
fur la même matière. Depuis eux, François-
Mercure Vanhelmont, déjà parvenu à un
âge avancé, s’étant perfuadé que les Hébreux
avoient imite par leurs caractères
les mouvemens que font les parties de l’organe
de la v o ix , dans la prononciation des.
lettres , repréfenta ces mêmes mouvemens
par des figures particulières , Sc apprit à
Un Muficien qui etoit devenu lourd, à prononcer
les lettres de l’alphabet des Hébreux,
Sc à parler leur Langue.
Dans la fuite, Jean Wallis, célèbre Mathématicien
, s’occupa des moyens de rectifier
la prononciation dans ceux en qui elle
étoit défeûueufe, Sc de déterminer les fitua-
tions que prennent les diverfes parties de
l’organe, félon la différence des lettres que
l’on veut articuler. Il enfeigna à parler à
un fourd nommé Pophas ; rendit, dans l’ef-
pace de deux mois, le même fçrvice à deux
autres fourds , Sc continua avec beaucoup
de fuccès la pratique de fa méthode.
(» ) Extrait de la Phyfiologie de- M, Haller,
Nous paffons fous filence plufieurs autres
Inftituteurs du même genre, pour en venir
à celui de tous qui s’eft acquis le plus de
réputation jufqu’à ces derniers temps ; je
veux parler de Jean Conrad Âmmann, né à
Schafouze. Ses foins eurent des fuccès fi
marqués & f i rapides , qu’en un mois il mit
un enfant fourd & muet, & qui n’avoit pas
une grande ouverture, en état de lire, de
parler Sc d’écrire» L’éducation d’une jeune
fille de Harlem lui coûta deux mois. D ’autres
élèves, qui avoient encore moins d’aptitude,
l’occuperent pendant un an ; il ne s’en
trouva que deux, en qui une nature ingrate
Sc rebelle rendit tous fes efforts inutiles.
George Raphel, après avoir fait une
épreuve bien flatteufe de fbn talent en cé
genre fur fa propre fille , a publié un traité
fur le même objet, dans lequel il expofe
fes principes , qui diffèrent de ceux d’Am-
mann, en cequecelui-cin’enfeignoit d’abord
à fes élèves qu’à rendre de fimples fons ,
au lieu que Raphel préféroit de faire articuler
tout d’un coup aux liens des fyllabes ,
par la réunion des confonnes avec les
voyelles.
Voici une idée de la manière dont s’y
prenoit Ammann pour inftruire un élève :
il lui faifoit d’abord fentir , à l’aide des
doigts , les vibrations du larinx , tandis
qu’il parloit lui-même , Sc il l’engageoit à
imiter le même mouvement dans fon propre
gofier. Le difciple , inftrùit par ce moyen
à tirer des fons de fon gofier , commen-
çoit à faire entendre des voyelles , tandis
que, placé devant un miroir, il s’efforçoit
d’imiter les mêmes mouvemens des lèvres
& de la bouche, qu’il vo yo it faire à fon
Maître : il aidoit çette opération en portant
la main fur le gofier de l’inftituteur , qui
lui ferroit en même-temps les narines :
il écrivoit auffi-tôt les voyelles qu’il avoit
prononcées , pour fe les ^graver dans la
mémoire ; enfuite il apprenoit à articuler
peu à peu les confonnes liquides , puis
d’autres lettres , en évitant toujours de
nommer de fuite plufieurs confonnes. Alors
par la réunion rapide des lettres fimples
h V