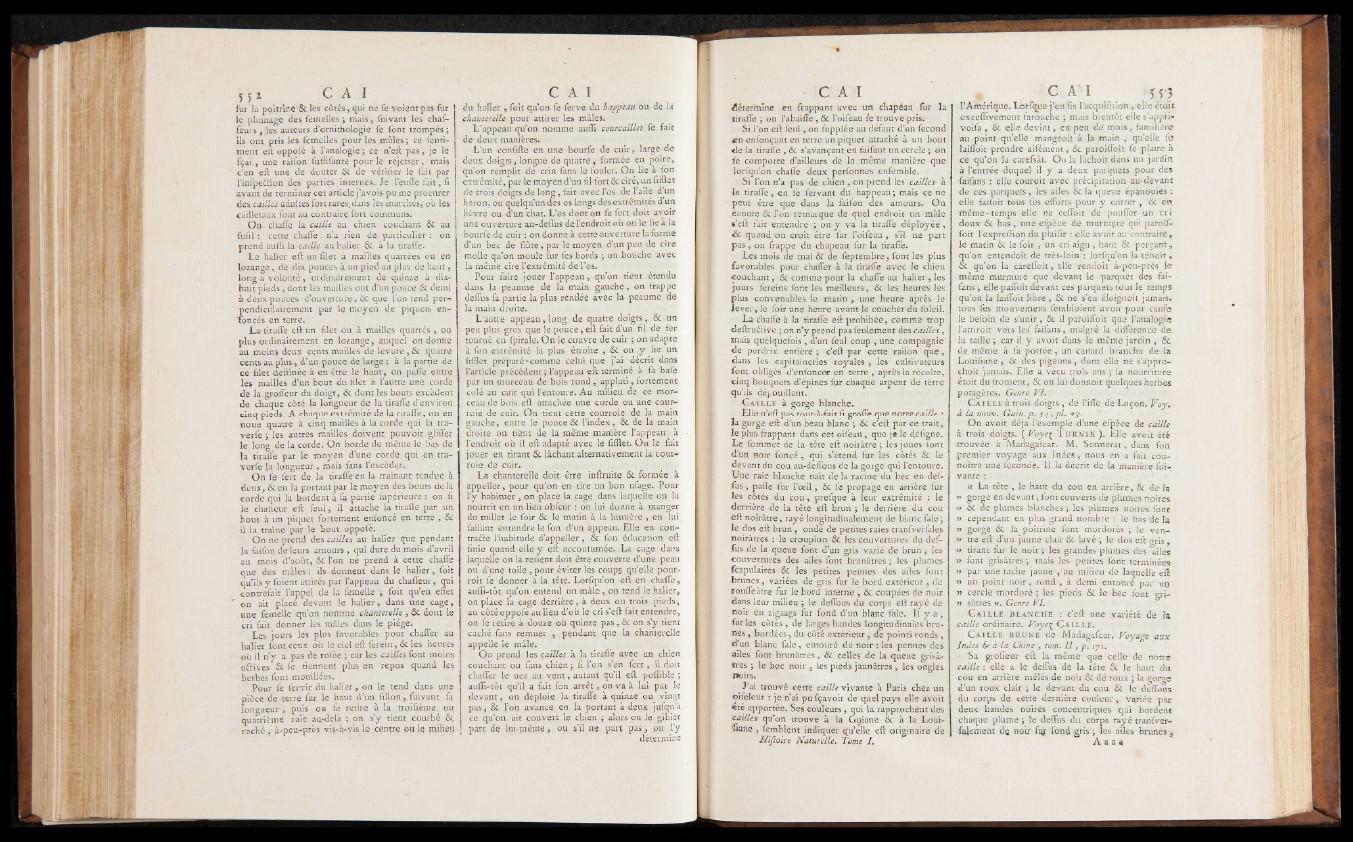
ç 5 2. C A I
fur la poitrine &. les côtés, qui ne fe voient pas fur
le plumage des femelles ; mais, fuivant les cliaf-
feurs , les auteurs d’ornithologie fe font trompés ;
ils ont pris les femelles pour les mâles ; ce fenti-
ment elt oppofé à l’analogie ; ce n’eft pas, je le
fçai, une raifon fuffifante pour le rejetter, mais
c’en eft une de douter & de vérifier le fait par
l’infpeétion des parties : internes. Je l'enfle fait, fi
avant de terminer cet article j’avois pu me procurer
des cailles adultes fort rares, dans les marchés,' où les
cailletaux font au contraire fort communs.
On chalfe la caille au chien couchant ôc au
fùfil : cette chaflfe - n’a rien de particulier : on
prend aufli la caille au halier & à la tirafle.
Le halier eft un filet à mailles quarrées ou en
lozange, de dix pouces à un pied au plus de haut,
long à volonté, ordinairement de quinze à dix-
huit pieds, dont les mailles ont d’un pouce & demi
à déux pouces d’ouvertureÔc que l’on tend perpendiculairement
par fo moyen de piquets enfoncés
en terre.
La tirafle eft un filet ou à mailles quarrés , ou
plus ordinairement en lozange, auquel on donne
au moins deux cents mailles de levure, Ôc quatre
cents au plus, d’un pouce de large : à la partie de
ce filet deftinée à en être le haut , on pafle entre
les mailles d’un bout du filet à l’autre une corde
de la grofleur du doigt, ôc dont les bouts excèdent
de chaque côté la longueur de la tirafle d’environ
cinq pieds. A chaque extrémité de la rirafle, on en
noue quatre à cinq mailles à la corde qui la tra-
verfe ; les autres mailles, doivent pouvoir glifler
le long de la corde. On borde de même le bas de
la tirafle par le moyen d’une corde qui en tra-
verfo la longueur., mais fans l’excéder.
On fe fert de la tirafle en la traînant tendue à
deux, & en la portant par le moyen des bouts de la
corde qui la bordent a fa partie fupérieure : ou fi
le chali'eur eft feul, il attache la tirafle par un
bout à un piquet fortement enfoncé çn terre , ôç
il la traîne par le bout oppofé.
On ne prend des cailles au halier que pendant
la faifon de leurs amours , qui dure du mois d’avril
au mois d’août, ôc l’on ne prend à cette chafle
que des mâles : ils donnent dans le halier, foit
qu’ils y foient attirés par l’appeau du chafleur, qui
contrefait l’appel de la femelle ; foit qu’en effet
on ait placé devant le halier, dans une cage,
une femelle qu’on nomme chanterelle , ôç dont le
cri fait donner les mâles dans le piège.
Les jours les plus favorables pour chafler au
halier font ceux où le ciel eft ferein, & les heures
où il n’y a pas de rofée, ; car les cailles font moins
a&ives ôc fe tiennent plus en repos quand les
herbes font mouillées.
Pour fe fervir du halier , on le tend dans une
pièce de terre fur le haut d’un fillon, fuivant fa
longueur , puis on fe retire à la troifième. ou
quatrième raie au-delà ; on s’y tient courbé ôç
caché , à-peu-près vis-à-vis. le centre ou le piUieu
C A I
du halier , foit qu’on fe ferve du happe au ou de la
chanterelle pour attirer les mâles.
L ’appeau qu’on nomme aufli courcaillet fe fait
de deux manières.
L’un conflfte en une bourfe de cuir, large de
deux doigts, longue de quatre , formée en poire,
qu’on remplit de crin fans le fouler. On lie à fon
extrémité, par le moyen d’un fil fort Ôc ciré, un fimet
cle trois doigts de long, fait avec l’os de l’aile d’un
héron, ou quelqu’un des os longs des extrémités d’un
lièvre ou d’un chat. L’os dont on fe fert doit avoir
une ouverture au-deflùs de l’endroit où on le lie à la
bourfe de cuir ; on donne à cette ouverture la forme
d’un bec de flûte, par le moyen d’un peu de cire
molle qu’on moule fur fes bords ; on bouche avec
la même cire l’extrémité de l’os.
Pour faire jouer l’appeau , qu’on tient étendu
dans la peàume de la main gauche, on frappe
deflùs fa partie la plus renflée avec la peaume de
la main droite.
L'autre appeau, long de quatre doigts, ôc un
peu plus gros que le pouce, eft fait d’un fil de fer
tourné en fpirale. On le couvre de cuir ; on adapte à fon extrémité la plus étroite , Ôc on y lie un
fifflet préparé-comme celui que j’ai décrit dans
l’article précédent ; l’appeau eft terminé à fa bafe
par un morceau de bois rond , applati, fortement
colé au cuir qui l’entoure. Au milieu de ce mor-
_ ceau de bois eft attachée une corde ou une courroie
de cuir. On tient cette courroie de la main
gauche, entre le pouce & l’index, ÔC de la main
droite on tient de la même manière l’appeau à
l’endroit où il eft adapté avec le fifflet. On le fait
jouer en tirant ôc lâchant alternativement la courroie
de cuir.
La chanterelle doit être inftruite Ôc formée à
appeller, pour qu’on en tire un bon ufage. Pour
l’y habituer , on place la cage dans laquelle on la
nourrit en un lieu obfcur : on lui donne à manger
du millet le foir & le matin à la lumière , en lui
faifant entendre le fon d’un appeau. Elle en con-
traâe l’habitude d’appellé-r, ôc fon éducation eft
finie quand elle y eft accoutumée, La cage dans
laquelle on la retient doit être couverte d’une peau
ou d’une toile, pour éviter les coups qu’elle pour-»
roit fe donner à la tête. Lorfqu’on eft en chafle,
aufli-tôt qu’on entend un mâle, on tend le halier,
on place la gage derrière, à deux ou trois pieds,
au côté oppofé au lieu d’où le cri s’eft fait entendre,
on fe retire à douze où quinze pas, ôc on s’y tient
caché fans remuer , . pendant que la chanterelle
appelle le mâle.
Qn prend les cailles à la tirafle avec un chien
couchant ou fans chien ; fl l’on s’en fert, il doit
chafler le. nez au vent, autant qu’il eft poflible ;
aulfi-tôt qu’il a fait fon arrêt, on va à lui par le
devant, on déploie la tirafle à quinze ou vingt pas/ & l’on avance , en la portant à deux jufqu’à
ce qu’on ait couvert le chien ; alors ou le gibier
part de lui-même, op s’il ne part pas, on l’y détermine
- C A I
détermine en frappant avec un chapéaü fur la
tirafle ; on l’abaifle , ôc l’oifeau fe trouve pris.1'
Si.l’on eft feul, on ftipplée au défaut d’un fécond
£n enfonçant en terre un piquet attaché à uii bout
de la tirafle , & s’avançant en faifant un cercle ; on
fe comporte d’ailleurs de la même manière que
lorfqu’on chafle deux perfonnes enfemble.
Si l’on n’a pas de chien , on prend les cailles à
la tirafle, en fe fervant du happeau; mais ce ne
peut être que dans la faifon des amours. On
écoute ôcl’on remarque de quel endroit un mâle
s’eft fait entendre ; on y va la tirafle déployée ,
ôc quand 'on croit être l’ur l’oifeau, s’il ne part
pas, on frappe du chapeau fur la tirafle.
Les mois de mai & de feptémb're, font les plus
favorables pour chafler à la tirafle avec lè chien
couchant, ÔC comme pour la chafle au halier , les
jours fereins font les meilleurs , ôc les heures les
plus convenables le matin , une heure après le
lever, le foir une heure avant le coucher dû foleil.
La chafle à la tirafle eft prohibée, comme trop
deftruélive,; on n’y prend pas feulement des cailles,
mais quelquefois , d’un feul coup , une compagnie
de perdrix entière ; c’eft par cette raifon que,
dans les- capitaineries royales , les cultivateurs
font obligés d’enfoncer en terre , après la récolte,
cinq bouquets d’épines fur chaque arpent de terre
qu’ils dépouillent. Caille à gorge blanche.
Elle n’eft pas tout-à-fait fl grofle que notre caille :
la gorge eft d’un beau blanc ; ôc c’eft par ce trait ,
le plus frappant dans cet oifeau, que je le défigne.
Le fommet de la tête eft noirâtre ; les joues iont
d’un noir foncé , qui s’étend fur les côtés ôc le
devant du cou au-deflous de la gorge qui l’entoure.
Une raie blanche naît delà racine du bec en def- I
fus, pafle far l’oeil, & fe propage en arrière fur
les côtés dix cou, prefque à leur extrémité : le
derrière de la tête eft brun ; le derrière du cou
eft noirâtre, rayé longitudinalement de blanc fale ;
le dos eft brun , onde de petites raies tranfverlaies
noirâtres : le croupion ôc les couvertures du defi-
jus .de la queue font d’un gris varié de brun; les
couvertures des ailés font brunâtres ; les plumes
fcapulaires Ôc les petites pennes des ailes font
brunes, variées de gris fur le bord extérieur , de
roufleâtre fur le bord interne , ôc coupées de noir
dans leur milieu. ; le deflous du corps eft rayé de
noir en zigzags fur fond d’un blanc fale. Il y a ,
fur les côtes , de larges bandes longitudinales brunes
, bordées, du çôté extérieur, de points ronds,
d’un blanc fale , entouré de noir : les pennes des
ailes font brunâtres, & celles de la queue grisâtres
; le bec noir , les pieds jaunâtres, les ongles
noirs.
' J’ai trouvé cette caille vivante à Paris chez un
oifeleur : je n’ai pu fçavoir de quel pays elle avoit
ete apportée. Ses coüleurs, qui la rapprochent des
cailles qu’on trouve à la Guiane ôc à la Louisiane
, fembfoht indiquer qu’elle eft originaire de
fiijloir.e Naturelle. Tome /,
C A I • 5 $'3
PAîhérique, Lorfque j’en fis racquifnion , elle étdit
exceflivement farouche ; mais bientôt elle s’appri*
voifa , & elle devint, en-peu dé mois, familière
au point qu’elle mange oit à la main , qu’elle fe
laifîbit prendre aifémentJ ôc paroifloit fe plaire à
ce qu’dn la carefsât. On la lâchoit dans un jardin
à l’entrée duquel il y a deux parquets pour des
faifans : elle couroit avec précipitation au-devant
de ces parquets, les ailes Ôc la queue épanouies :
elle failoit tous fes efforts pour y entrer , ôc en
même-temps elle ne cefloit de pouffer un cri
doux & bas, une efpèce .de mufmyre qui parbif-
foit fexpreflion du pïaiflr : elle avoit au contraire,
- le matin & le foir , un cri aigu , haut ôc perçant,
qu’on entendoit de très-loin : lorfqu’on la téhoit •
ôc qu’on la careflbit, elle rendoit à-pbu-près’ le
même murmure que devant le parquet dés fai-
fans ; elle paflbit devant ces parquets tout le temps
qu’on la laifloit libre , ôc ne s’en éloignôit jamais.
: tous fes mouvemens fémbloient avoir pour caufe
-le befoin dé s’unir, & il paroifloit que l’analogie
l’attiroit vers les’ faifans, malgré la différence de
la taille ; car il y avoit dans le même jardin , ÔC.
de même à fa portée , un canard bra-nchu de la
Louifiahe , ôc des pigeons , dont elle ne s’appro-
choit jamais. Elle a vécu trois -ans ; fa nourriture
étoit du froment, ôc on lui donnoit quelques herbe«
potagères. Genre VI.
C aille à trois doigts, de rifle de Luçon. Voy.
a la nouv. Guin. p. fa , pl. 23.
On avoit déjà l’exemple d’une efpèce de caille à trois doigts. ( Voye{ T ürnix ). Elle avoit été
trouvée à Madàgafcar. M. Sonnerat, dans foh
premier voyage aux Indes , nous en. a fait con-
-noître une fécondé. Il la décrit de la manière fui-
- vante :
a La tête , le haut du cou en arrière, & de la
” gorge en devant, font couverts de plumes noires
>» 6c de plumes blanches les plumes noires font
» cependant en plus grand nombre : le ba;s de là
•» gorge ôc la poitrine font mordorés ; le ven-
» tre eft d’un jaune clair Ôc lavé ; lé dos eft-gris ,
» tirant fur le noir; les grandes plumes.dés ailés
» font grisâtres ; mais les petites font terminées
» par une tache jaune , au milieu de laquelle eft
-j> un point noir, rond, à demi entouré par un
» cercle mordoré ; lès pieds ôc le bec font gri-
» sâtres ». Genre VL
C a i l l e b lan ch e : c’eft une variété de la
caille ordinaire. Voye£ C a i l l e . Caille brune de Madagafcar. Voyage aux
In d es & à la Chine , tara. 11, p. 171.
Sa grofleur eft la même que celle de notre
caille : elle a le deflùs de la tête ôc le haut du
cou en arrière mêlés de noir ôc dé roux ; la gorge
d’un roux clair ; le devant du cou ôc le deflous
du corps de cette dernière couleur, Variée par
deux bandes noires cohce’ntriques qui bordent
chaque plume ; lé deflùs du corps rayé tranfver-
fajement dq noir fof fond gris ; -les ailes brunes -y