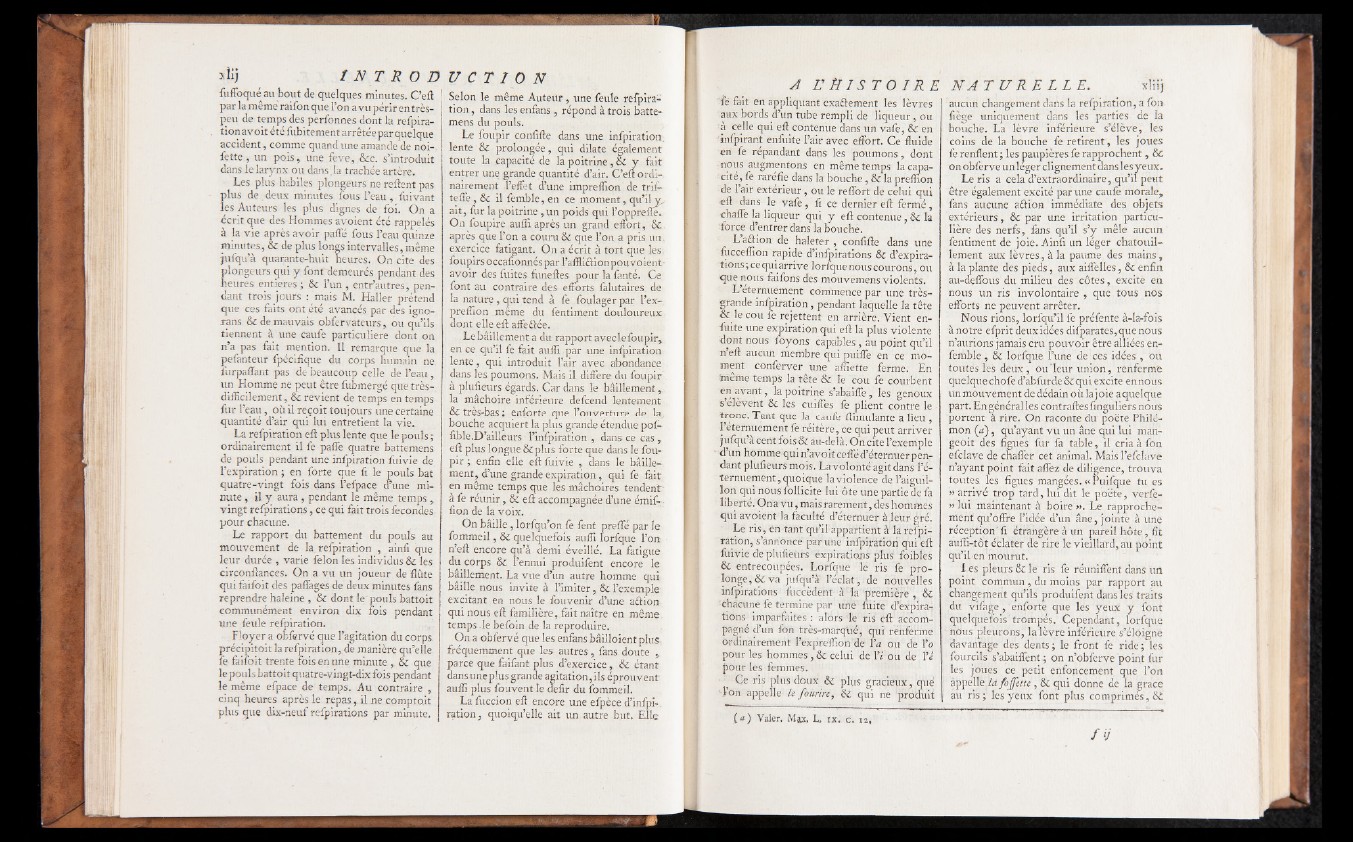
/ NT R 0 D
fuffoqué au bout de quelques minutes. C’eft I
par la même raifon que l’on a vu périr en très-
peu de temps des perfonnes dont la refpira-
tion avoit été fùbitement arrêtée parquelque
accident, comme quand une amande de noi-
fette , un pois, une feve, &c. s’introduit
dans le larynx ou dans.la trachée artère.
Les plus habiles plongeurs ne relient pas
plus d e . deux minutes fous l’eau, fuivant
les Auteurs les plus dignes de foi. On a
écrit que des Hommes avoient été rappelés
à la vie après avoir palfé fous l’eau quinze
minutes, & de plus longs intervalles, même
jufqu’à quarante-huit heures. On cite des
plongeurs qui y font'demeurés pendant des
heures entières ; & l’un , entr’autres, pendant
trois jours : mais M. Haller prétend
que ces faits ont été avancés par des ignorons
& de mauvais obfervateurs, ou qu’ils
tiennent à une caufe particulière dont on
n’a pas fait mention. Il remarque que la
pefanteur fpécifique du corps humain ne
iùrpaffant pas de beaucoup celle de l’eau ,
un Homme ne peut être fubmergé que très-
difficilement , &c revient de temps en temps
fur l’eau, où il reçoit toujours une certaine
quantité d’air qui lui entretient la vie.
La refpiration eft plus lente que le pouls ;
ordinairement il fe paffe quatre battemens
de pouls pendant une infpiration fuivie de
l’expiration ; en forte que fi le pouls bat
quatre-vingt fois dans l’efpace d’une minute
, il y aura, pendant le même temps ,
vingt refpirations, ce qui fait trois fécondés,
pour chacune.
Le rapport du battement du pouls au
mouvement de la refpiration , ainfi que
leur durée , varie félon les individus & les
cirçonftances. On a vu un joueur de flûte
qui faifoit des paflages de deux minutes fans
reprendre haleine , & dont le pouls battoit
communément environ dix fois pendant
une .feule refpiration,
Floyer a obfervé que l’agitation du corps
précipitoit la refpiration, de manière qu’elle
fe faifoit trente fois en une minute ,. & que
le pouls battoit quatre-vingt-dix fois pendant
le même efpace de temps. Au contraire ,
cinq heures après le repas, il ne comptoit
plus que dix-neuf refpirations par minute.
1 U C T 1 0 N
: Selon le même Auteur, une feule refpîra-
tion, dans les enfans, répond à trois battemens
du pouls.
Le foupir confîfte dans une infpiration.
lente & prolongée, qui dilate également
toute la capacité de la poitrine, & y fait
entrer une grande quantité d’air. C’eft ordinairement
l’effet d’une impreffion de trif-
teffe, & il femble, en ce moment, qu’il y ,
ait, fur la poitrine ,un poids qui l’opprefl’e..
On foupire auffi après un grand effort, & .
après que l’on a couru & que l’on a pris un,
exercice fatigant. On a écrit à tort que les
foupirs occafionnés par l’affliûipnppuvoient-
avoir des fuites funeftes pour la fanté. Ce
font au contraire des efforts falutaires. de
la nature , qui tend à fe foulager par l’ex-
preffion meme du fentiment douloureux
dont elle eft affeÛée.
Le bâillement a du rapport aveclefoupir,
en ce qu’il fe fait auffi par une infpiration
lente, qui introduit l’air avec abondance
dans les poumons. Mais il différé du foupir
à plufieurs égards. Car dans le bâillement ,
la mâchoire inférieure defcend lentement
& très-bas; enforte que l’ouverture de la
bouche acquiert la plus grande étendue pof-
fible.D’ailleurs l’infpiration , dans ce cas ,
eft plus longue &plus forte que dans le foupir
; enfin elle eft fuivie , dans le bâillement,
d’une grande expiration, qui fe fait
en même temps que les mâchoires tendent-
à fe réunir, & eft accompagnée d’une émif-
fion de la voix.
On baille, lorfqu’on fe fent preffé par le
fommeil, & quelquefois auffi lorfque l’on
n’eft encore qu’à demi éveillé. La fatigue’
du corps & l’ennui produifent encore le
bâillement. La vue d’un autre homme qui
bâille nous invite à l’imiter, & l’exemple
excitant en nous le fouvenir d’une action
qui nous eft familière, fait naître en même
temps le befoin de la reproduire.
On a obfervé que les enfans bâilloient plus
fréquemment que les autres, fans doute ,
parce que faifant plus d’exercice, & étant
dans une plus grande agitation, ils éprouvent
auffi plus fouvent le defir du fommeil.
La fuccion eft encore une efpèce d’infpi-,
ration, quoiqu’elle ait un autre but. Elle
a n H i s t o i r e
Lé fait en appliquant exaûement les lèvres
aux bords d’un tube rempli de liqueur, ou
à celle qui eft contenue dans un vafe, & en
infpirant enfuite l’air avec effort. Ce fluide
en fe répandant dans les poumons, dont
■ nous augmentons en même temps la capacité,
fe raréfie dans la bouche, & la preffion
de l’air extérieur, ou le reffort de celui qui
eft dans le v afe, fi ce dernier eft fermé,
chaffe la liqueur qui y eft contenue, & la
-force d’entrer dans la bouche.
L’action de haleter , confifte dans une
-fiicceflion rapide d’infpirations & d’expirations;
ce qui arrive lorfque nous courons, ou
que nous faifons des mouvemens violents.
L’eternuement commence par une très-
grande infpiration, pendant laquelle la tête
■ &^le cou fe rejettent en arrière. Vient ensuite
une expiration qui eft la plus violente
dont nous foyons capables, au point qu’il
n eft aucun membre qui puiffe en ce moment
conferver une affiette ferme. En
meme temps la tete & le cou fe courbent
en avant, la poitrine s’abaiffe, les genoux
s’elevent & les cuiffes fe plient contre le -
tronc. Tant que la caufe ftimulante a lieu ,
1 eternuement fe réitère, ce qui peut arriver
jufqu’à cent fois & au-delà. On cite l’exemple
■ dun homme qui n’avoit ceffé d’éternuer pendant
plufieurs mois. La volonté agit dans l’éternuement,
quoique la violence de l’aiguillon
qui nous follicite lui ôte une partie de fa
liberté. Ona v u , mais rarement, des hommes
qui avoient la faculté d’éternuer à leur gré.
Lé ris-, en tant qu’il appartient à la refpiration,
s’annonce par une infpiration qui eft
fuivie de plufiëiirs expirations plus foibles
& entrecoupées. Lorfque le ris fe prolonge,
& va jufqu’à 'l ’eclat, de nouvelles
infpirations fuccèdent à la'première , &
chacune fe termine par une fuite d’éxpira-j
tions imparfaites : alors-le ris eft accom-j
pagné d’un fôn très-marqué, qui rèhferme
ordinairement l’expreffion de l’a Ou de l’o
pour les hommes ,& celui d el’Fou de l’é
pour les femmes.
Ce ris plus doux &c plus gracieux, qtié
‘ l’on appelle le foùrire, ik. qui ne ‘produit
N A T U R E L L E. xîiij
aucun changement dans la refpiration, a ton
fiège uniquement dans les parties de la
bouche. La lèvre inférieure s’élève, les
coins de la bouche fe retirent, les joues
fe renflent ; les paupières fe rapprochent, &
onobferve unleger clignement dans les yeux,.
Le ris a cela d’extraordinaire, qu’il peut
être également excité par une caufe morale,
fans aucune aâion immédiate des objets
extérieurs, & par une irritation particulière
des nerfs, fans qu’il s’y mêle aucun
fentiment de joie. Ainfi un léger chatouillement
aux lèvres, à la paume des mains,
à la plante des pieds, aux aiffelles, & enfin
au-deffous du milieu des côtes, excité en
nous un ris involontaire , que tous nos
efforts ne peuvent arrêter.
Nous rions, lorfqu’il fe préfente à-la-fois
à notre efprit deuxidées dilparates,que nous
n’aurions jamais cru pouvoir être alliées en-
femble , & . lorfque l’une de ces idées , où
toutes les deux , ou ‘leur union, renferme
quelque chofe d’abfurde & qui excite ennous
un mouvement de dédain où lajoie aquelque
part. En général les contraftes finguliers nous
portent à rire. On raconte du poëté Philé-
mon (à) , qu’ayant vu un âne qui lui man-
geoit des figues fur fa table, il cria à fon
efclave de chaffer cet animal. Mais l’efclavè
n’ayant point fait affez de diligence, trouva
toutes, les figues mangées. «Puifque tu es
» arrivé trop tard, lui dit le poète, verfe-
» lui maintenant à boire ». Le rapprochement
qu’offre l’idée d’un âne, jointe à une
réception" fi étrangère à un pareil hôte, fit
aufti-tôt éclater de rire le vieillard, au point
qu’ihen mourut.
L ès pleurs & le ris fe réunifient dans un
point commun, du moins par rapport au
changement qu’ils produifent dans les traits
du vifage , enforte que lés yeux y font
quelquefois trompés. Cependant, lorfque
ndus pleurons, la lèvre inférieure s’éloigne
davantage des dents ; le front fe ride ; les
fourcils s’abaiffent.; on n’obferve point fur
les joues ce petit enfoncement que l’on
appelle la fojfette, & qui donne de la grâce
au ris y les yeux font plus comprimés, Si
£«) Valer. Max, L. ix. c. 12,
f v