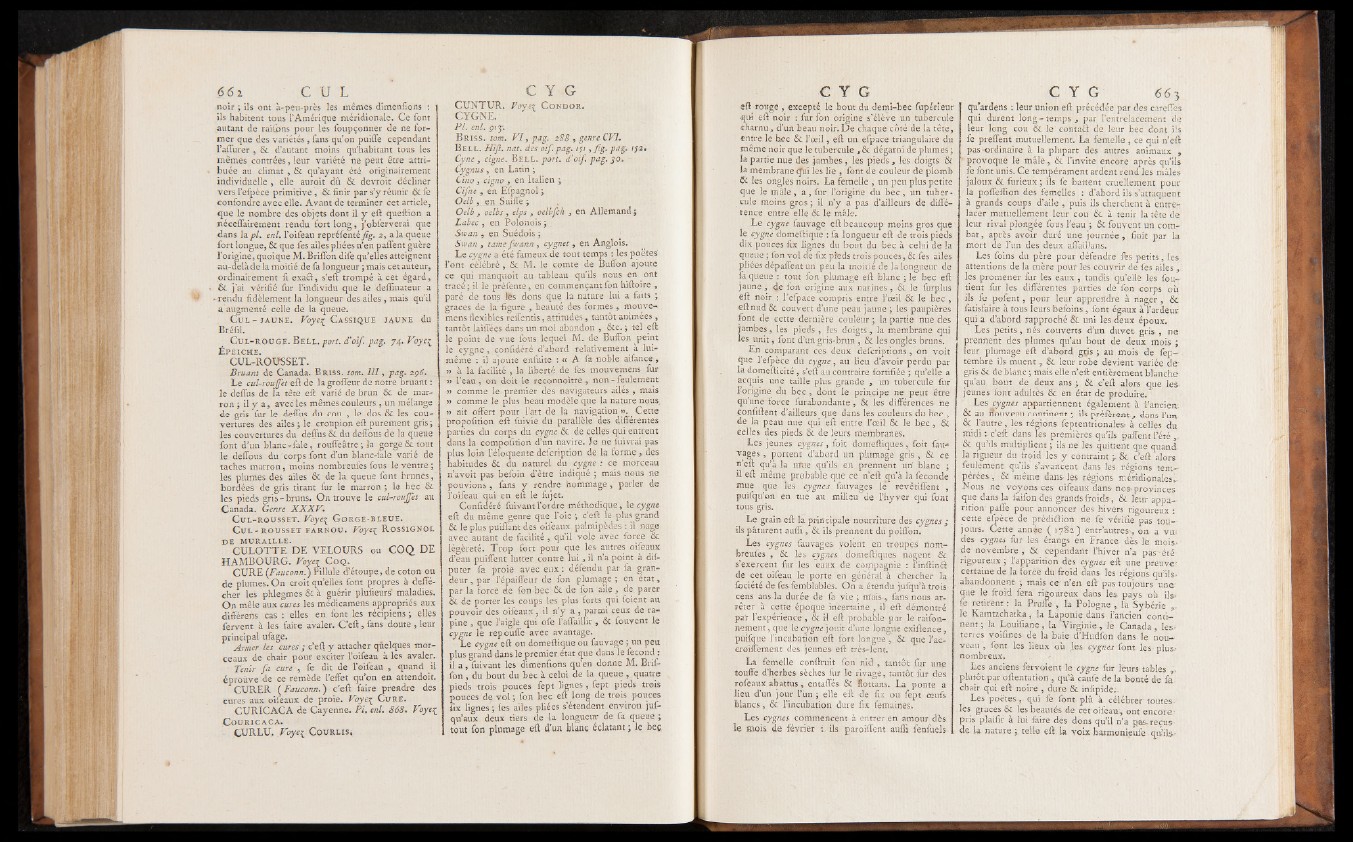
noir ; ils ont à-peu-près les mêmes dimenfions :
ils habitent tous l’Amérique méridionale. Ce font
autant de raifons pour les foupçonner de ne former
que des variétés, fans qu’on puiffe cependant
l’affurer., & d’autant moins qu’habitant tous les
mêmes contrées, leur variété ne peut être attribuée
au climat , & qu’ayant été originairement
individuelle , elle auroit dû & devroit décliner
vers l’efpèce primitive , & finir par s’y réunir & fe
confondre avec elle. Avant de terminer cet article,
que le nombre des objets dont il y eft queftion a
néceffairement rendu fort long, j’obferverai que
dans la pl. enl. l’oifeau repréfentéjîg. 2, a la queue
fort longue, & que fes ailes pliées n’en partent guère
l’origine, quoique M. Briffon dife qu’elles atteignent
au-delà de la moitié de fa longueur ; mais cet auteur,
ordinairement fi exadt, s’eft trompé à cet égard,
& j’ai vérifié fur l’individu que le deflinateur a
- rendu fidèlement la longueur des ailes , mais qu’il
a augmenté celle de la queue.
C u l - j a u n e . Voye^ C a s s i q u e j^ u n e du
Bréfil.
C u l - r o u g e . B e l l , port, d 'o i f . pag. 74. Voye£
É p e i c h e .
CUL-ROUSSET.
Bruant de Canada. B r is s. tom. 111, pag. 2 96.
Le cul-roujjet eft de la groffeur de notre bruant :
le deflus de la tête eft varié de brun & de marron
; il y a , avec les mêmes couleurs., un mélange
de gris fur le deflus du cou , le dos & les couvertures
des ailes ; le croupion eft purement gris;
les couvertures du deflus & du deflous de la queue
font d’un blanc-fale, rouffeâtre ; la gorge & tout
le deflous du corps font d’un blanc-fale varié de
taches marron, moins nombreufes fous le ventre ;
les plumes des ailes & de la queue font brunes,
bordées de gris tirant fur le marron ; le bec &
les pieds gris-bruns. On trouve le cul-roujfet au
Canada. Genre XXXV.
C u l - r o u s s e t . Voye^ G o r g e - b l e u e .
C u L - R O U S S E T F A R N O U . Voye{ R O S S I G N O L
d e m u r a i l l e .
CULOTTE DE VELOURS ou CO Q DE
HAMBOURG. Voye^ C oq.
CURE (.Fauconn.) Pillule d’étoupe, de coton 011
de plumes. On croit qu’elles font propres à deffé-
cher les phlegmes & à guérir plufieurs* maladies.
On mêle aux cures les médicamens appropriés aux
différens cas : elles en font les récipiens ; elles
fervent à les faire avaler. C’eft, fans doute, leur
principal ufage.
Armer les cures ; c’eft y attacher quelques morceaux
de chair pour exciter l’oifeau à les avaler.
Tenir fa. cure , fe d it d e l’o ife âu , q u a n d i l
é p r o û v e d e c e r em è d e l’e ffe t q u ’o n e n a tte n d o it.
CURER ( Fauconn.) c ’ e f t fa ire p r e n d r e d e s
cu r e s a u x o ife a u x d e p r o ie . Voye^ C u r e .
CURICACA de Cayenne. Pi. enl. 868. Voye^
C o u r i c a c a .
CURLU, Voye{ Courlis,
CUNTUR. Voyer C o n d o r *
CYGNE.-
Pl. enl. 91 y.
B ris s . tom. V I , pag. 288 9 genre. CV1. Bell. Hiß. nat. des oif.pag. 171 , fig. pag. i$2.
Cyne , eigne. Bell. port, d'oif. pag. 3 0 . -
Cygnus 9 en Latin ;
Lino , cigno 3 en Italien ;
Cifne , en Efpagnol ;
Oelb , en Suiffe ;
Oelb 3 oelb s , elps 3 oelbfch 3 en A llem an d .;
Labec , en Polonois ; .
Swan , en Suédois ;
Swan 3 tame ƒ'wann , cygnet, en Anglois.'
Le cygne a été fameux de tout temps : les poètes
l’ont célébré, & M. le comte de Buffon ajoute
ce qui manquoit au tableau qu’ils nous en ont
tracé ; il le préfente, en commençant fon hiftoire ,
paré de tous les dons que la nature lui a faits ;
grâces de la figure , beauté des formes , mouve—
mens flexibles reffentis, attitudes, tantôt animées ,
tantôt laiffées dans un mol abandon , &c. ; tel eft
le point de vue fous lequel M. de Buffon peint
le cygne, confidéré d’abord relativement à lui-
même : il ajoute enfuite : « A fa noble aifance,
jj à la facilité , la liberté de fes mouvemens fur
-j> l’eau, on doit le reconnoître , non - feulement
jj comme le premier des navigateurs ailés , mais
jj comme le plus beau modèle que la nature nous,
jj ait offert pour l’art de la navigation jj. Cette
propofition eft fuivie du parallèle des différentes
parties du corps du cygne & de celles qui entrent
dans la compofition d’un navire. Je né lui vrai pas
plus loinrTéloquênte defeription de la forme 3 dés
habitudes & du naturel du cygne : ce morceau
n’avoit pas befoin d’être indiqué ; mais nous ne
pouvions , fans y rendre hommage, parler de
l’oifeau qui en eft le fujet.
Confidéré fuivantl’ordre méthodique, le.cygne
eft du même genre que l’oie ; c’eft le plus grand
& le plus puiffant des oifeaux palmipèdes : il nage
avec autant de facilité , qü’il vole avec force &
légèreté. Trop fort pour que les autres oifeaux
d’eau puirtent lutter contre lui , il n’a point a dif-
puter fa proie avec eux : défendu par fa grandeur
, par l’épaiffeur de fon plumage ; en état,
par la force de fon bec •& de fon aile , de parer
& de porter les coups les plus forts qui foient au
pouvoir des oifeaux, il n’y a , parmi ceux de ra*-
pine 3 que l’aigle qui ofe l’affaillir , ÔC fouvent le
cygne le repoiiffe avec avantage.
Le cygne eft ou domeftique ou fauvage ; un peu
plus grand dans le premier état que dans le fécond :
il a , fuivant les dimenfions qu’en donne M. Briffon
, du bout du bec à celui de la queue ^quatre
pieds trois pouces fept lignes , fept pieds trois
pouces dç vol ; fon bec eft long de trois pouces
fix lignes; les ailes pliées s’étendent environ juf-
qu’aux deux tiers de la longueur de fa queue ;
tout fon plumage eft d’un blanc éclatant ; le beç,
eft rouge, excepté le bout du demi-bec fupérieur
qui eft noir : fur fon origine s’élève un tubercule
charnu, d’un beau noir. De chaque côté de la tête,
entre le bec & l’oe il, eft un efpace triangulaire du
même noir que le tubercule , &. dégarni dé plumes ;
la partie nue des jambes, les pieds , les doigts &
la membrane qui les lie , font de couleur de plomb
& les ongles noirs. La femelle ,. un peu plus petite
que le mâle, a , fur l’origine du bec , un tuber -
cille moins gros ; il 11’y a pas d’ailleurs de différence
entre elle & le mâle.
Le cygne fauvage eft beaucoup moins gros que
le cygne domeftique : fa longueur eft de trois pieds
dix poucès fix lignes du bout du bec à celui de la
queue ; fon vol de fix pfëds trois pouces, & fes ailes
pliées départent un peu la moitié de la longueur de
fa queue : tout fon plumage eft blanc ; le bec eft
jaune , de fon origine aux narines, & le furplus
eft noir : l’efpace compris entre l’oeil &. le bec ,
eftnud & couvert d’une peau jaune ; les paupières
font de cette dernière couleur ; la partie nue des
jambes, les pieds, les doigts, la membrane qui
les unit, font d’un gris-brun , & les ongles bruns.
En comparant ces deux deferiptions, on voit
que l’efpèce du cygne, au lieu d’avoir perdu par .
la domefticité , s’eft au contraire fortifiée ; qu’elle a ;
acquis une taille plus grande , un tubercule fur ;
l’origine du bec , dont le principe ne peut être
qu’une force furabondante , & les différences ne
confiftent d’ailleurs que dans les couleurs du bec ,
de la peau nue qui eft entré l’oeil & le bec, &
celles des pieds & de leurs membranes.
Les jeunes cygnes, foit domeftiques., foit fau-
vàges , portent d’abord un plumage gris , & ce
n’eft qu’à, la nfue .qu’ils en prennent un blanc ;
il eft même probable que ce n’eft qu’à la fécondé
mue que les cygnes fauvages le revêtirtent ,
puifqu’on en tue au milieu de l’hyver qui font
tous gris.
Le grain, eft la principale nourriture des cygnes ;
ils pâturent aufli, & ils prennent du poiffon.
Les cygnes fauvages- volent en troupes nombreufes
, & les cygnes domeftiques nagent &
s’exercent fur les eaux de compagnie : l’inftinét
de cet. oifeau le porte en général à cher cher la
fbciété de fes femblables. On a étendu jufqu’à trois
cens ans la durée de fa vie ; mais , fans nous arrêter
à cette époque incertaine , il eft démontré
pat l’expérience , & il eft probable par le raifon-
nement, que le cygne jouit d’une longue exiftence,
puifque l’incubation eft fort longue , & que l’ac-
Groinement des jeunes eft très-lent.
La femelle conftruit fon' nid , tantôt fur une
touffe d’herbes sèches fur le rivage , tantôt fur des
rofeaux abattus, entafles & flottans. La ponte a
lieu d’un jour l*im ; elle eft de fix ou fe.pt oeufs
blancs, & Fincübation dure fix femaines*
Les cygnes commencent à entrer en amour dès
le mois de février ils paroirtent aufli fenfuels. -
qu’ardens : leur union eft précédée par des carefles
qui durent long-temps, par l’entrelacement de
leur long cou & le contaél de leur bec dont ils
fe preffent mutuellement. La femelle , ce qui n’eft
pas •■ ordinaire à la plupart des autres animaux ,
provoque le mâle, & l’invite encore après qu’ils
fe font unis. Ce tempérament ardent rend les mâles
jaloux & furieux ; ils fe battent cruellement pour
la pofleflion des femelles : d’abord ils s’attaquent
à grands coups d’aile , puis ils cherchent à entrelacer
mutuellement leur cou & à tenir la tête de
leur rival plongée fous l’eau ; & fouvent un combat
, après avoir duré une journée, finit par la
mort de l’un des deux artaillans.
Les foins du père pour défendre fes petits, les
attentions de la mère pour les couvrir de fes ailes,
les promener fur les eaux , tandis qu’eîlè les fondent
fur les différentes parties de fon corps où
ils fo pofent, pour leur apprendre à nager , &
fatisfaire à tous leurs befoins, font égaux à l’ardeur
qui a d’abord rapproché & uni les deux époux.
Les petits, nés couverts d’un duvet gris , ne
prennent des plumes qu’au bout de deux mois ;
leur plumage eft d’abord gys ; au mois de fep-
tembre ils muent, & leur robe devient variée de
gris & de blanc ; mais elle n’eft entièrement blanche
qu’au bout de deux ans ; & c’eft alors que les
jeunes font adultès & en état de produire.
Les cygnes appartiennent également à Fancien;
& au nouveau continent ; ils préfèrentdans l’un
& l’autre, les régions feptentrionales» à celles du
midi :• c’eft dans les premières qu’ils partent l’été , .
& qu’ils multiplient ; ils ne les quittent, que quand
la rigueur du froid les y contraint c’eft alors
feulement qu’ils s’avancent dans les régions tem--
pérées-y & même dans les régions méridionales^
Nous ne voyons ces oifeaux dans nos-provinces
que dans la laifon des grands froids-, & leur apparition
parte pour annoncer des hivers rigoureux :
cette efpèce de prédiriion ne. fe vérifie pas toujours.
Cette année ( 1782) entr’autresy on a y te
des cygnes fur les étangs en France, dès le mois-
de novembre , & cependant l’hiver n’a pas-été
rigoureux ; l’apparition des cygnes eft une preuve'
certaine de la forcé du froid dans les régions qu’ils«
abandonnent ; mais ce" n’en eft: pas-toujours une-'
que le froid fera rigoureux dans les pays où ils-,
fe retirent : la Prurte , la Pologne , la Sybérie
le Kamtzchatka, la Laponie dans l’ancien continent;
la Louifiane, la Virginie, le Canada, les.'
terres, yoifmes de la baie d’Hudfon dans le nouveau
, font les lieux où les cygnes font les plus.*
nombreux. .
Les anciens fervoient le cygne fur leurs> tables y.
pltitot.par oftentation , qu’à caufe de la bonté de fa
chair qui eft noire , dure & infipide;-
Les poètes , qui fe font plu à célébrer toutes :
les grâces & les beautés de cet oifeau;, ont encore^
pris pîaifir a lui faire des dons qu’il n’a pas-reçus*
de là nature y telle eft-la voix harmonieufe qifils--