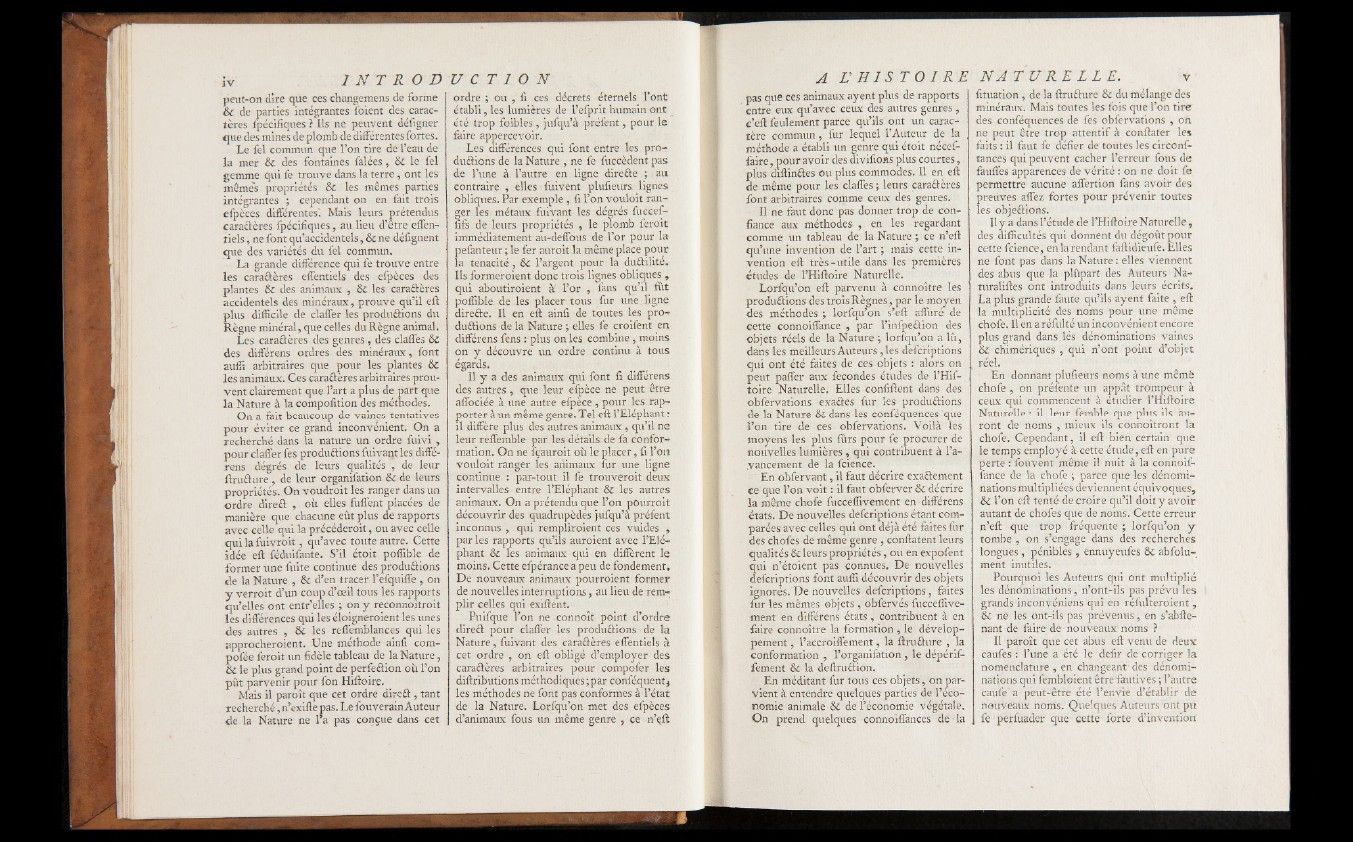
peut-on dire que ces changemens de forme
& de parties intégrantes foient des caractères
fpécifiques ? Ils ne peuvent défigner
que des mines de plomb de différentes fortes.
Le fel commun que l’on tire de l’eau de
la mer 8c des fontaines falées, & le fel
gemme qui fe trouve dans la terre, ont les
mêmes propriétés 8e les mêmes parties
intégrantes ; cependant on en fait trois
efpèces différentes! Mais leurs prétendus
caractères fpécifiques, au lieu d’etre effentiels
, ne font qu’accidentels, & ne défignent
que des variétés du fel commun.
La grande différence qui fe trouve entre
les caractères effentiels des efpèces des
plantes & des animaux , & les caractères
accidentels des minéraux, prouve qu’il eft
plus difficile de claffer les productions du
Règne minéral, que celles du Règne animal.
Les caraâères des genres, des daffes 8e
des différens ordres des minéraux, font
aufîï arbitraires que pour les plantes 8e
les animaux. Çes caraâères arbitraires prouvent
clairement que l’art a plus de part que
la Nature à la compofition des méthodes.
On a fait beaucoup de vaines tentatives
pour éviter ce grand inconvénient. On a
recherché dans la nature un ordre fu iv i ,
pour claffer fes produâions fuivant les différens
dégrés de leurs qualités , de leur
ftru âure , de leur organifation 8e de leurs
propriétés. On voudrait les ranger dans un
ordre direâ , oii elles fuffent placées de
manière que chacune eût plus de rapports
avec celle qui la précéderait, ou avec celle
qui la fu iv ro it, qu’avec toute autre. Cette
idée eft féduifante. S’il étoit pofiible de
former une fuite continue des produâions
de la Nature , 8c d’en tracer l’efquiffe, on
y verrait d’un coup d’oeil tous les rapports
qu’elles ont entr’elles ; on y reconnoitroit
les différences qui les éloigneraient les unes
des autres , 8c les reffemblances qui les
approcheroient. Une méthode ainfi com-
pofée ferait un fidèle tableau de la Nature,
& le plus grand point de perfeâion oïl l’on
pût parvenir pour fon Hiffoire,
Mais il paroît que cet ordre d ir e â , tant
recherché, n’exifte pas. Le fouverain Auteur
de la Nature ne l ’a pas conçue dans cet
ordre ; ou , fi ces décrets éternels l’ont
établi, les lumières de l’efprit humain ont
été trop foibles, jufqu’à préfent, pour le
faire appercevoir.
Les différences qui font entre les produâions
de la Nature , ne fe fuccèdent pas
de l’une à l’autre en ligne direâe ; au
contraire , elles fuivent plufieurs lignes
obliques. Par exemple , fi l’on vouloit ranger
le s métaux fuivant les dégrés fuccef-
fifs de leurs propriétés , le plomb feroit
immédiatement au-deffous de l’or pour la
pefanteur ; le fer aurait la même place pour
la ténacité, 8e l’argent pour la duâilité.
Ils formeraient donc trois lignes obliques ,
qui aboutiraient à l’or , fans qu’il fût
pofiible de les placer tous fur une digne
direâe. Il en eft ainfi de toutes les produâions
delà Nature ; elles fe croifent en
différens fens : phis on les combine, moins
on y découvre un ordre continu à tous
égards.
Il y a des animaux qui font fi différens
des autres , que leur efpèce ne peut être
affociée à une autre efpèce , pour les rapporter
à un même genre. T el eft l’Eléphant :
il diffère plus des autres animaux, qu’il ne
leur reffemble par les détails de fa conformation.
On ne fçauroit oit le placer, fi l’on
vouloit ranger les animaux fur une ligne
continue : par-tout il fe trouverait deux
intervalles entre l ’Eléphant 8e les autres
animaux. On a prétendu que l’on pourrait
découvrir des quadrupèdes jufqu’à préfent
inconnus , qui rempliraient ces vuides ,
par les rapports qu’ils auraient avec l’Eléphant
8e les animaux qui en diffèrent le
moins. Cette efpérance a peu de fondement.
De nouveaux animaux pourraient former
de nouvelles interruptions, au lieu de remplir
celles qui exiftent.
Puifque l’on ne connoît point d’ordre
direâ pour claffer les produâions de la
Nature, fuivant des caraâères effentiels à
cet ordre , on eft obligé d’employer des
caraâères arbitraires pour compofer les
diftributions méthodiques; par confisquent,
les méthodes ne font pas conformes à l’état
de la Nature. Lorfqu’on met des efpèces
d’animaux fous un même genre , ce n’eft
pas que ces animaux ayent plus de rapports
entre eux qu’avec ceux des autres genres ,
c’eft feulement parce qu’ils ont un caractère
commun, fur lequel l ’Auteur de la
méthode a établi un genre qui étoit nécef-
faire, pour avoir des divifions plus courtes,
plus diftinâes Ou plus commodes. Il en eft
de même pour les claffes ; leurs caraâères
font arbitraires comme ceux des genres.
Il ne faut donc pas donner trop de confiance
aux méthodes , en les regardant
comme un tableau de la Nature ; ce n’eft
qu’une invention de l’art ; mais cette invention
eft très-utile dans les premières
études de l’Hiftoire Naturelle.
Lorfqu’on eft parvenu à connoître les
produâions des trois Règnes, par le moyen
des méthodes ; lorfqu’on s’eft affuré de
cette connoiffance , par l’ infpeâion des
objets réels de la Nature ; lorfqu’on a lû ,
dans les meilleurs Auteurs, les defcriptions
qui ont été faites de ces objets : alors on
peut paffer aux fécondés études de l’Hiftoire
Naturelle. Elles confident dans des
obfervations exaâes fur les produâions
de la Nature 8e dans les conféquences que
l ’on tire de ces obfervations. Voilà les
moyens les plus fûrs pour fe procurer de
nouvelles lumières , qui contribuent à l’a-
yancement de la fcience.
En obfervant, il faut décrire exaâement
ce que l ’on voit : il faut obferver 8e décrire
la même chofe fucceflîvement en différens
états. De nouvelles defcriptions étant comparées
avec celles qui ont déjà été faites fur
des chofes de même genre , conftatent leurs
qualités & leurs propriétés, ou en expofent
qui n’étoient pas connues. De nouvelles
defcriptions font aufli découvrir des objets
ignores. De nouvelles defcriptions, faites
fur les mêmes objets , obfervés fucceflive-
ment en différens états, contribuent à en
faire connoître la formation, le développement
, l’accroiffement, la ftruâure , la
conformation , l’organifation, le dépérif-
fement & la deftruâion.
En méditant fur tous ces objets, on parvient
à entendre quelques parties de 1’eco-
noniie animale & de l’économie végétale.
On prend quelques connoiffanees de Ta
fituation, de la ftruâure 8e du mélange des
minéraux. Mais toutes les fois que l’on tire
des conféquences de fes obfervations , on
ne peut être trop attentif à conftater les
faits : il faut fe défier de toutes les circonf-
tances qui peuvent cacher l’erreur fous de
fauffes apparences de vérité : on ne doit fe
permettre aucune affertion fans avoir des
preuves affez fortes pour prévenir toutes
les objeâions.
I ly a dans l’étude de l’Hiftoire Naturelle,
des difficultés qui donnent du dégoût pour
cette fcience, en la rendant faftidieufe. Elles
ne font pas dans la Nature : elles viennent
des abus que la plûpart des Auteurs Na-
turaliftes ont introduits dans leurs écrits.
La plus grande faute qu’ils ayent faite , eft
la multiplicité des noms pour une même
chofe. Il en a réfulté un inconvénient encore
plus grand dans lés dénominations vaines
8c chimériques , qui n’ont point d’objet
. réel.
En donnant plufieurs noms à une mêmê
chofe , on préfente un appât trompeur à
ceux qui commencent à étudier l’Hiftoire
Naturelle : il leur femble que plus ils auront
de noms , mieux ils connoîtront la
chofe. Cependant, il eft bien certain que
le temps employé à cette étude, eft en pure
perte : fouvent même il nuit à la connoiffance
de la chofe ; parce que les dénominations
multipliées deviennent équivoques,
8e l ’on eft tenté de croire qu’il doit y avoir
autant de chofes que de noms. Cette erreur
n’eft que trop fréquente ; lorfqu’on y
tombe , on s’engage dans des recherches
longues , pénibles , ennuyeufes 8e abfolu-
ment inutiles.
Pourquoi les Auteurs qui ont multiplié
les dénominations, n’ont-ils pas prévu les
grands inconvéniens qui en réfulteroient,
8e ne les ont-ils pas préventis, en s’abfte-
nant de faire de nouveaux noms ?
Il paraît que cet abus eft venu de deux
caufes : l’une a été le defir de corriger la
nomenclature , en changeant des dénominations
qui fembloient être fautives ; l ’autre
caufe a peut-être été l ’envie d’établir de
nouveaux noms. Quelques Auteurs ‘ont pu
fe perfuader que cette forte d’invention