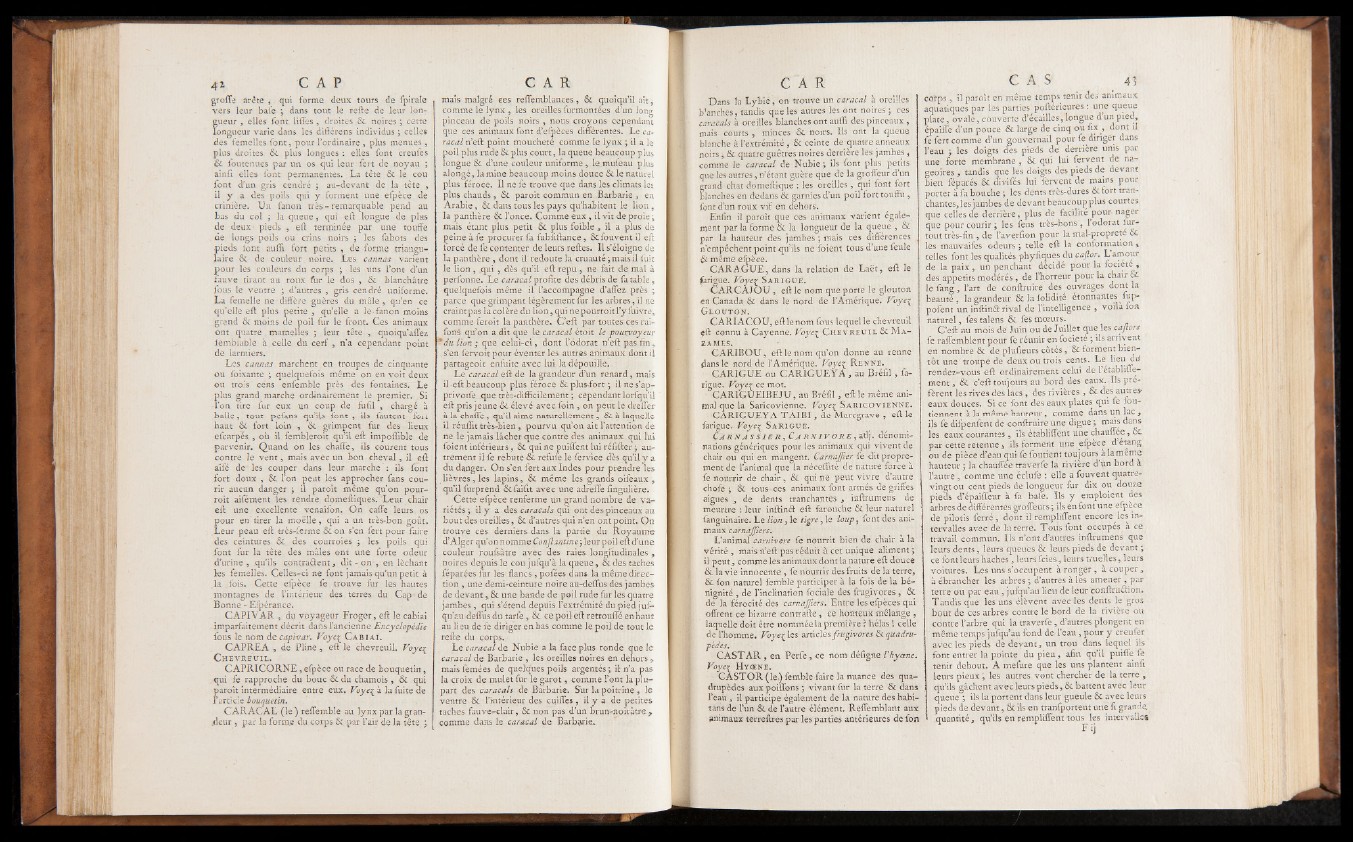
g re ffe a rê te , qui fo rm e d eu x to u rs de fpirale
v e r s leur bafe ; dans to u t le re fte de leur lon gu
eu r , elles^ font li f fe s , d ro ites & noires ; c e tte
lon gu eu r v a rie dans les différens individus ; celles
d e s femelles f o n t , p ou r l’o rd in aire , plus menues ,
plus d ro ites & plus longues : elles font creufes
& foute nues par un o s qui leur fe rt de n o y au ;
ainfi elles font pe rm an en te s . L a tê te & le cou
fo n t d’un gris cen d ré ; a u -d e v an t de la tê te ,
il y a des poils qui y fo rm en t une e fp è ce de
c r in iè re . U n fan on trè s - remarq u ab le p en d au
bas du co l ; la q u e u e , qui e ft longue de plus
d e d eu x - pieds , eft termin ée p a r u n e touffe
d e longs poils o u 'c r in s noirs ; les fabots des
pieds io n t aufli fo rt petits , de fo rm e triangula
ire & de c o u le u r . n o ire . L e s cannas v a rien t
p o u r les cou leu rs du co rp s ; les uns l’o n t d’un
fau v e tirant -au ro u x fur le dos , & b lanchâtre
fous le v e n tre ; d’autres , gris c en d ré uniforme.
L a femelle ne diffère gu ères du m âle , qu’en ce
q u ’elle eft plus p e tite , qu’elle a le -fan o n moins
gran d & moins de poil fur le fron t. C e s animaux
o n t quatre . m amelles ; leur tê te , quoiqu’affez
lèm b iab le à ce lle du c e r f , n’a c ep en d an t p o in t
d e larmiers .
L e s cannas m a rch en t en trou p e s de cinquante
o u fo ix an te ; quelquefois m êm e on en v o it deux
o u tro is cén s enfemble p rè s des fontainèsT“L e
plus grand m a rch e o rd in a irem en t le p rem ie r. Si
l’on tire fur eu x un coup de fufil ch a rg é à
b a l l e , to u t pefans qu’ils f o n t , ils fautent fo rt
h au t & fo r t lo in , & g rim p en t fur d e s lieux
e f e a rp é s , o ù il fem b le ro it qu’il eft impofïible de
p a rv en ir . Q u a n d on les ch a ffe , ils co u ren t tous
co n tr e le v e n t , mais a v e c un b o n ch e v a l , il eft
aifé de les co u p e r dans leu r m a rch e : ils font
fo r t d ou x , &. l’on p eu t le s ap p ro ch e r fans cour
ir aucu n dan g er ; il p a ro ît m êm e qu’on p o u r -
ro it a ifémen t les ren d re domeftiques. 'L e u r chair
e ft une e x ce llen te v en aifon . O n caffe leurs, os
p o u r en tire r la m o ë l le , qui a un trè s -b on g o û t.
.L e u r p eau eft trè s -fe rm e & on s’en fe rt p ou r faire
d es cein tu res & des co u rro ie s ; le s poils , qui
fo n t fur là tê te des mâ le s o n t u n e fo rte odeur
d’urine , .qu’ils c o n tra r ie n t., d i t - o n - , en léchant
le s femelles. C e lle s -c i ne fo n t jamais qu’un p e tit à
la fo is. C e t te e fp è ce fe tro u v e fur les hautes
m o n tagn e s de l’in té rieu r des te r re s du C a p -d e
B o n n e - E fp é ran ce .
C A P IV A R , du v o y a g e u r F r o g e r , e ft le cabiai
imp arfaitemen t d é c r it dans l’an cien n e Encyclopédie
fous le nom de capivar. Voyez C a b i a i .
C A P R E A , de P l in e , eft le ch ev reu il. Voyez
C h e v r e u i l .
C A P R I C O R N E , e fp è ce ou ra c e de b o u q u e tin ,
qui fe rap p ro ch e du b o u c & du ch am o is , & qui
p a ro ît in te rm éd ia ire e n tre e u x . Voyez à la fuite de
l ’a rticle bouquetin.
C A R A C A L ( l e ) reffemble au ly n x p ar la grand
e u r , p a r la fo rm e du co rp s & par l’a ir de la tê te ;
m a is malgré ce s re ffem b lan c e s , & quoiqu’il a i t ,
com m e le l y n x , les oreilles furmon tées d’un long
p in ce au de poils noirs , nous c ro y o n s cependant
que ce s animaux font d’efpèces différentes. L e c j -
racal n’e ft point m o u ch e té com m e le ly n x ; il a le
po il plus rude & plus c o u r t , la queue b e au cou p plus
longue &. d’une cou leu r u n ifo rm e , le mufeau plus
a lo n g é , lam in e b eaucoup mo in s d ouce & le naturel
plus fé ro c e . I l ne fe tro u v e que dans les climats les
plus chauds , & p a ro ît com m u n en B a rb a rie , en
A r a b ie , & dans to u s les p a y s qu’h abitent le lion ,
la p an th ère & l’o n c e . C om m e e u x , il v i t de pro ie ;
mais étan t plus p e ti t & plus foible , il a plus de
peine à fe p ro cu re r fa fu b liftan ce , & fo u v e n t il eft
fo rc é de fe co n ten te r de leurs re fte s . Il s’éloigne de
la panth ère , don t il red o u te la cru au té ;.mais il fuit
le l i o n , .qui , dès qu’il e ft r e p u , ne fait de mal à
p erfonne. L e car a cal profite des débris de fa ta b l e ,
quelquefois m êm e il l’a c com p a g n e d’affez près ;
p a r c e q u e g rim p an t lég è rem en t fur les a rb re s , il ne
craint pas la co lè re du lio n , qui n e p o u r ro itl’y fuivre,
com m e fe roit la pan th ère. C ’e ft p ar tou te s ce s rai-
fons qu’on a dit que le caracal é to it le pourvoyeur
- du lion; que c e lu i - c i , dont l’ô d o ra t n’e ft pas f in ,
.s’en fer v o it pour év en te r le s autres an im au x don t il
pa rtag eo it enfuite a v e c lui la dépouille.
L e caracal eft de la g ran deur d’un r e n a rd , m a is
il -eft b eau cou p plus f é ro c e & plus-fort ; il ne s’a p -
priv oife que très-difficilement ; cepen dant lorfqu’il
eft pris jeune & é le v é a v e c f o in , on p eu t le dreffer
à la ch a ffe , qu’il aime n a tu re llem en t, & à laquelle
il réuffit trè s -b ie n , p o u rv u qu’o n ait l’a tten tion d e
ne le jamais lâ ch e r que co n tre des. an im au x qui lui
fo ient in fé rieu rs, & qui ne puiffent lui réfifter ; autrem
en t il fe rebute & refufe le fervice dès qu’il y a
du danger. O n s’en fert au x Indes p ou r p ren d re le s
li è v r e s , les lap in s , & m êm e les grands o ifeau x 9,
qu’il furprend & faifit a v e c une adreffe fingulière.
C e t te e fpèce ren ferme un grand n om b re de v a r
ié t é s ; il y a des caracals qui o n t d e s pin ceau x au
b o u t des o re ille s , & d’autres qui n’en o n t p o in t. O n
tro u v e c e s derniers, d an s la p artie du R o y a um e
d’A lg e r qu’on n om m e Conji.zntine ; leur poil eft d’une
co u leu r rou fsâtre a v e c des ra ie s longitudinales „
no ires depuis le co u jufqu’à la q u e u e , & des taches
fép arées fur les flancs , pofées dans là m êm e direction
, une demi-ceinture n o ire au-deffus des jambes
de d e v a n t , & u n e bande de poil ru d e fur les quatre
jam b e s , qui s’étend depuis l’e x trém ité du pied ju f -
qu’au deflùs du t a r f e , & c e p o il eft retrouffé en haut
au lieu de fe diriger en b as com m e le. p o il de to u t le
re fte du co rp s.
L e caracal d e N u b ie a la fa ce plus ro n d e que le
caracal de B a rb a rie , les o reilles noires en dehors ,
mais femées de quelques poils argen tés ; il n’a pas
la c ro ix de m u le t fur le g a r o t , com m e l’o n t la plup
a r t des caracals de B a rb a rie . Sur la po itrine , le
v en tre & l’intérieur des cuiffes , il y a de pe tite s
taches f a u v e -c la ir , & non pas d’un b ru n -n o irâ tre ,
com m e dans le caracal de Barbarie*.
Dans la Lybié, on trouve un caracal à oreilles
b’anches, tandis que les autres les ont noires ; ces
caracals à oreilles blanches ont aufli des pinceaux ,
mais courts , minces & noirs. Ils ont la queue
blanche à l’extrémité , & ceinte de quatre anneaux
noirs ; & quatre guêtres noires derrière les jambes,
comme le caracal de Nubie ; ils font plus petits
que les autres, n’étant guère que de la groffeur d’un
grand chat domeftique : les oreilles, qui font fort
blanches en dedans & garnies d’un poil fort touffu ,
font d’un roux vif en dehors.
Enfin il paroît que ces animanx varient également
par la forme & la longueur de la queue , &
par la hauteur des jambes ; mais ces différences .
n’empêchent point qu’ils ne foient tous, d’une feule
& même efoèce.
CARAGUE, dans la relation de Laët, eft le
jfarigue. Voyez Sa r ig u e .
CARCAJOU, eft le nom que porte le glouton
en Canada, & dans le nord de l’Amérique. Voyez
Gl o u t o n .
CARIACOU, eft le nom fous lequel le chevreuil çft connu à Cayenne. Voyez Chevreuil & Ma-
zames.
CARIBOU, eft le nom qu’on donne au renne
dans le nord de l’Amérique. Voyez Renne.
CARIGUE ou CARIGUEYA, au Bréfil, fa-
rigue. Voyez ce mot.
CAR1GUEIBEJU, au Bréfil, eft le même animal
que la Saricovienne. Voye£ S a r ic o v ie n n e .
CARIGUEYA TA IB I , de Marcgrave , eft le
fatigue.- Voye^ Sarigue.
Ç a r n a s s i e r , Ca r n i v o r e , adj. dénominations
génériques pour les animaux qui vivent de
chair ou qui en mangent. CarnaJJier fe dit proprement
de l’animal que la néceffité de nature force à
fe nourrir de chair, & qui ne peut vivre d’autre
chofe ; & tous^ees animaux font armés de griffes
aigues , de dents tranchantes , inftrumens de
meurtre : leur inftinâ eft farouche & leur naturel '
fanguinaire. Le lion , le tigre, le loup, font des animaux
carnajjîers.
L’animal carnivore fe nourrit bien de chair à la
vérité , mais n’eft pas réduit à çët unique aliment ;
il peut, comme les animaux dont la nature eft douce
& la vie innocente , fe nourrir des fruits de la terre,
& fon naturel femble participer à la fois de la bénignité
, de l’inclination fociale des frugivores, &
de la férocité des carnajjîers. Entre lesefpècesrqui
offrent ce bizarre contrafte , ce honteux mélange ,
laquelle doit être nommée la première ? hélas 1 celle
de l’homme. Voyez les articles frugivores &. quadrupèdes.
CASTAR , en Perfe, ce nom défigne Vhyctne.
Voyez Hyoene.
CASTOR (le.) femble faire la nuance des quadrupèdes
aux poiffons ; vivant fur la terre & dans
l’èaù, il participe également de la nature des habi-
taiis de l’un & de l’autre élément. Reffemblant aux
animaux terreftres par les parties antérieures de fon
c o ïp s , il p a ro ît en m êm e tem p s tenir des an imau x
aquatiques par les parties p o fterieures : une queue
p la t e , o v a le , co u v e r te d’é c a ilie s , lon gu e d un p ied ,
épaiffe d’un p o u ce & la rg e de cinq ou fix , d o n t il
fe fe rt com m e d’un g ou v e rn a il p ou r fe diriger dans
l’eau ; les doigts des pieds de d e rriè re unis p a r
une fo rte m emb ran e , & qui lui fe rv en t de nag
eo ire s , tandis que les doigts des pieds de d e v a n t
bien féparés & divifés lui fe rv en t de mains p ou r
p o rte r à fa b ou ch e ; les dents très-dures & f o r t tranch
an te s, les jambes de d ev an t b eau cou p plus co u rte s
que celles d e d e r r iè r e , plus de facilité p o u r-n a g e r
que p our co u rir ; le s fens très -b on s , 1 o d o ra t fur- tout très-fin , de l’av erfion p ou r la m àl-p rop re te ÔC
les mauvaifes odeurs ; te lle e ft la co n fo rma tio n *
telles font les qualités phyfiques d u cajlor. L amour
de la p a i x , un p en ch an t décidé p o u r la f o c ie t e *
des appétits mod é ré s , de l’h o rreu r p ou r la chair 6c
le fang , l’a r t de conftruire des o u v rag e s d o n t la
b e au té , la g ran deur & la folidité é ton n an tes fup-
p o fen t un inftinft r iv a l de l’intelligence , v o i l a fon
n a tu r e l, fes talens & fes moeurs.
C’eft au mois de Juin ou de Juillet que les cajtors
fo raffemblent pour fe réunir en fociete ; ils arrivent
en nombre & de plufieurs côtés, &. forment bientôt
une troupe de deux ou trois cents. Le lieu dd.
rendez-vous èft ordinairement celui de l’etabliffe-
ment, & c’eft toujours au bord des eaux.-Ils préfèrent
les rives des lacs , des rivières , & des autres-
eaux douces. Si ce font des eaux plates qui fe fou-
tiennent à la même hauteur, comme dans un lac ,
ils fe difpenfent de conftruire une digue ; mais dans
les eaux courantes , ils établiffent une chauffée, ÔC
par cette retenue > ils forment une efpece d étang
ou de pièce d’eau qui fe foutient toujours a la meme
hauteur ; la chauffée traverfe la rivière d’un bord a
l’autre , comme une éclufe : elle a fouvent quatre-
I vingt ou cent pieds de longueur fur dix ou douze
pieds d’épaiffeur à fa baie. Ils y emploient des
arbres de diff érentes groffeurs ; ils en font une efpece
de pilotis ferré , dont il rempliffent encore les intervalles
avec de la terre. Tous font occupes a ce
travail commun. Us n’ont d’autres inftrumens que
leurs dents, leurs queues & leurs pieds de devant ;
ce font leurs haches , leurs foies, leurs truelles, leurs
voitures. Les uns s’occupent à ronger , à couper ,
à ebrancher les arbres ; d’autres à les amener , par
terre ou par eau, jufqu’aü lieu de leur conftruéfion.
Tandis que les uns élèvent avec les dents le gros
bout de ces arbres contre le bord de la rivière ou
contre l’arbre qui la traverfe, d’autres plongent en
même temps jufqu’au fond de l’eau, pour y creufér
avec les pieds de devant, un trou dans lequel ils
font entrer la pointe du pieu, afin qu’il puiffe fe
tenir debout. A mefure que les uns plantent ainfi
leurs pieux , les autres vont chercher de la terre ,
qu’ils gâchent avec leurs pieds, ôc battent avec leur
queue ; ils la portent dans leur gueule & avec leurs
pieds de devant, & ils en tranfportent une fi grande
quantité, qu’ils en rempliffent tous les intervalles
Fij