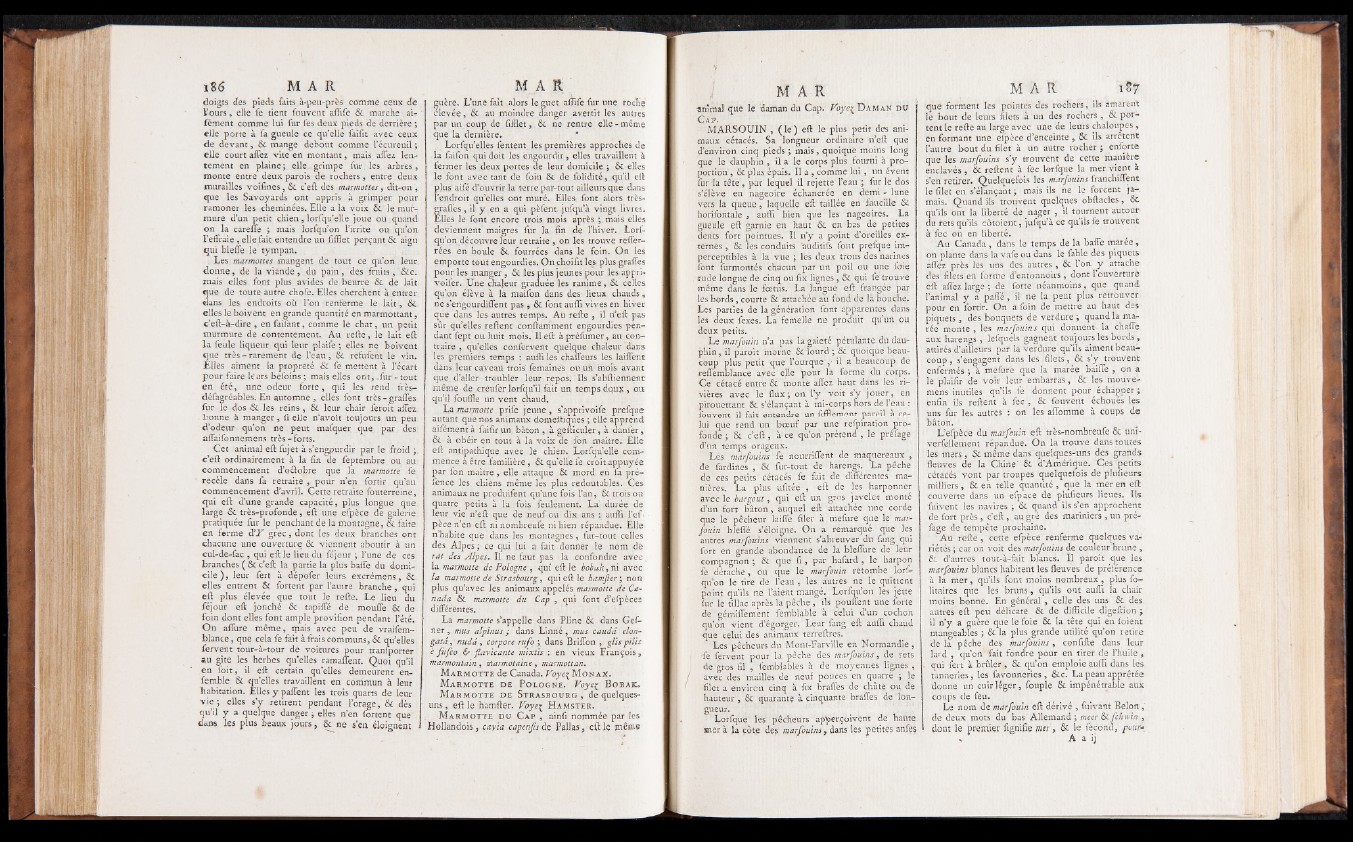
i S 6 M A R
doigts des pieds faits,à-peu-près commè ceux de
l’ours, elle fe tient fouvent aflife & marche ai-
l'ément comme lui fur fies deux pieds de derrière ;
elle porte à fa gueule ce qu’elle faifit avec ceux
de devant, 6c mange debout comme l’écureuil ;
elle court affez vite en montant, mais, affez lentement
en plaine; elle grimpe fur les arbres,
monte entre deux parois de rochers, entre deux
murailles voifines, 8c c’eft des marmottes, dit-on,
que les Savoyards ont appris à grimper pour
ramoner les cheminées. Elle a la voix 8c le murmure
d’un petit chien, lorfqu’elle joue ou quand
on la careffe ; mais lorfqu’on l’irrite ou qu’on
l’effraie , elle fait entendre un.fiffiet perçant 6c aigu
qui blefle le tympan.
. Les marmottes mangent de tout ce qu’on leur,
donne, de la viande, du pain, des fruits, &c.
mais elles font plus avides de beurre & de lait,
que de toute autre choie.-Elles cherchent à entrer
dans les endroits ou l’on renferme le lait, &
elles le boivent en grande quantité en marmottant,
c’eft-à-dire , en failànt, comme le chat, un petit
murmure de contentement. Au reffé, le lait eft
la feule liqueur qui leur plaife ; elles ne boivent
que très - rarement de l’eau, 8c refufent le vin.
Elles aiment la propreté 6c fe mettent à l’écart
pour faire leurs befoins ; mais elles ont, .fur - tout
en été, une odeur forte, qui les rend très-
défagréables. En automne , elles font très - graffes
fur le dos 8c les reins, & leur chair feroit affez
bonne à manger, fi elle n’avoit toujours un peu
d’odeur qu’on ne peut mafquer que par des
affaifonnemens très -forts.
Cet animal eft fujet à s’engpurdir parle froid;,
c’eft ordinairement à la fin de feptembre ou au
commencement d’oéiobre que la marmotte fe
recèle dans fa retraite , pour n’en fortir qu’au
commencement d’avril. Cette retraite fouterreine,
qui eft d’une grande capacité, plus longue que,
large 6c très-profonde, eft une efpèce de galerie
pratiquée fur le penchant dé la montagne, & faite
en forme d’JT grec, dont les deux branches ont
chacune une ouverture & viennent aboutir à un
cul-de-fac , qui eft le lieu du féjour ; l’une de ces
branches ( & c’eft la partie la plus baffe du domi- :
e ile ), leur fort à dépofer leurs excrémens, & i
elles entrent & fortent par l’autre branche, qui j
eft plus élevée que tout le refte. Le lieu du
féjour eft jçnché & tapiffé de moufle & de
foin dont elles font ample provifion pendant l’été.
On affure même, mais avec peu de vraifem-
blance, que cela fe fait à frais communs, & qu’elles
fervent tour-à-tour de voitures pour transporter
au gîte les herbes qu’elles ramaffent. Quoi qu’il
en foit, il eft certain qu’elles demeurent en-
femble & qu’elles travaillent en commun à leur
habitation. Elles y paffent les trois quarts de leur
vie ; elles s’y retirent pendant l’orage, & dès
qu’il y a quelque danger ; elles n’ën fortent que
dans les plus beaux jours, & ne s’en éloignent
MA R
guère. L’une fait alors le guet aflife fur une roche
elevée, 8c au moindre danger avertit les autres
par un coup de fifflet,.8c ne rentre elle-même
que la dernière.
Lorfqu’elles fentent les premières approches de
la faifon qui doit les engourdir, elles travaillent à
fermer les deux portes de leur domicile ; & elles
le font avec tant de foin & de folidité, qu’il eft
plus aifé d’ouvrir la terre par-tout ailleurs que dans
l’endroit qu’elles ont muré. Elles font alors très-
graffes, il y en a qui pèfent, jufqu’à vingt livres.
Elles le font encore trois mois après. ;. mais elles
deviennent maigres fur la fin de l’hiver. Lorf-
qii’qn découvre leur retraite » on les trouve reffer-
rées en boule 8c fourrées dans le foin. On les
emporte tout engourdies. On choifit les plus graffes
pour les manger , 5c les plus jeunes pour les appri-
voifer. Une chaleur graduée les ranime, 8c celles
qu’on élève à là maifon dans des lieux chauds,
ne s’engourdiffent pas , & font aufli vives en hiver
que dans les autres tempSà Au refte , il n’eft pas
sûr qu’elles reftent conftamment engourdies pendant
fept ou huit mois. Il eft à préfumer, au contraire
, qu’elles confervent quelque, chaleur dans
les premiers temps : aufli les chaffeurs les laiffent
dans leur caveau trois fontaines ou un mois avant
que d’aller troubler leur repos; ‘ Ils s’abftiennent
même de creufer lorfqu’il fait un temps do,ux , ou
qu’il fouffle un vent chaud.
L amarmotte prife jeune, s’apprivoife prefque
autant que nos animaux domeftiques ; elle apprend
aifément à faifir un bâton , à gefticuler, à danfer, 8c à obéir en tout à la voix de fon maître. Elle
eft antipathique avec le chien. Lorfqu’elle commence
à être familière, 8c quelle fe croit appuyée
par fon maître, elle attaque 8c mord en fa pré-
fence les chiens même les plus redoutables. Ces
animaux ne produifent qu’une fois l’an, & trois ou
quatre petits à la . fois feulement. La'.durée de
leur vie n’eft que de neuf ou dix ans :■ aufli l’eff
pece n’en eft ninombreufe ni bien répandue. Elle
n’habite que dans les montagnes, lur-tout celles
des Alpes ; ce qui lui a. fait donner le nom dë
rat des Alpes. Il ne faut pas la confondre avec
la marmotte de Pologne , qui eft le bobak, ni avec
la marmotte de Strasbourg, qui eft le hamfier ; non
plus qu’avec les animaux appelés marmotte de Canada
8c marmotte du Cap , qui font d’efpèces
différentes.
La marmotte s’appelle dans Pline 8c dans Gef-
ner, mus alpinus ; dans Linné, mus caudâ elon-
gatâ, ' nudâ, corpore rufo ; dans Briffon , glis pilis
è fufco & flavicante mixtis : en vieux François >
marmontain, viarmotaine, marmottan.
M a r m o t t e de Canada. Voyeç M o n a x .
M a r m o t t e d e P o l o g n e . Voyeç B o b a k .
M a r m o t t e d e St r a s b o u r g , de quelques-
u n s , eft le hamfter. Voyeç H a m s t e r .
M a r m o t t e d u C a p ,. ainfi nommée par les
Hollandois , cayia capenßs de Pallas, eft le même
M A R
unîmal que le daman du Cap. Voye^D am a n d u
C a p .
MARSOUIN , ( le ) eft le plus petit des animaux
cétacés. Sa longueur ordinaire n’eft que
d’environ cinq pieds ; mais, quoique moins long
que le dauphin , il a le corps plus fourni à proportion,
8c plus épais. Il a , comme lu i, un évent
fur la tête, par lequel il rejette l’eau ; fur le dos
s’élève en nageoire échancrée en demi - lune
vers la queue, laquelle eft taillée en faucille 8c
horifontale , aufli bien que les nageoires. La
gueule eft garnie en haut 8c en bas de petites
dents fort pointues. Il n’y a point d’oreilles externes
, & les conduits ‘auditifs font prefque imperceptibles
à la vue ; les deux trous des narines
font furmorttés chacun par un poil ou une laie
rude longue de cinq ou fix lignes , 8c qui fe trouve
même dans le foetus. La langue eft frangée par
les bords, courte & attachée au fond de là bouche.
Les parties de la génération font apparentes dans
les deux foxes. La femelle ne produit qu’un ou
deux petits. _ '
Le marfouin n’a pas la gaieté pétulante du dauphin,
il paroît morne 8t lourd ; 8c quoique beaucoup
plus petit que l’ourque ,• il a beaucoup de
reffemblance avec elle pour là forme du corps.
Ce cétacé entre 6c monte affez haut dans les rivières
avec le flux; on l’y voit s’y jouer, en
pirouettant 8c s’élançant à mi-çorps hors de l’eau :
fouvent il fait entendre un fifflement pareil à celui
que rend un boeuf par une refpiration profonde
; 8c c’e ft, à ce qu’on prétend , le préfage
d’un temps orageux..
Les màrfouins fe nourriffent de maquereaux ,
de fardines , 8c fur-tout de harengs. La pêche
de ces petits cétacés fe fait de différentes manières.
La plus ufitée , eft de les harponner
avec le bargout, qui eft un gros javelot monté
d’un fort bâton, auquel eft attachée une corde
que le pêcheur laiffe filer à mefure que le marfouin
bleffé s’éloigne. On a remarqué, qùe les
autres màrfouins viennent s’abreuver du fang qui
fort en grande abondance de la bleflure de leür
compagnon ; 8c que f i , par hafard , le harpon
fo détache, ou que lé marfouin retombe lorsqu’on
le tire de l’eau les autres ne le quittent,
point qu’ils ne l’aient mangé. Lorfqu’on les jette j
fur le tillac après la pêche , ils pouffent une forte
de gémiffement femblable à celui d’un cochon
qu’on vient d’égorger. Leur fang eft aufli chaud
que celui des animaux terreftres.
Les pêcheurs du MontrFarville en Normandie ,
fe fervent pour la pêche des màrfouins, de rets
de gros fil , Semblables à de moyennes lignes,
avec des mailles de neuf pouces en quarré- ; le
filet a environ cinq a fix braffes de chute pu de
hauteur , 8c quarante à cinquante braffes de longueur.
Lorfque le$ pêcheurs apperçôivënt de haute
mer à. la cote des màrfouins, dans les petites anfçs
M A R i &7
que forment les pointes des rochers, ils amarènt
le bout de leurs filets à un des rochers , 6c portent
le refte au large avec une de leurs chaloupes ,
en formant une efpèce d’enceinte , 8c ils arrêtent
l’autre bout du filet à un autre r'ocher ; enforte
que les màrfouins s’y trouvent de cette manière
enclavés, 8c reftent à foc lorfque la mer vient à
s’èn retirer. Quelquefois les màrfouins franchiffent
le filet en s’élançant ; mais ils ne le forcent jamais.
Quand ils trouvent quelques obftacles, 6c
qu’ils ont la liberté de nager , il tournent autour
du rets qu’ils côtoient, jufqu’à ce qu’ils fo trouvent
à foc ou èrt liberté.
Au Canada, dans le temps de la baffe marée ,
on plante dans la vafe ou dans le fable des piquets
affez près les- uns des autres , & l’on y attache
dés filets'en forme d’entonnoirs , dont l’ouverture
eft affez large ; de forte néanmoins, que quand
l’animal y a paffé, il ne la peut plus retrouver
pour en fortir. On a foin de mettre au haut dès
piquets , des bouquets de verdure ; quand la marée
monte , les màrfouins qui donnent- la châffe
aux harengs , lefquels gagnent toujours les bords ,
attirés d’ailleurs par la verdure qu’ils aimënt beaucoup
, s’engagent dans les filets, 8c s’y trouvent
enfermés ; à méfurë que la : marée baiffe , on a
le. plaifir de voir leur embarras, 6c les moüve-
mens inutiles qu’ils fe donnent pour échapper ;
enfin ils reftent à foc , 6c fouvent échoués les
uns fur les autres : on les affomme à coups de
bâton. :i-
L’efpèce du marfouin eft très-nombreufe 8c unî-
verfellement répandue. On la trouve dans toutes
les mers , 6c même dans quelques-uns des grands
■ fleuves de la Chine’ 6c d’Amérique. Ces petits
cétacés vont par troupes quelquefois de plusieurs
milliers , 6c en telle quantité , que la mer en eft
couverte dans un efpace de plufieurs lieues. Ils
fuivent les navires ; 6c quand ils s’en approchent
de fort près , c eft , au gré des mariniers , un préfage
de tempête prochaine.
Au refte , cette efpèce renferme quelques variétés
; car on voit des màrfouins de couleur brune , 8c d’autres tout-à-fait blancs. Il paroît que les
màrfouins blancs habitent les fleuves de préférence
à la mer, qu’ils font moins nombreux, plus fo-
litaires que les bruns , qu’ils ont aufli la chair
moins bonne. En général , celle des uns 6c des
autres eft peu délicate 6c de difficile digeftion ;
il n’y a guère que le foie 6c la tête qui en foient
mangeables ; 6c la plus grande utilité qu’on retire
de la pêche des màrfouins, confifte dans leur
lard , qu’on fait fondre pour en tirer de l’huile ,
. qui fort à brûler, 6c qu’on emploie aufli dans les
tanneries, les favonneries , 8cc. La peau apprêtée
donne un cuir léger, fouple 6c impénétrable aux
coups de feu.
Le nom de marfouin eft dérivé , fuivant Belon
• de deux mots du bas Allemand ; meer 6c fehwin , 1 dont le premier fignifie jner 9 6c le fécond, pour*,
* ’ A a ij