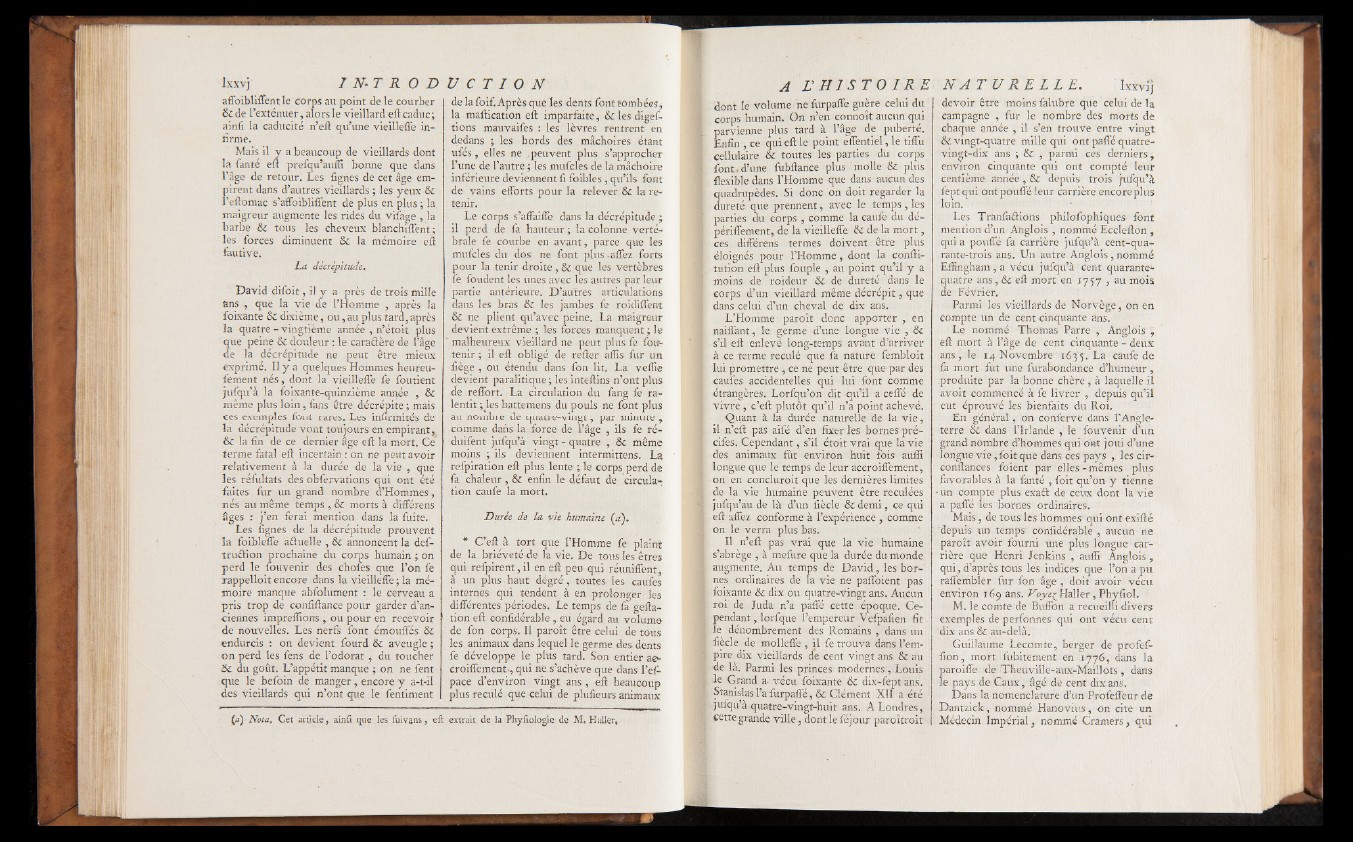
affoibliffent le corps au point de le courber
& d e l’exténuer, alors le vieillard eft caduc;
ainfi la caducité n’eft qu’une vieilleffe infirme.
Mais il y a beaucoup de vieillards dont
la fanté eu prefqu’auffi bonne que dans
l ’âge de retour. Les lignes de cet âge empirent
dans d’autres vieillards ; les yeux &
l ’eftomac s’affoibliffent de plus en plus ; la
maigreur augmente les rides du vifage , la
barbe Sc tous les cheveux blanchilTent ;
les forces diminuent Sc la mémoire eft
fautive.
La décrépitude.
David difoit, il y a près de trois mille
ans , que la vie de l’Homme , après la
foixante Sc dixième, o u , au plus tard, après
la quatre - vingtième année , n’étoit plus
que peine & douleur : le caraétère de l’âge
de la décrépitude ne peut être mieux
exprimé. Il y a quelques Hommes heureu-
fement nés, dont la vieillefle fe foutient
jufqu’à la foixante-quinzième année , &
même plus lo in , fans être décrépite ; mais
ces exemples font rares. Les infirmités_de
la décrépitude vont toujours en empirant,
Sc la fin de ce dernier âge eft la mort. Ce
terme fatal eft incertain : on ne peut avoir
relativement à la durée de la vie , que
les réfultats des obfervations qui ont été
faites fur un grand nombre d’Hommes,
nés au même temps , & morts à différens
âges : j’en ferai mention dans la fuite.
Les lignes de la décrépitude prouvent
la foibleffe actuelle , & annoncent la def-
truâion prochaine du corps humain ; on
perd le fouvenir des chofes que l’on fe
rappelloit encore dans la vieilleffe ; la mémoire
manque abfolument : le cerveau a
pris trop de confiftance pour garder d’anciennes
imprelîlons, ou pour en recevoir
de nouvelles. Les nerfs font émouffés Sc
endurcis : on devient fourd Sc aveugle ;
on perd les fens de l’odorat , du toucher
6c du goût. L’appétit manque ; on ne fent
que le befoin de manger, encore y a-t-il
des vieillards qui n’ont que le fentiment
de la foif. Après que les dents font tombées,
la maftication eft imparfaite, & les digef-
tions mauvaifes : les lèvres rentrent en
dedans ; les bords des mâchoires étant
ufés, elles ne jpeuvent plus s’approcher
l’une de l’autre ; les mufcles de la mâchoire
inférieure deviennent fi foibles, qu’ils font
de vains efforts pour la relever Sc la retenir.
Le corps s’affaiffe dans la décrépitude ;
il perd de fa hauteur ; la colonne vertébrale
fe courbe en avant, parce que les
mufcles du dos ne font plus -affez forts
pour la tenir droite , Sc que les vertèbres
fe foudent les unes avec les autres par leur
partie antérieure. D ’autres articulations
dans les bras Sc les jambes fe roidiffent
Sc ne plient qu’avec peine. La maigreur
devient extrême ; les forces manquent ; le
' malheureux vieillard ne peut plus fe fou-
tenir ; il eft obligé de refter affis fur un
fiège , ou étendu dans fon lit, La velfie
devient paralitique ; les inteftins n’ont plus
de reffort. La circulation du fang fe ralentit
;Jes battemens du pouls ne font plus
au nombre de quatre-vingt, par minute ,
comme dans la force de l’âge , ils fe ré-
duifent jufqu’à vingt - quatre , Sc même
moins ; ils deviennent intermittens. La
refpiration eft plus lente ; le corps perd de
fa chaleur , Sc enfin le défaut de circula»
tion caufe la mort.
Durée de ta vit humaine (à).
* C ’eft à tort que l’Homme fe plaint
de la brièveté de la vie. De tous les êtres
qui refpirent, il en eft peu qui réunifient,
à un plus haut dégré, toutes les caufes
internes qui tendent, à en prolonger les
différentes périodes. Le temps de fa gefta-
tion eft confidérable, eu égard au volume
de fon corps. Il paroît être celui de tous
les animaux dans lequel le germe des dents
fe développe le plus tard. Son entier ae-
croiffement-, qui né s’achève que dans l’efi-
paee d’environ vingt ans , eft beaucoup
plus reculé que celui de plufieurs animaux
(a) Nota, Cet article, ainfi que les lùivans, eft extrait de la Phyfiologie de M. Haller,
'dont le volume ne furpaffe guère celui du
corps humain. On n’en connoît aucun qui
parvienne plus tard à l’âge de puberté.
Enfin , ce qui eft le point effentiel, le tiffu
cellulaire Sc toutes les parties du corps
font.d’une fubftance plus 'molle & plus
flexible dans l’Homme que dans aucun des
quadrupèdes. Si donc on doit regarder la
dureté que prennent, avec le temps, les
parties du corps , comme la caufe du dé-
périffement, de la vieilleffe Sc de la mort,
ces différens termes doivent être plus
éloignés pour l’Homme, dont la confti-
tution eft plus fouple , au point qu’il y a
moins de roideur Sc de dureté dans le
corps d’un vieillard même décrépit, que
dans celui d’un cheval de dix ans.
L’Homme paroît donc apporter , en
naiffant, le germe d’une longue vie , Sc
s’il eft enleve long-temps avant d’arriver
à ce terme reculé que fa nature fembloit
lui promettre, ce ne peut être que par des
caufes accidentelles qui lui font comme
étrangères. Lorfqu’on dit qu’il a ceffé de
vivre , c’eft plutôt qu’il n’a point achevé.
Quant à la durée naturelle de la v ie ,
il n’eft pas aifé d’en fixer tes bornes pré-
cifes. Cependant, s’il étoit vrai que la vie
des animaux fût environ huit fois auffi
longue que le temps de leur accroiffement,
on en concluroit que les dernières limites
de la vie humaine peuvent être reculées
jufqu’au de là d’un fiècle & demi, ce qui
eft affez conforme à l’expérience, comme
on le verra plus bas.
Il n’eft pas vrai que la vie humaine
s’abrège , à mefure que la durée du monde
augmente. Au temps de Da vid , les bornes
ordinaires de la vie ne paffoient pas
foixante Sc dix ou quatre-vingt ans. Aucun
roi de Juda n’a paffé cette époque. Cependant
, lorfque l’empereur Vefpafien f i t .
le dénombrement des Romains , dans un
fiècle de mollefi’e , il fe trouva dans l’empire
dix vieillards de cent vingt ans Sc au
de là. Parmi les princes modernes, .Louis
le Grand a- vécu foixante & dix-fept ans.
Stanislas l’a furpaffé, Sc Clément XII a été
• jufqu’à quatre-vingt-huit ans. A Londres,
cette grande v ille , dont le féjour paroîtroit
devoir être moins falubre que celui de la
campagne , fur le nombre des morts de
chaque année , il s’en trouve entre vingt
Sc vingt-quatre mille qui ont paffé quatre-
vingt-dix ans ; Sc , parmi ces derniers,
environ cinquante qui ont compté leur
centième année depuis trois jufqu’à
feptqui ont pouffé leur carrière encore plus
loin.
Lés Tranfaélions philofophiques font
mention d’un Anglois , nommé Ecclefton,
quia pouffé fa Carrière jufqü’à cent-qua»
rante-trois ans. Un autre Anglois , nommé
Effingham, a vécu jufqu’à Cent quarante-
quatre ans, Sc eft mort en 1757 , au mois
de Février.
Parmi les vieillards de Norvège, on en
compte un de cent cinquante ans.
Le nommé Thomas Parre , Anglois ,
eft mort à l’âge de cent cinquante - deux
ans, le 14 Novembre 1635. La caufe de
fa mort fut une furabondance d’humeur,
.produite par la bonne chère , à laquelle il
avoit commencé à fe livrer , depuis qu’il
eut éprouvé les bienfaits du Roi.
En général, on confervfe dans l’Angleterre
& dans l’Irlande , le fouvenir d’un
grand nombre d’hommes qui ont joui d’une
longue v ie , foit que dans ces pays , les cir- •
confiances foient par elles - mêmes plus
favorables à la fanté , foit qu’on y tienne
•un compte plus exaft de ceux dont la vie
a paffé les bornes ordinaires.
Mais, de tous les hommes qui ont exifté
depuis un temps confidérable , aucun ne
paroît avoir fourni une plus longue carrière
que Henri Jenkins , auffi Anglois,
qui, d’après tous les indices que l’on a pu
raffembler fur fon âge , doit avoir vécu
environ 169 ans. Voye^ Haller , Phyfiol.
M. le comte de Buffon a recueilli divers
exemples de perfonnes qui ont vécu cent
dix ans Sc au-delà.
Guillaume Lecomte, berger de profefo
fion, mort fubitement en 1-776, dans la
paroiffe de Theuville-aux-Maillots , dans
le pays de Caux, âgé de cent dix ans.
Dans la nomenclature d’un Profeffeur de
Dantzick, nommé Hanovius, on cite un
Médecin Impérial, nommé Cramers, qui