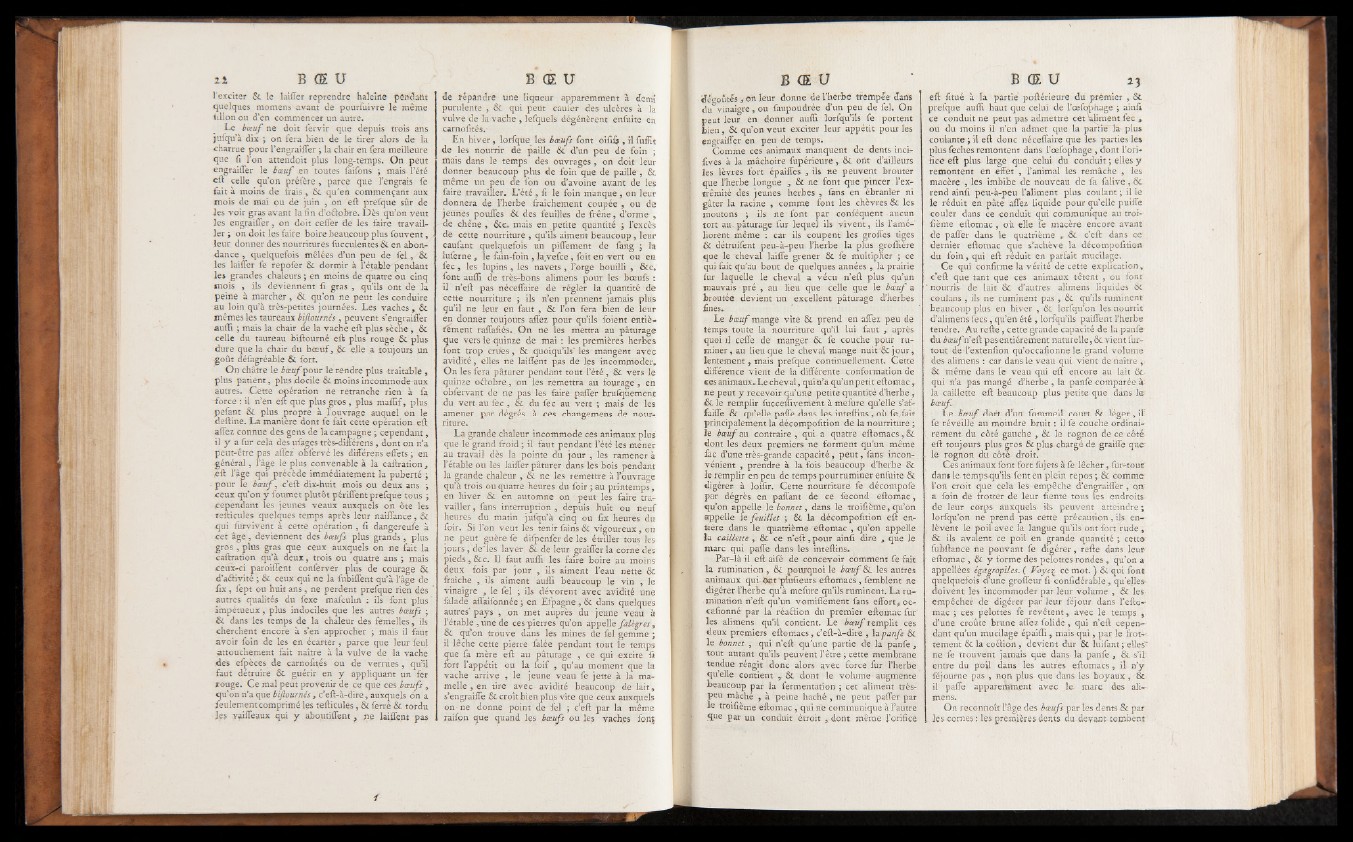
1 e x c i te r & le laiffer rep ren d re haleine pênçtaîlt
quelq ues m om en s^ av an t de p o u rfu iv re le m êm e
lillon ou d’en com m e n c e r un au tre .
L e boeuf ne do it fe rv ir que depuis tro is ans
jufqu’à dix ; o n fe ra bien de le tire r alors de la
ch a rru e p ou r l’engraiffer ; la ch a ir en fera meilleure
q u e fi l’o n a tten d o it plus lon g -tem p s . O n .p e u t
engraifler le boeuf en to u te s faifons ; mais l’été
e l t celle qu’o n p ré fè re , p a rce que l’engrais fe
fa it à mo ins de frais , & qu’en com m e n ç a n t au x
m o is de m a i ou d e juin , on e ft p refq u e sur de
le s v o ir g ras a v an t la fin d’o â o b r e . D è s qu’o n v eu t
le s en g ra if le r , o n d o it ceffer de les faire trav a ille
r ; o n do it le s faire b o ire b e au cou p plus f o u v e n t ,
leu r d o n n e r des n o u rritu re s fucculentes & en abond
a n c e , quelquefois m ê lé e s d’un p eu d e f e l , &
le s lailfer fe rep o fe r & do rmir à l’é tab le pendant
le s g ran des chaleurs ; en mo in s de q u atre o u cinq
m o is , ils d e v ien n en t fi g ras , q u ’ils o n t d e la
p e in e à m a r c h e r , & qu’o n n e p eu t les conduire
a u loin qu’à trè s -p e tite s jo u rn é e s . L e s v a c h e s , &
m êm e s les tau re au x bijlournés , p eu v en t s’engraiffer
aufli ; mais la chair de la v a ch e e ft plus s è c h e , &
c e lle du tau re au biftourné e f t plus ro u ge & plus
d u re que la chair du b oe u f , &. elle a .toujours u n
g o û t défagréable & fo rt.
O n ch âtre le boeuf p o u r le ren d re plus tra itab le ,
plus p a t i e n t , plus d o c ile & mo in s in com m o d e au x
au tre s . C e t te o p é ra tio n n e re tran ch e rien à fa
'f o r c e : il n’en e ft q u e plus g r o s , plus m a fiif, plus
p e fan t & plus p ro p re à l’o u v ra g e auquel o n le
d e ftin e . L a m an iè re don t fe fait c e tte o p é ra tio n eft allez con n u e d es gens de la cam p agn e ; c e p e n d a n t,
il y a fur ce la des ufages trèsrdifférens, d o n t on n’a
p e u t-ê tre pas affez o b fe rv é les différens effets ; en
g é n é r a l , l’âge le plus co n v en ab le à la ca ftration ,
e f t l’âge qui p ré cèd e im m éd ia tem en t la p u b e rté ;
p o u r le boeuf, c ’eft dix-huit mo is p u d eu x ans ;
c e u x qu’on ÿ foumet p lu tô t p enflent prefque to u s ;
cep e n d a n t le s jeunes v e a u x auxquels o n ô te les
te fticu le s quelq ues tem p s ap rè s leu r n a iffan c e , &
qui fiirv iy en t à c e tte op é ra tio n , fi dangereufe à
c e t â g e , d e v ien n en t des boeufs plus g ra n d s , plus
g ro s , plûs gras que ce u x auxquels o n n e fait la
ca ftra tio n qu’à d e u x , tro is o u q uatre ans ; mais
c e u x - c i paroiffent co n fe rv e r plus de co u ra g e &
d ’aéHvité ; & ceu x ' qui ne la fubiffent qu’à l’âge de
f i x , fep t ou huit a n s , n e p e rd en t prefque rien des
au tre s qualités du fe x e mafculin ; ils font plus
im p é tu e u x , plus in d o ciles que le s au tre s boeufs ;
& dans les tem p s de la chaleur des femelles , ils
ch e rch en t en co re à s’en ap p ro ch e r ; mais il faut
a v o ir foin de les en é c a r t e r p a r c e que leu r feul
a tto u ch em en t fait n a ître à la v u lv e de la v ache
d e s e fp è ce s de carno fités ou de v e r r u e s , qu’il
fau t détruire & guérir en y appliquant un fer
ro u g e . C e m a l p eu t p ro v en ir de c e que ce s boeufs ,
q u ’on n’a que bijlournés , c ’e f t-à -d ire , auxquels on a
feu lem en t com p rim é les te f ticu le s , & ferré & to rd u
le s y aiffeaux qui y ab o u tif fe n t, n e laiflent p as
de répandre une liqueur apparemment à demi
purulente , & qui peut cauler des ulcères à la
vulve de la vache , lefquels dégénèrent enfuite en
carnofités.
En hiver, lorfque^ les boeufs font oifif^, il fuffit
de les nourrir de paille & d’un peu de foin ;
mais dans le temps des ouvrages, on doit leur
donner beaucoup plus de foin que de paille , &
même un peu de fo.n ou d’avoine avant de les
faire travailler. L’été , fi le foin manque , on leur
donnera de l’herbe ffaichement coupée , ou de
jeunes pouffes .& des feuilles de frêne, d’orme ,
de chêne, &e. mais en petite quantité •; l’excès
de cette nourriture , qu’ils aiment beaucoup, leur
caufant quelquefois un piffement de fang ; la
luferne, le fain-foin , layefce , foit en -vert ou en
fec, les lupins, les navets , l’orge bouilli , &c.
font aufli de très-bons alimens pour les boeufs :
il n’eft pas néceffaire de régler la quantité de
cette nourriture ; ils n’en prennent jamais plus
gu’il ne leur en faut , & l’on fera bien de leur
en donner toujours aflez pour qu’ils foient entièrement
raffafiés. On ne les mettra au pâturage
que vers le quinze de mai : les premières herbes
font trop crûtes, & quoiqu’ils' les mangent avec
avidité, elles ne laiflent pas de les incommoder.
On les fera pâturer pendant tout l’é té, & vers le
quinze oélobre, ,on les remettra au fourage , en
obfervant de ne pas les faire paffer brufquement
du vert au fec , & du fec au vert ; mais de les
amener par dégrés à ces changemens de nourriture.
La grande chaleur incommode ces animaux plus
que le grand froid ; il faut pendant l’été les mener
au travail dès la pointe du jour , les ramènera
l’étable ou les laiffer pâturer dans les bois pendant
la grande chaleur , & ne les remettre à l’ouvrage
qu’à trois ou quatre heures du foir ; au printemps,
en hiver & en automne on peut les faire travailler
, fans interruption., depuis huit ou neuf
heures du matin jufqu’à cinq ou fix heures du
foir. Si 1’ on veut les tenir fains & vigoureux, on
ne peut guère fe difpenfer de les étriller tous les
jours, de'les laver & de leur graiffer la corne des
p ieds& c. Il faut aufli les faire boire au moins
deux fois par jour. , ils aiment l’eau nette &
fraîche , ils aiment aufli beaucoup le vin , le
vinaigre , le fel ; ils dévorent avec avidité une
falade affaifonnée ; en Efpagne& dans quelques
autres' pays , on met auprès du jeune veau à
l’étable , une de ces pierres qu’on appelle falègres,
&L qu’on trouve dans les mines de fel gemme ;
il lèche cette pierre falée pendant tout le temps
que fa mère eft au pâturage , ce qui excite fi
fort l’appétit ou la foif , qu’au moment que la
vache arrive , le. jeune veau fe jette à la mamelle
, en tire avec avidité beaucoup de lait,
s’engraiffe & croît bien plus vite que ceux auxquels
on ne donne, point de fel ; c’eft par la même
raifon que quand les boeufs ou les yaches fon|
ƒ
dégoûtés > on leur donne de l’herbe trempée dans
du vinaigre, ou faupoudrée d’un peu de fel. On
peut leur en donner aufli lorfqu’ils fe portent
bien, & qu’on veut exciter leur appétit pour les
engraifler en peu de temps.
Comme ces animaux manquent de dents inet
fivès à la mâchoire fupérieure, & ont d’ailleurs
les lèvres fort épaiffes , ils ne peuvent brouter
que l’herbe longue , & ne font que pincer. l’extrémité
des jeunes herbes , fans en ébranler ni
gâter la racine , comme font les chèvres & les
moutons ; ils ne • font par conféquent aucun
tort au.pâturage fur lequel ils vivent, ils l’améliorent
même : car ils coupent les greffes tiges
& détruifent peu-à-peu l’herbe la plus groflière
que le cheval laiffe grener & fe multiplier ; ce
qui fait qu’au bout de quelques années , la prairie
fur laquelle le cheval a vécu n’eft plus qu’un
mauvais pré , au lieu que celle que le boeuf a
broutée devient un excellent pâturage d’herbes
£nes-
Le boeuf mange vîte & prend en affez peu de
temps toute la npurriture qu’il lui faut , après
quoi il ceffe de manger & fe couche pour ruminer
, au lieu que le cheval mange nuit & jour,
lentement, mais prefque continuellement. Cette
différence vient de la différente conformation de
ces animaux*.Le cheval, qui n’a qu’un petit eftomac y
ne peut y recevoir qu’une petite quantité d’herbe ,
&. le remplir fucceflivenîent à mefure qu’elle s’af-
faiffe ôc qu’elle paffe dans les inteftins , où fe,fait
principalement la décompofition de la nourriture ;
le boeuf a.u contraire , qui a quatre eftomacs, &
dont les deux premiers ne forment qu’un même
fàc d’une très-grande capacité , peut, fans inconvénient
, prendre à la fois beaucoup d’herbe &
le remplir en peu de temps pour ruminer enfuite &
digérer à loifir. Cette nourriture fe décompofe
par dégrès en paffant de ce fécond eftomac,
qu’on appelle le bonnet, dans le troifiëme, qu’on
appelle le feuillet ; & la décompofition eft entière
dans le quatrième eftomac , qu’on appelle
la caillette , & ce n’eft, pour ainfi dire , que le
marc qui paffe dans les inteftins^
Par-là il eft aifé de concevoir comment fe fait
la rumination , ôç pourquoi le boeuf & les autres
animaux qui- Sot 'piufieurs eftomacs, femblent ne
digérer l’herbe qu’à mefure qu’ils ruminent. La rumination
n’eft qu’un vomiffement fans effort* oc-
cafionné par la réa&ion du premier eftomac fur
les alimens qu’il contient. Le boeuf remplit ces
deux premiers eftomacs,. c’eft-à-dire , la panfe &
le bonnet , qui n’eft qu’une partie de la panfe ,
tout autant qu’ils peuvent l’être ; cette membrane
tendue réagit, donc alors avec force fur l’herbe
qu’elle contient ,. &L dont le volume augmente
beaucoup par la fermentation ; cet aliment très-
peu mâché , à peine haché, ne peut paffer par
le troifième eftomac , qui ne communique à l’autre
que par un conduit étroit dont même l’orifice
eft fitué à la partie poftérieure du premier , &
prefque aufli haut que celui de l’oefqphage ; ainfi
ce conduit ne peut pas admettre cet 'aliment.fec ,
ou du moins il n’en admet que la partié~la plus
coulante ; il eft donc néceffaire que les parties les
plus feches remontent dans l’oefophage , dont l’orifice
eft plus large que celui du conduit ; elles y
remontent en effet , l’animal les remâche , les
macère , les imbibe de nouveau de fa falive, Sc
rend ainfi peu-à-peu l’aliment plus coulant ; il le
le réduit en pâte affez liquide pour qu’elle puiffe
couler dans ce conduit qui communique au troi-
fième eftomac, où elle fe macère encore avant
de paffer dans le quatrième , & c’eft dans ce
dernier eftomac que s’achève la décompofition
du foin, qui eft réduit en parfait mucilage.
Ce qui confirme la vérité de cette explication,
c’eft que tant que ces animaux tètent , ou font
* nourris de lait & d’autres alimens liquides &
coulans , ils ne ruminent pas , & qu’ils ruminent
. beaucoup plus en hiver , & lorfqu’on les nourrit
d’alimens fecs , qu’en été , lorfqu’ils paiffent l’herbe
tendre. Au refte, cette grande capacité de la panfe
du boeuf n’eft pas entièrement naturelle, & vient fur-
tout de l’extenfion qu’occafionne le grand volume
des alimens : car dans le veau qui vient de naître ,
& même dans le veau qui eft encore au lait
qui n’a pas mangé d’herbe , la panfe comparée à
la caillette èft beaucoup plus- petite que dans le-’
boeuf
Le boeuf dort d’un' fommeil court & léger, il
fe réveille au moindre bruit : il fe couche ordinal
. rement du côté gauche , & le rognon de ce côté
eft toujours plus gros & plus chargé de graiffe que-
le rognon du côté droit.
Ces animaux font fort fujets à fe lécher , fur-tout
dans le-temps qu’ils font en plein repos; & comme
l’on croit que cela les empêche d’engraiffer, on
■ a foin de frotter de leur fiente tous les endroits
de leur corps auxquels ils peuvent atteindre ;
lorfqu’on ne prend pas cette précaution , ils- en—^
lèvent le poil avec la langue qu’ils ont fort rude,
& ils- avalent ce poil en grande quantité ; cette
fubftance ne pouvant fe digérer, refte dans leur'
eftomac , & y forme des pelottes rondes, qu’on a
appellées égagropiles. ( Voye£ ce mot. ) & qui font
quelquefois d’une groffeur fi confidérable, quelles-
doivent les incommoder par leur volume , & les
empêcher de digérer par leur féjour dans l’efto--
mac ; ces pelottes fe revêtent, avec le temps ,
d’une croûte brune affez folidè, qui n’eft cependant
qu’un mucilage épaifli, mais qui, par le frottement
& la coâion , devient dur & luifant ; ellesr
ne fe trouvent jamais que dans, la panfe , & s’il
entre du pofl dans les autres eftomacs, il n’y
féjourne pas , non plus que dans les boyaux, -
il paffe apparemment avec le. marc des alimens.
On reconnoît l’âge des boeufs par les dents & par
. les cornes : les premières dents du devant tombent