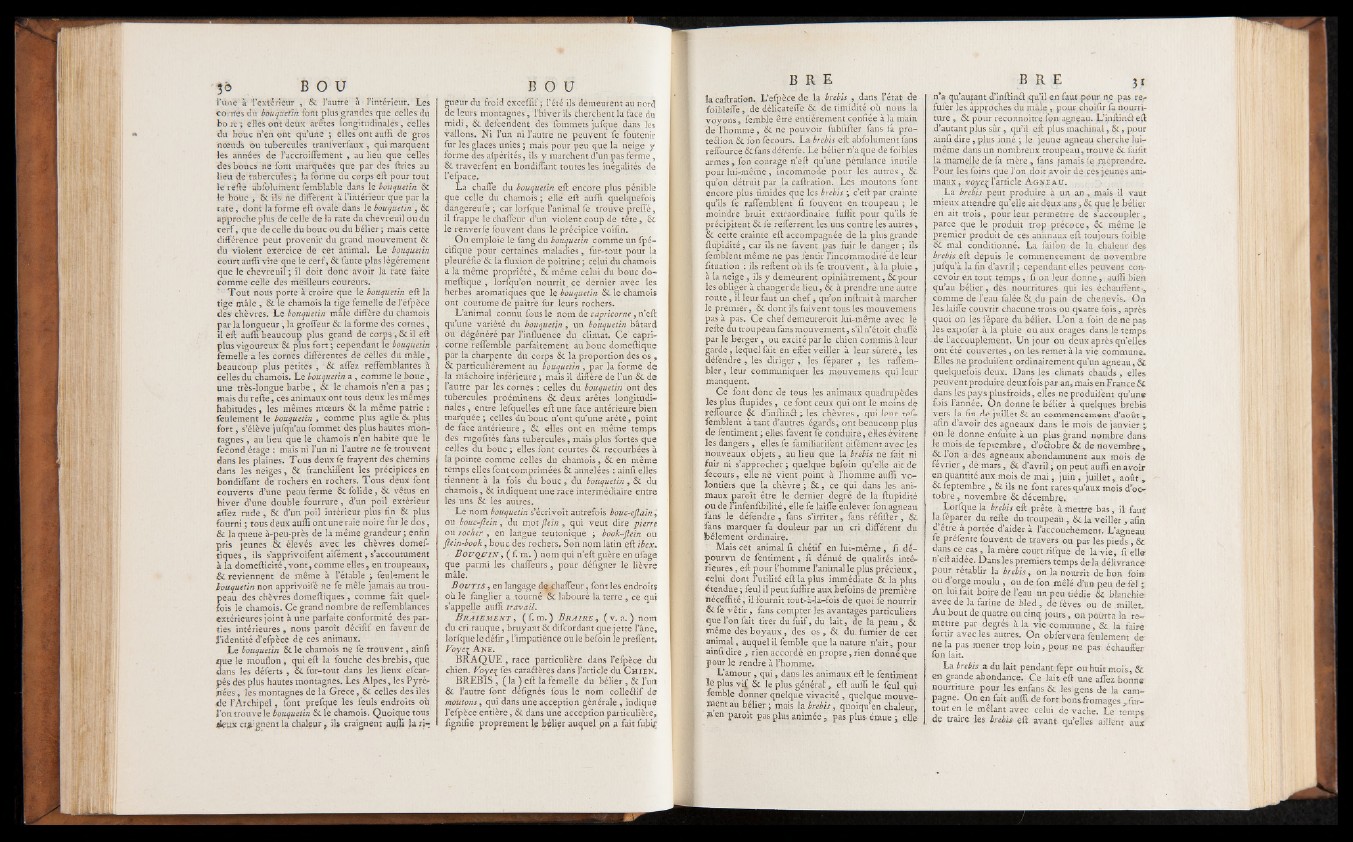
Fune à l'extérieur , & Fautre à Pintérieur. Les
cortfes xlu- bouquetin font plus grandes que celles du
bore; elles ont deüx arêtes longitudinales, celles
du boue ri’en ont qu’une ; elles ont auffi de gros
noeuds ou tubercules tranfverfaux, qui marquent
les années de Faccroiffemènt , au lieu que celles
des boucs ne font marquées que par des ftries au
lieu de tubèrcules.; la forme du corps eft pour tout
le refie àbfoluinent femblable dans le bouquetin 6c
le bouc , 6c ils n'ê diffèrent à l’intérieur que par la
rate, dont là forme eft ovale dans le bouquetin , 6c
approche plus de celle de la rate du chevreuil ou du
cerf, que de celle du bouc ou du bélier; mais cette
différence peut provenir du grand mouvement &
du violent exercice de cet animal. Le bouquetin
court auffi vite que le cerf, 6c faute plus légèrement
que le chevreuil ; il doit donc avoir la rate faite
comme celle des meilleurs coureurs. ■
Tout nous porte à croire que le bouquetin eft la
tige mâle , 6c le chamois la tige femelle de l’èfpèce
des chèvres. Le bouquetin mâle diffère du chamois
par la longueur, la groffeur & la forme des cornes ,
il eft aufli beaucoup plus grand de corps , 6c il eft
plus vigoureux 6c plus fort ; cependant le bouquetin
femelle a les cornes différentes de celles du mâle,
beaucoup plus petites , 6c affez reffemblantes à
celles du chamois. Le bouquetin a , comme le bouc,
une très-longue barbe , 6c le chamois n’en a pas ;
mais du refte, ces animaux ont tous deux les mêmes
habitudes, les mêmes moeurs 6c la même patrie :
feulement le bouquetin , comme plus agile 6c plus
fort, s’élève jufqu’au fommet des plus hautes montagnes
, au lieu que le chamois n’en habite que le
fécond étage : mais ni l’un ni l’autre ne fe trouvent
dans les plaines. Tous deux fe frayent des chemins
dans les neiges, 6c franchiffent les précipices en
bondiffant de rochers en rochers. Tous deux font
couverts d’une peau ferme 6c folide , 6c vêtus en
hiver d’une double fourrure, d’un poil extérieur
affez rude, 6c d’un poil intérieur plus fin & plus
fourni ; tous deux auffi ont une raie noire fur le dos,
6c la queue à-peu-près de la même grandeur ; enfin
pris jeunes 6c élevés avec les chèvres domef-
tiques, ils s’apprivoifent aifément, s’accoutument
à la domefticité, vont, comme elles, en troupeaux,
6c reviennent de même à l’étable ; feulement le
bouquetin non apprivoifé ne fe mêle jamais au troupeau
des chèvres domeftiques , comme fait quçl-
fois le chamois. Ce grand nombre de reffemblances
extérieures joint à une parfaite conformité des parties
intérieures , nous paroîî décifif en faveur de
l ’identité d’efpèce de ces animaux.
Le bouquetin 6c le chamois ne fe trouvent, ainfi
que le mouflon, qui eft la louche des brebis, que.
dans les déferts , Ôc fur-tout dans les lieux efcar-
pés des plus hautes montagnes. Les Alpes, les Pyrér
jnées, les montagnes de la Grece, & celles des îles
de FArchipél, font prefque les feuls endroits où
l’on trouve le bouquetin 6c lé chamois. Quoique tous
deux craignent la chaleur, ils craignent au.® la rigueur
du froid e x c e f f i f ; l’é té ils dem eu ren t au nord
de leurs m o n ta g n e s , l’h iv e r ils ch e rch en t la fa ce du
m id i, 6c d efcend ent des fommets jufque dans les
v a llo n s. N i l’un ni l’au tre ne p eu v en t fe foutenir
fur les glaceà unies ; mais p ou r peu que la neige y
fo rm e des afp é rité s, ils y m a rch en t d’un pas ferme ,
6c tra v e rfen t en bondiffant tou tes les inégalités de
l’e fp a ce .
L a chaffe du bouquetin e ft en co re plus pénible
que celle du chamois ; elle eft auffi quelquefois
dàngereufe ; ca r lorfque l’animal fe tro u v e p re f fé ,
il frappe le chaffeur d’un v io le n t co u p de t ê t e , ôc
le ren v e rfe fo u ven t dans le p ré c ip ice v o ifin .
O n emploie le fang du bouquetin com m e un fp é -
cifique p ou r certaines m a la d ie s , fu r-tou t p ou r la
pleuréfie & la fluxion de poitrine ; celui du chamois
a la m êm e p ro p rié té , & m êm e celui du b o u c d o -
meftiq ue , lorfqu’on n o u rrit, c e dernier a v e c les
herbes aromatiques que le bouquetin ôc le chamois
o n t co u tum e de paître fur leurs ro ch e rs .
L ’animal connu fous le n om de capricorne, n’eft
qu’une v a rié té du bouquetin, un bouquetin b â ta rd
ou dég énéré p ar l’influence du c limat. C e caprico
rn e reffemble p a rfa itemen t au b o u c domeftique
p a r la ch a rp e n te . du co rp s Ôc la p ro p o rtion des os ,
& p a rticu lié rem en t au bouquetin , p a r la fo rm e d e
la m â ch o ire inférieure ; mais il diffère de l’un ôc de
Fautre p ar les co rn e s : celles du bouquetin o n t des
tubercules p rô éminens & d eu x a rêtes longitudinales
* en tre lefquelles e ft une face antérieure bien
m a rq u é e ; celles du.bouc n’o n t qu’une a r ê te , point
de face an térieu re , ôc elles o n t en m êm e tem p s
des rugofités fans tu b e r cu le s , mais plus fo rte s que
celles du b o u c ; elles.font cou rtes 6c re co u rb é e s à
la p o in te com m e celles du ch am o is , ô c en m êm e
tem p s elles font com p rim é e s ôc annelées : ainfi elles
tien n en t à la fois du b o u ç , du bouquetin , ÔC du
ch am o is , & indiquent une ra c e in terméd iaire e n tre
les uns ôc lès autres.
L e n om bouquetin s 'é c riv o it autrefois bouc-ejlain
ou bouc-flein, du m o t jlein , qui v e u t dire pierre
ou rocher , en langue teutonique ; book-flein ou
Jlein-book, b o u c des ro ch e rs. Son n om latin eft ibex.
• Bouquin , ( f. m . ) n om qui n ’e ft gu ère en ufage
que p a rm i les ch a ffeu rs , p ou r déftgner le liè v re
m â le .
B o u t i s , en langage dqxhaffeur, font les endroits
où le fanglier a tourné oc labouré la terre , ce qui
s’appelle aufli travail.
B r a ie m e n t , ( f. m . ) B r a ir e , ( v . a. ) n om
du cri ra u q u e , b ru y an t & difcordant que je tte l’ân e ,
lorfque le d é fir, l’imp atien ce ou le befoin le p reffent.
Voyei A ne.
BRAQUE, race particulière dans l’efpèce du
chien. Voyeç fes caraflères dans l ’article du C h ie n ,
BREBIS, ( la ^ eft la femelle du b é li e r , ôc Fui?
ôc l’au tre font défignés fous le n om co lle é lif de
moutons, qui dans une a cc ep tio n générale , indique
l’e fp è ce e n tiè r e , ôc dans u n e a ccep tio n particulière,
fignifie p ro p rem en t le b élier auquel pn a fait fubi£
la caftration. L’efpèce de la brebis , dans l’état de
foibleffe, de délicateffe ôc de timidité où nous la
voyons, femble être entièrement confiée à la main
'de l’homme, ôc ne pouvoir fubfifter fans- fa pfo-
teélion ôc fon fecours. La brebis eft abfolument fans
reffource & fans défenfe. Le bélier n’a que de foibles
armes, fon courage n’eft qu’une pétulance inutile
pour lui-même, incommode pour les autres, ÔC
qu’on détruit par la caftration. Les moutons font
encore plus timides que les brebis ; c’eft par crainte
qu’ils fe raffemblent fi fouvent en troupeau ; le
moindre bruit extraordinaire, fuffit pour qu’ils fe
précipitent & fe refferrent.les uns contre fes autres,
6c cette crainte eft accompagnée de la plus grande
ftupidité, car ils ne favent pas fuir 1e danger ; ils
femblent même ne pas fentir l’incommodité de leur
fituation : ils relient où ils fe trouvent, à la pluie ,
à la neige , ils y demeurent opiniâtrement, ÔCpour
fes obliger à changer de lieu, & à prendre une autre
route, il leur faut un chef, qu’on inftruit à marcher
le premier, 6c dont ils fuivent tous fes mouvemens
pas à pas. Ce chef demeureroit lui-même avec 1e
refte du troupeau fans mouvement, s’il n’étoit chaffé
par 1e berger , ou excité par 1e chien Commis à leur
garde , lequel fait en effet veiller à leur sûreté, fes
défendre , fes diriger , fes féparer , fes raffèm-
bler, lëur communiquer fes mouvemens qui leur
manquent.
Ce font donc de tous fes animaux quadrupèdes
les plus flupides , ce font ceux qui ont 1e moins de
reffource 6c d’inflinél ; fes chèvres, qui leur r.ef-
femblent à tant d’autres égards, ont beaucoup plus
de fentiment ; elles favent fe conduire, elles évitent
fes dangers , elfes fe familiarifent aifément avec fes
nouveaux objets, au lieu que la brebis ne fait ni
fuir ni s’approcher ; quelque befoin qu’elle ait de
fecours, elle nê vient point à. l’homme auffi volontiers
que la chèvre ; 6c, ce qui dans fes animaux
paroît être 1e dernier degré de la ftupidité
ou de l’infenfibilité, elfe fe laiffe enlever fon agneau
fans 1e défendre , fans s’irriter, fans réfifter, 6c
fans marquer là douleur par un cri différent du
bêlement ordinaire.
Mais cet animal fi chétif en lui-même, fi dépourvu
de fentiment, fi dénué de qualités intérieures
, eft pour l’homme l’animal le plus précieux,
celui dont Futilité eft la plus immédiate & la plus
étendue ; feul il peut fufiire aux befoinsde première
néceffité, il fournit tout-à-la-fois de quoi le nourrir
6c fe vêtir, fans compter fes avantages particuliers
que Fon fait tirer du fuif, du lait, de la peau , 6c
même des boyaux, des os ,ô c du. fumier de cet
animal, auquel il femble que la nature n’ait, pour
ainfi dire , rien accordé en propre, rien donné que
pour fe rendre à l’homme.
L’amour , qui, dans les animaux eft fe fentiment
ïe plus vi£ 6c 1e plus général, eft auffi 1e feul qui
femble donner quelque vivacité , quelque mouvement
au bélier ; mais la brebis, quoiqu’en chaleur,
^ en paroît pas plus animée, pas plus- émue i elle
n’a- qu-’autant d’inftinél qu’il en faut pour ne pas re«-
fufer les. approches du mâle., pour choifir fa nourriture
, 6c pour reconnoître.lpu agneau. L’inftinél eft
d’autant plus sûr , qu’il eft plus machinal, ôc, pour
ainfi dire , plus inn,é ; le jeune agneau cherche lui-
même dans un nombreux troupeau, trouve 6c faifit
la mamelle de fa mère , fans jamais fe méprendre.
Pour les foins que l’on doit avoir de ces jeunes animaux
j vqye^ l’article A gneau.
La brebis peut produire à un an, mais il vaut
mieux attendre qu’elle ait deux.ans,, 6c que le bélier
en ait trois , pour leur permettre de s’accoupler ,
parce que 1e produit trop précoce, 6c même le
premier produit de ces animaux eft toujours foible
6c mal conditionné. La faifon de la chaleur des
brebis eft depuis le commencement de novembre
jufqu’à la fin d’avril ; cependant elfes peuvent concevoir
en tout temps , fi on leur donneauffi bien
qu’au bélier, dès nourritures qui les échauffent y
comme de l’eau falée 6c .du pain de chenevis. On
fes laiffe couvrir chacune trois ou quatre fois, après
quoi on fes fépare du bélier. L’on a foin de ne pas
les expofer à la pluie ou aux orages dans 1e temps
de l’accouplement. Un jour ou deux après qu’elles
ont été couvertes, on les remet à la vie commune.
Elfes ne produifent ordinairement qu’un agneau, 6t
quelquefois deux. Dans les climats chauds, elles
peuvent produire deux fois par an, mais en France6c
dans les pays plusfroids, elles ne produifent qu’une
fois l’année. On donne le bélier à quelques brebis
vers la fin de juillet 6c au commencement d’août ,
afin d’avoir des agneaux dans fe mois de janvier
on le donne enfuite à un plus grand nombre dans
1e mois de feptembre, d’oélobre 6c de novembre
6c l’on a des agneaux abondamment aux mois de
février, dé mars, 6c d’avril ; on peut auffi en avoir
en quantité aux mois de mai, juin , juillet, août y
6c feptembre, 6c ils ne font rares qu’aux mois d’octobre
, novembre 6c décembre.
Lorfque la brebis eft prête à mettre bas, il faut
appâter du refte du troupeau, 6c la veiller, afin
d etre a portée d aider a l’accouchement. L’agneau
fe préfenre fouvent de travers ou par les pieds , 6c
dans ce cas, la mère court rifque de la vie, fi ell<r
n’eft aidée. Dans fes premiers temps de là délivrance-
pour rétablir la brebis, on la nourrit de bon foin--
ou d orge moulu , ou de fon mêlé d’un peu. de fel ;
on lui lait boire de l’eau un peu tiédie 6c blanchie
avec de la farine de bled, de fèves ou de millet.
Au bout de quatre ou cinq jours, on pourra la remettre
par degrés à la vie commune, ôc la faire
fortir avec fes autres. On obfervera feulement de-
ne la pas mener trop loin, pour ne pas échauffer
fon lait.
La brelis a du lait pendant fept ou huit mois, &
en grande abondance. Ce lait eft une affez bonne
nourriture pour les enfans & les gens de la campagne.
On en fait aufli de fort bons-fromages , fur-
tout en le mêlant avec celui de vache. Le temps
de traire les irebit eft avant tjp’élles aillent aux