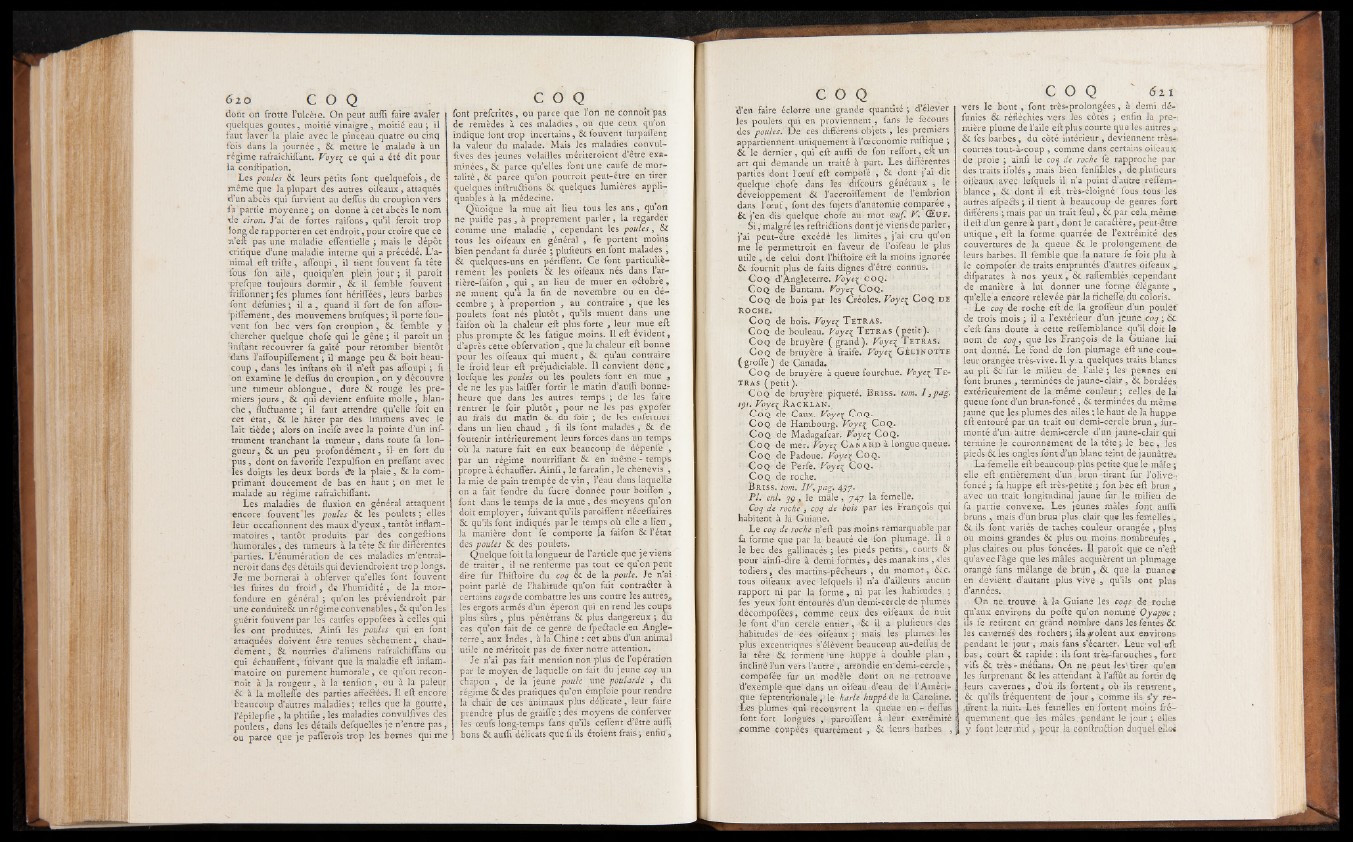
dont on frotte l’ulcèie. On peut auffi faire avaler
quelques goûtes, moitié vinaigre , moitié eau ; il
laut laver la plaie avec le pinceau quatre ou cinq
fois dans la journée , &. mettre le malade à un
régime rafraîchiffant. Voyeç ce qui a été dit pour
la conftipation.
Les poules & leurs petits font quelquefois, de
même que la plupart des autres oifeaux, attaqués
d’un abcès qui furvient au delfus du croupion vers
fa partie moyenne; on donne à cet abcès le nom
de ciron. J’ai de fortes raifons, qu’il feroit trop
long de rapporter en cet endroit, pour croire que ce
n’eft pas une maladie effentielle ; mais le dépôt
critique d’une maladie interne qui a précédé. L’animal
eft trille , affoupi, il tient fouvent fa tête
lous fon aile, quoiqu’en plein jour ; il paroît
prefque toujours dormir , & il femble fouvent
ff iffonner ; fes plumes font hérilfées, leurs barbes
font défunies ; il a , quand il fort de fon affou-
piffemént, des mouvemens brufques ; il porte fouvent
fon bec vers fon croupion, & femble y
chercher quelque chofe qui le gêne ; il paroît un
finftant recouvrer fa gaîté pour retomber bientôt
dans l’alfoupilfement ; il mange peu & boit beaucoup
, dans les inftans où il n’eft pas affoupi ; fi
on examine le deffus du croupion, on y découvre :
une tumeur oblongue, dure & rouge les premiers
jours, & qui devient enfuite molle, blanche
, flu&uante ; il faut attendre qu’elle foit en
cet état, &. lé hâter par des linimens avec le
lait tiède ; alors on incife avec la pointe d’un inf-
trument tranchant la tumeur, dans toute fa longueur
, & un peu profondément, il- en fort du
pus , dont on favorife l’expulfion en preffant avec
les doigts les deux bords cfe la plaie, & la comprimant
doucement de bas en haut ; on met le
malade au régime rafraîchiffant.
Les maladies de fluxion en général attaquent
encore fouvent’ les poules & les poulets ; elles
leur occafionnent des maux d’yeux, tantôt inflammatoires
, tantôt produits par des corigeftions
humorales , des tumeurs à la tête & fur différentes
parties. L’énumération de ces maladies m’èntraî-
neroit dans des détails qui deviendroient trop longs.
Je me bornerai à obferver qu’elles font fouvent
les fuites du froid, de l’humidité, de la mor-
fondure en général ; qu’on les préviendroit par
une conduite & un régime convenables, & qu’on les
guérit fouvent par les caüfes oppofées à celles qui
les ont produites. Ainfi les poules qui en font
attaquées doivent être tenues sèchement, chaudement
, & nourries d’âlimens rafraîchiffans ou
qui échauffent, fuivant que la maladie eft inflammatoire
ou purement humorale, ce qu’on recon-
noît à la rougeur, à la tenfioh , ou à la pâleur
& à la molleffe des parties affeéléës. Il eft encore
beaucoup d’autres maladies; telles que la goutte,
fépilepfie , la phtifie , les maladies convulfives des
poulets, dans les détails defquelles je n’entre pas',
©u parce que je pafferois trop les bornes qui me
font prefcrites, ou parce que l’on nè connoît ’paé
de remèdes à ces maladies, ou que ceux qu’on
indique font trop incertains, & fouvent furpaflent
la valeur du malade. Mais les maladies convulfives
des jeunes volailles mériteroient d’être examinées,
&. parce quelles font une caufe demortalité
, &. parce qu’on pourroit peut-être en tirer
quelques inftruéfions & quelques lumières appliquâmes
à la médecine.
{Quoique la mue ait lieu tous les ans, qu on
ne puiffe pas, à proprement parler, la regarder
comme une maladie , cependant les poules, &
tous les oifeaux en général , fe portent moins
bien pendant fa durée ; plufieurs en font malades ,
& quelques-uns en périffent. Ce font particulièrement
les poulets & les oifeaux nés dans l’ar-
rière-faifon , qui , au lieu de muer en oélobrë,
ne muent qu’à la fin de novembre ou en décembre
; à proportion , au contraire , que les
poulets font nés plutôt, qu’ils muent dans une
faifon où la chaleur eft plus forte , leur mue eft
plus prompte & les fatigue moins. Il eft évident,
d’après cette obfervation , que la chaleur eft bonne
pour les oifeaux qui muent, &. qu’au contraire
le froid leur eft préjudiciable. Il convient donc ,
lorfque lès poules ou les poulets font en mue ,
de ne les pas laiffer fortir le mâtin d’auili bonne-
heure que dans les autres temps ; de les faire
rentrer le foir plutôt , pour ne les pas çxpofer
au frais du matin & du foir ; de les enfermer
dans un-lieu chaud , fi ils font malades , &. de
foutenir intérieurement leurs forces dans un temps
où la nature fait en eux beaucoup de dépenfe ,
par un régime nourriffant & en même - temps
propre à échauffer. Ainfi, le farrafin, le chenevis ,
la mie de pain trempée devin, l’eau dans laquelle
on a fait fondre du fucre donnée pour boiffon ,
font dans le temps de la mue, des moyens qu’on
doit employer, fuivant qu’ils paroâffent néceffaires
& qu’ils font indiqués parle temps où elle a lieu,
la manière dont fe comporte ]a faifon & l’état
des poules & des poulets.
Quelque foit la longueur de l’article que je viens
de traiter, il ne renferme pas tout ce qu’on peut
dire lùr l’hiftoire du coq &. de la poule. Je nrai
point parlé de l’habitude qu’on fait contra&er à
certains coqs de combattre les uns contre les autres,
les ergots armés d’un éperon qui en rend les coups
plus sûrs , plus pénétrans & plus dangereux ; dù
cas qu’on fait de ce genre de fpe&acle en Angleterre
, aux Indes, à la Chine : cet abus d’un animal
utile ne méritoit pas de fixer notre attention."
Je n’ai pas fait mention non plus de l’opération
par le moyen de laquelle on fait du jeune coq un
chapon , de la jeune poule une poularde , d'u
régime & des pratiques qu’on emploie pour rendre
la chair de ces animaux plus délicate, leur faire
prendre plus de graiffe ; des moyens de conferver
les oeufs long-temps fans qu’ils ceffent d’être auffi
| bons &. auffi délicats que fi ils étoiem frais; enfin ,
'd’en faire éclorre une grande quantité ; d’élever
les poulets qui en proviennent, fans le fecours
des poules. De ces différens objets , les premiers
appartiennent uniquement à l’oeconomie ruftique ;
& le dernier, qui eft auffi de fon reffort, eft un
art qui demande un traité à part. Les différentes
parties dont l'oeuf eft compolé , &- dont j’ai dit
quelque chofe dans les difcours généraux , le
développement & l’accroiffement de l’embrion
dans l'oeuf, font des fujets d’anatomie comparée ,
&. j’en dis quelque chofe au mot oeuf. V. <Euf.
Si, malgré les reftriétions dont je viens de parler,
j’ai peut-etre excédé les limites, j’ai cru qu’on
me le permettroit en faveur de l’oifeau le plus
utile , de celui dont l’hiftoire eft la moins ignorée
&. fournit plus de faits dignes d’être connus. -
C oq d’Angleterre. Voye^ coq.
C oq de Bantam. Voye^ C oq.
C oq de bois par les Créoles. Voyei COQ de
Roche.
C oq de bois. Voyeç T étras.
C oq de bouleau. Voyeç T étras (petit). /
C oq de bruyère (grand). Voye£ T étras.
C oq de bruyère à fraife. Voye^ GÉEinotTe
( groffe ) de Canada.
C oq de bruyère à queue fourchue. Vt>ye^ T étras
(petit).
C oq de bruyère piqueté. Briss. tom. I»pag.
/<?/. Voye^ Racklan.
C oq de Caux. Voye% C oq.
C oq de Hambourg. Voye£ C oq.
.Coq de Madagafcar. Voye^ C oq.
C oq de mér.: Voye^ C anard à longue-queue.
C oq de Padoue. Voyeç C oq.
C oq de Perfe. Voyeç C oq.
C oq de roche.
B riss. tom. IV,pag. 457.
PI. enl. 39, le mâle, 747 la femelle..
Coq de roche\ coq de bois par les Prançois qui
habitent à la Guiane.
Le coq de roche n’eft pas moins remarquable .par
la forme que par la beauté de fon plumage. Il a
le bec des gallinacés 5 des pieds petits., courts &
pour ainfi-dire à demi formés, des manakins ,xles
todiers, des martins-pêcheurs , du momot , :&c.
tous oifeaux avec lefquels il n’a d’ailleurs aucun
rapport ni par la forme, ni par les habitudes. ;
fes yeux font entourés d’un demi-cercle de plumes
déeoîhpofées, comme ceux des oifeaux de huit
le font d’un cercle entier, il a plufieurs des
habitudes de-ces oifeaux ; mais1 les plumes les
plus excentriques s’élèvent beaucoup au-defîù« de
la tête & forment-'une huppe à double plan ,
incliné l’un vers l’autre, arrondie en de'mi-cerde ,
compoféè fur un modèle dont on né retrouve
d’exemple que dans un oifeau d ’eau de l’Araéri*-
que feptentridnàle le harle huppé de la Caroline.
Les plumes -qui recouvrent la queue en *- deffus
font fort longues ,' paroiffent à : leur extrémité
comme coupées quarfément -, & leurs, barbes ,
vers le bout , font très-prolongées, à demi défunies
& réfléchies vers les côtés ; enfin la première
plume de l’aile eft plus courte que les autres ,
& fes barbes, du côté intérieur, deviennent très-
courtes tout-à-coup , comme dans certains oifeaux;
de . proie ; ainfi le coq de roche fe rapproche par
des traits ifolés , mais bien fenfibles , de plufieurs
oifeaux avec lefquels il. n’a point d’autre reffem-
blance , & dont il eft très-éloigné fous tous les
aufrés afpects ;. il tient à beaucoup de genres fort
différens ; mais par un trait feul, & par cela même
il eft d’un genre à part, dont le caractère , peut-être
unique, eft la forme quarrée de l’extrémité des
couvertures de la queue & le prolongement de
leurs barbes. Il femble que la nature fe foit plu à
le compofer de traits empruntés, d’autres oifeaux ,
difparates à nos yeux,. & raffemblés.'cependant
de manière à lui donner une forme élégante ,
qu’elle a encore relevée par laficheffejidu coloris.
; Le coq de roche eft de la groffeur d’un poulet
de trois mois; il a l’extérieur d’un jeune coq ; ôc
e’eft fans doute à cette reffemblance qu’il doit 1®
nom de coq, que les François de la Guiane lui
ont donné. Le fond de fon plumage eft uiiecou-
leur orangée très-vive. I l‘.y,a quelques traits blancs
au pli &. fur le milieu de l’aile ; les' pennes en
font brunes , terminées de jaune-clair , & bordées
extérieurement de la même couleur ; celles de la
queue font d’un brun-foncé, & terminées du même
jaune que les. plumes des ailes ; le Haut de la huppe
eft entouré par un trait ou demi-cercle brun , fur-
monté d’un autre demi-cercle d’un jaune-clair qui
termine le couronnement de la_tete ;> le b e c, les
pieds & les ongles.font d’un blanc teint de jaunâtre*
. La femelle eft beaùcoup plüs. petite que le mâle ;
elle eft entièrement d’un . brun-tirant fur l’olive-!
foncé ; fa huppe eft très-petite ; fon bec eft brun 3
avec un trait longitudinal jaune fur le milieu de
fa partie convexe. Les jeunes mâles font auffi
bruns , mais d’ùn brun plus, clair que les femelles ,
ôl ils font variés de taches couleur orangée , plus
ou moins grandes & plus ou moins nombreulès ,
plus claires ou plus foncées. Il paroît que ce n’eft
qu’avec l’âge que les mâles acquièrent un plumage
orangé fans mélange de brun,.& que la nuance
en devient d’autant plus vive , qu’ils ont plus
d’années..
On ne . trouve; à la Guiane les coqs de roche
qu’aux environs du poftè qu’on nommé Oyapoc :
ils fe retirent en grand noînbre dans les, fentes &
les cavernes des rochers ;,ils ^volent aux environs
pendant le jour, mais fans s’écarter. Leur vol eft
bas, court & rapide : ils font très-1 farouches, fort
vifs & très - méfiàns.- On ne peut les'tirer qu’en
les furprenant & les attendant à l’affût au fortir de
leurs cavernes , d’où ils fortent, où- ils rentrent,
& qu’ils fréquentent de jour , comme ils s’y re-
,.tirent la nuit.-Les femelles en fortent moins fréquemment,
que les mâles, pendant le jour ; elles
y font leur'„nid 9 pour la conftruéfion duquel elle«