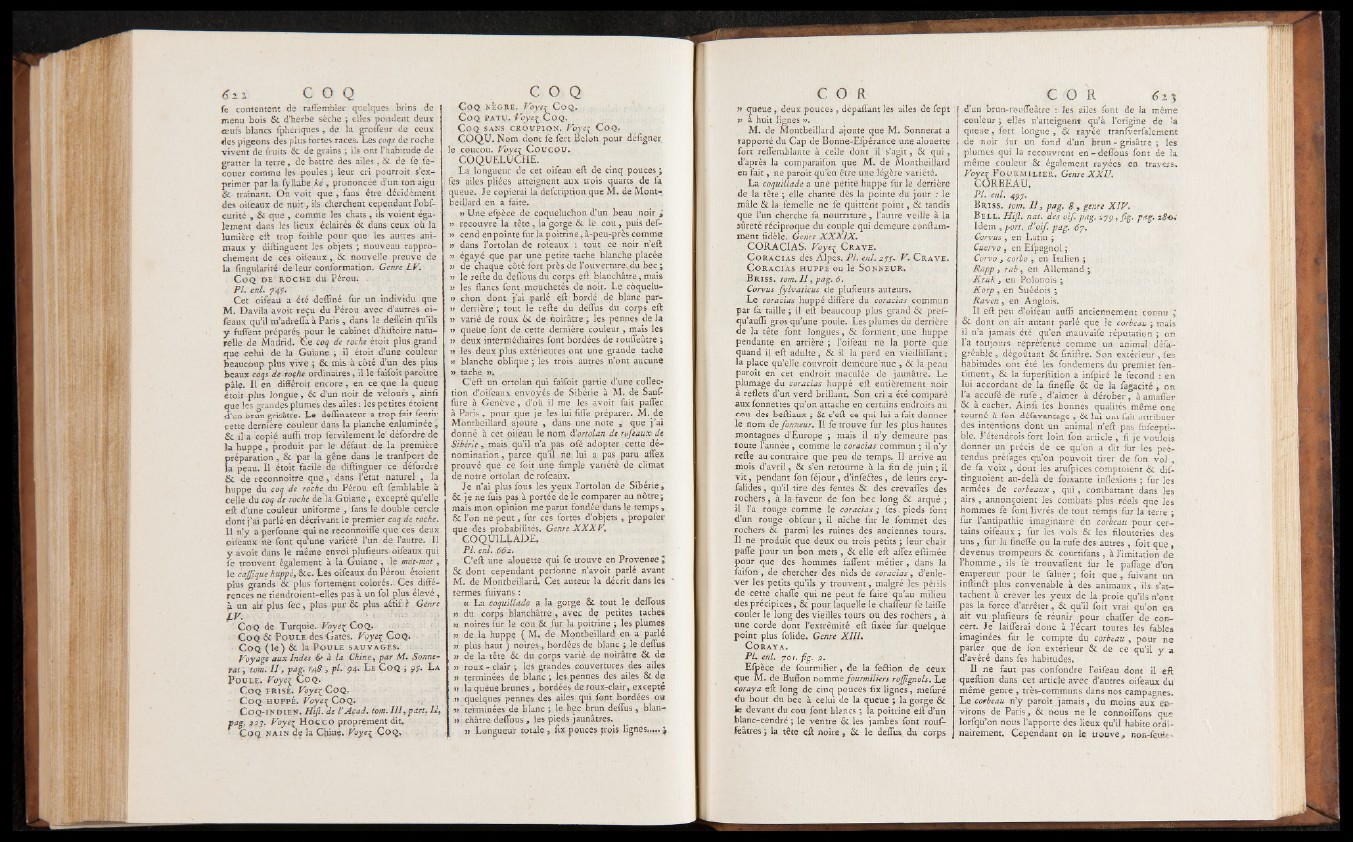
jfe contentent de raffembler quelques brins de
menu bois & d’herbè sèche ; elles pondent deux
oeufs blancs fphériques , de la groifeur de ceux
des pigeons des plus fortes races. Les coqs de roche
vivent de fruits & de grains ; ils ont l’habitude de
gratter la terre, de battre des ailes , Ôc de fe fe-
couer comme les poules ; leur cri pourrait s’exprimer
par la fy llabe ké, prononcée d’un ton aigu
& traînant. On voit que, fans être décidément
des oifeaux de npit-v ils cherchent cependant l’obf-
curité -, & que , comme les chats, ils voient également
dans les lieux éclairés ôc dans ceux oh la
lumière eft trop foible pour que' les autres animaux
y diftinguent les objets ; nouveau rappro-^
chement de ces oifeaux, ôc nouvelle preuve de
la fingularité de1 leur conformation. Genre LV.
C o q d e r o c h e dû Pérou. -
PL enl. •• -r" ■ < . . .
Cet oifeaü a été deflîné fur un individu que
M. Davila avoit reçu du Pérou avec d’autres oifeaux
qu’il m’adreffa à Paris , dans le deffein qu’ils
y fuffent préparéspour le cabinet d’hiftoire naturelle
de Madrid. Ce coq de roche étoit plus grand
que celui de la Guiane ; il étoit d’une couleur
beaucoup plus vive ; Ôc mis à côté d’un des plus
beaux coqs de roçhe ordinaires, il le faifoit paroître
pâle. Il en différoit entcore, en ce que la queue
étoit plus longue, ÔC d’un noir de velours , ainfi
que les grandes plumes des ailes: les petites étoient
d’un brun grisâtre. Le deflinatepr a trop fait fentir
cette dernière couleur dans la planche enluminée ',
& il a copié auiîi trop férvilement le* défordre de
la huppe , produit par le défaut de la première
préparation, Ôc par la gêne dans le tranfport de
fa pçau. Il étoit facile de diftinguer ce défordre
& de reçonnoitre quë-, dans l’état naturel , la
fiuppe du coq de roche du Pérou eft femblable à
celle du coq de roche de la Guiane, excepté qu’elle
eft d’une couleur uniforme , fans le double cercle
dont j’ai parlé en décrivant le premier coq de roche.
Il n’y a perfonne qui ne reconnoifle que ces deux
pifeaux ne font qu’une variété l’un de l’autre. Il
y avoit dans le même envoi plufieurs. oifeaux qui
le trouvent également à la Guiane , -le mot-mot,
le cajjique huppé, Les oifeaux du Pérou, étoient
plus grands ôc plus fortement colorés.- Ces différences
ne tiendroient-elles pas à un fol plus élevé,
à un air plus fec, plus -pur &. plus a&if. | Genre
i v . ■
C o q de Turquie. Voyez C o q .
C o q ôc P o u l e des Gates. V o y e z C o q .
C o q ( le ) & la P o u l e s a u v a g e s .
Voyage aux Indes & à la Chine, par M. Sonne-
rat, tom. I l i pag. T48 3 p\. 94 M C oq ; p/. La
Poule. Voyez C oq.
C o q f r i s é . Voyez C o q .
C o q h u p p é . Voyez C o q ;
C o q -i n d i e n . Hift. de l’Acad. tom. 111, part. Il,
j>agf 223. Voyez H o ç ç o proprement dit. ;
C O Q n a i n d e la C h in e . V o y e z C o q *
C o q n è g r e . Voyez C o q ,
C o q p a t u . Voyez C o q ,
C o q sans c r o u p i o n . Voyez C o q .
COQU, Nom dont fe fert Beloïi pour défigner
le coucou. Voyez C o u co u .
COQUELUCHE.
La longueur de cet oifeau eft de cinq pouces ;
les ailes pliées atteignent aux trois quarts de la
queue. Je copierai la delcription que M. de Montbeillard.
en a faite,
» Une efpèce de coqueluchon d’un beau noir i
» recouvre la tête, la gorge & lè cou, puis défi-
» cend en pointe fur la poitrine, à-peu-près comme
» dans l’ortolan de rofeaux : tout ce noir n’eft
» égayé que par une petite tache blanche placée
» de chaque côté fort près de l’ouverture^du bec ;
» le refte du deflous du corps eft blanchâtre, mais
» les flancs font mouchetés de noir. Le côquelu-
» chpn dont j’ai parlé eft bordé de blanc par*
» derrière ; fout le refte du deffus du cçrps eft
» varié de roux~ôc de noirâtre ; les pennes de la
» queue font de cette dernière couleur, mais les
» deux intermédiaires font bordées de rouffeâtre ;
» les deux plus extérieures ont une grande tache
» blanche oblique ; les trois autres n’ont aucune
» tache ».
C’èft un ortolan qui faifoit partie d’une collection
d’oifeaux envoyés de Sibérie à M. de Sauf-
Aire à Genève, d’où il me les avoit fait paffer
à Paris , pour que je les lui fiffe préparer. M. de
Montbeillard ajoute , dans une note , que j’ai
donné à cet. pifeau le nom d’ortolan de rofeaux> de
Sibérie 9 mais qu’il n’a pas ofé adopter cette dénomination,
parce qu’il ne lui a pas paru affez
prouvé que ce foit une fimple variété de climat
de notre ortolan de rofeaux.
Je n’ai plus fous les yeux l’ortolan de Sibérie*
& je ne fuis pas à portée de le comparer au nôtre;
mais mon opinion me parut fbndée dans le temps >
& l’on né peut, fur ces fortes d’objets , propofer
que des probabilités. Genre XXXV,
ÇOQUILLADE,
PL enl. .662.
C’eft une alouette qui fe trouve en Provence l
ôc dont cependant perfonne n’avoit parlé avant
M. de Montbeillard. Cet auteur la décrit dans les.
termes fuivans :
« La çoquillade a la gorge & tout le deflous
» du corps blanchâtre., avec de petites taches
» noires fur le cpu & fur la poitrine ; les plumes
» de, la huppe ( M, de Montbeillard en a parlé
» plus haut ) noires.tj bordées de blanc ; le deflus
» de la tête ôc du corps varié dç noirâtre ÔC de
» roux - clair ; les grandes couvertures des ailes
» terminées de blanç ; les. pennes dfs ailes & de
» la queue brunes, bordées de rpux-clair, excepté
.». quelques pennes des ailes qui font bordées ou
n terminées de blanc ; le bçc brun deffus, blan-
bi,châtre. deflous , les pieds jaunâtres.
» Longueur totale , fix pouces jrois lignes,..,, $
» queue, deux pouces, dépaffant les ailes de fept
v à huit lignes ».
M. de Montbeillard ajoute que M. Sonnerat a
rapporté du Cap de Bonne-Efpérance une alouette
fort reffemblante à celle dont il s’agit, ôc qui,
d’après la comparaifon que M. de Montbeillard
en fait, ne paroît qu’en être une légère variété.
La çoquillade a une petite huppe fur le derrière
de la tête ; elle chante dès la pointe du jour : .le
mâle & la femelle ne fe quittent point, Ôc tandis
que l’un cherche fa nourriture , l’autre veille à la
sûreté réciproque du couple qui demeure conftam-
ment fidèle. Genre XXXIX.
CORACIAS. Voyez Crave.
C o r a c i a s des A lp e s . PL enl. 25$. V. C r a v e .
C o r a c i a s h u p p é o u le S o n n e u r .
B r i s s . tom. I I , pag. 6.
Corvus fylvaticus d e plu fieu r s au teurs .
Le coracias huppé diffère du coracias commun
par fa taille ; il eft beaucoup plus grand ôc prefi-
qu’aufli gros qu’une poule. Les plumes du derrière
de la tête font longues, ôc forment. une huppe
pendante en arrière ; l’oifeau ne la porte que
quand il eft adulte, & il la perd en vieilliffant :
la place qu’elle couvroit demeure'nue , & la peau
paroît en cet endroit maculée de jaunâtre. Le
plumage du coracias huppé eft entièrement noir
à reflets d’un verd brillant. Son cri a été comparé
aux fonnettes qu’on attache en certains endroits au
cou des beftiaux ; ôc c’eft ce qui lui a fait donner
le nom de fonneur. Il fe trouve fur les plus hautes
montagnes d’Europe ; mais il n’y demeure pas
toute l’année , comme le coracias commun ; il n’y
refte au contraire que peu de temps. Il arrive au
mois d’avril, ôc s’en retourne à la fin de juin ; il
v it, pendant fon féjour, d’infe&es, de leurs cry-
falides, qu’il tire des fentes & des crevaffes des
rochers, à la faveur de fon bec long ôc arqué ;
il l’a rouge comme le coracias ; fes. pieds font
d’un rouge obfcur ; il niche fur le fommet des
rochers oc parmi les ruines des anciennes tours.
Il ne produit que deux ou trois petits ; leur chair
paffe pour un bon mets, ôc elle eft affez eftimée
pour que des hommes faffent métier, dans la
faifon, de chercher des nids de coracias, d’enlever
les petits qu’ils y trouvent, malgré les péiils
de cette chaffe qui ne peut 1e faire qu’au milieu
des précipices, ôc pour laquelle le chaffeur fe laiffe
couler le long des vieilles tours ou des rochers , à
une corde dont l’extrémité eft fixée fur quelque
point plus folide. Genre X lll.
C o r a y a .
PL enl. yoi.fig. 2.
Efpèce de fourmilier, de la feélion de ceux
que M. de Buffon nomme fourmiliers rojjignols. Le
coraya eft long de cinq pouces fix lignes, mefuré
du bout du bec à celui de la queue ; la gorge &
le devant du cou font blancs ; la poitrine eft d’un
blanc-cendré ; le ventre &. les jambes font rouf-
feâtres ; la tête eft noire 9 & le deffus. du corps
d’un brun-rouffeâtre : les ailes font de la même
couleur ; elles n’atteignent qu’à l’origine de la
queue, fort longue , & rayée tranfverfalement
de noir fur un fond d’un brun - grisâtre ; les
plumes qui la recouvrent en-deffous font de la.
même couleur ôc également rayées en travers»
Voyez Fo u R M i l IE R. Genre XXIJ.
CORBEAU.
PL enL 4pf.
B r i s s . tom. I l , pag. 8 , genre XIV.
B e l l . Hijl. nat. des oif. pag. 27$, fig. pdg* 280*
Idem , port, d’oif pag. 67.
Corvus , en Latin ;
Cuervo , en Efpagnol ;
Corvo , corbo , en Italien ;
Rapp, rab, en Allemand;
Kruk 3 en Polonois ;
Korp , en Suédois ;
Raven, en Anglois.
Il eft peu d’oifeau aufli anciennement connu 3
& dont on ait autant parlé que. le corbeau ; mais
il n’a jamais été qu’en mauvaife réputation ; on
l’a toujours représenté comme un animal défa-
gréable , dégoûtant ôc finiftre. Son ’extérieur , fes
habitudes ont été les fondemens du premier fen~
riment, ôc la fuperftirion a infpiré le fécond : en
lui accordant de la fineffe Ôc de la fagacité , on
l’a accufé dfe rufe, d’aimer à dérober, à amaffer
ÔC à cacher. Ainfi fes . bonnes qualités même ont
tourné à fon défavantage , ôc lui ont fait attribuer
des intentions dont un animal n’eft pas fufcepti-
ble. J’étendrois fort loin fon article , fi je vouJois
donner un précis de ce qu’on a dit fur les prér
tendus prélàges qu’on pouvoit tirer de fon vol ,
de fa voix , dont les arufpices comptoient ôc dif-
tinguoient au-delà de foixante inflexions ; fur les
armées dé corbeaux , qui, combattant dans les
airs , annonçoient les combats plus réels que les
hommes fe font livrés de tout temps fur la terre ;
fur l’antipathie imaginaire du corbeau pour certains
oifeaux ; fur les vols ôc les filouteries des
uns , fur la fineffe ou la rufe des autres , foit que,
devenus trompeurs ôc courtifans , à l’imitation de
l’homme, ils fe trouvaffent fur le paffage d’un
empereur pour le faluer ; foit que , fuivant un
inftinâ plus convenable à des animaux, ils s’attachent
à crever les yeux de la proie qu’ils n’ont
pas la force d’arrêter, ôc qu’il foit vrai qu’on en
ait vu plufieurs fe réunir pour chaffer de concert.
Je laifferai donc à l’écart toutes les fables
imaginées fur le compte du corbeau , pour ne
parler^que de fon extérieur ôc de ce qu’il y a
d’avéré dans fes habitudes.
Il ne faut pas confondre l’oifeau dont il eft
queftion dans cet article avec d’autres oifeaux du
même genre , très-communs dans nos campagnes.
Le corbeau n’y paroît „jamais, du moins aux environs
de Paris, ôc nous ne le connoiffons que
lorfqu’on nous l’apporte des lieux qu’il habite ordinairement.
Cependant on le trouve., non-feuâe