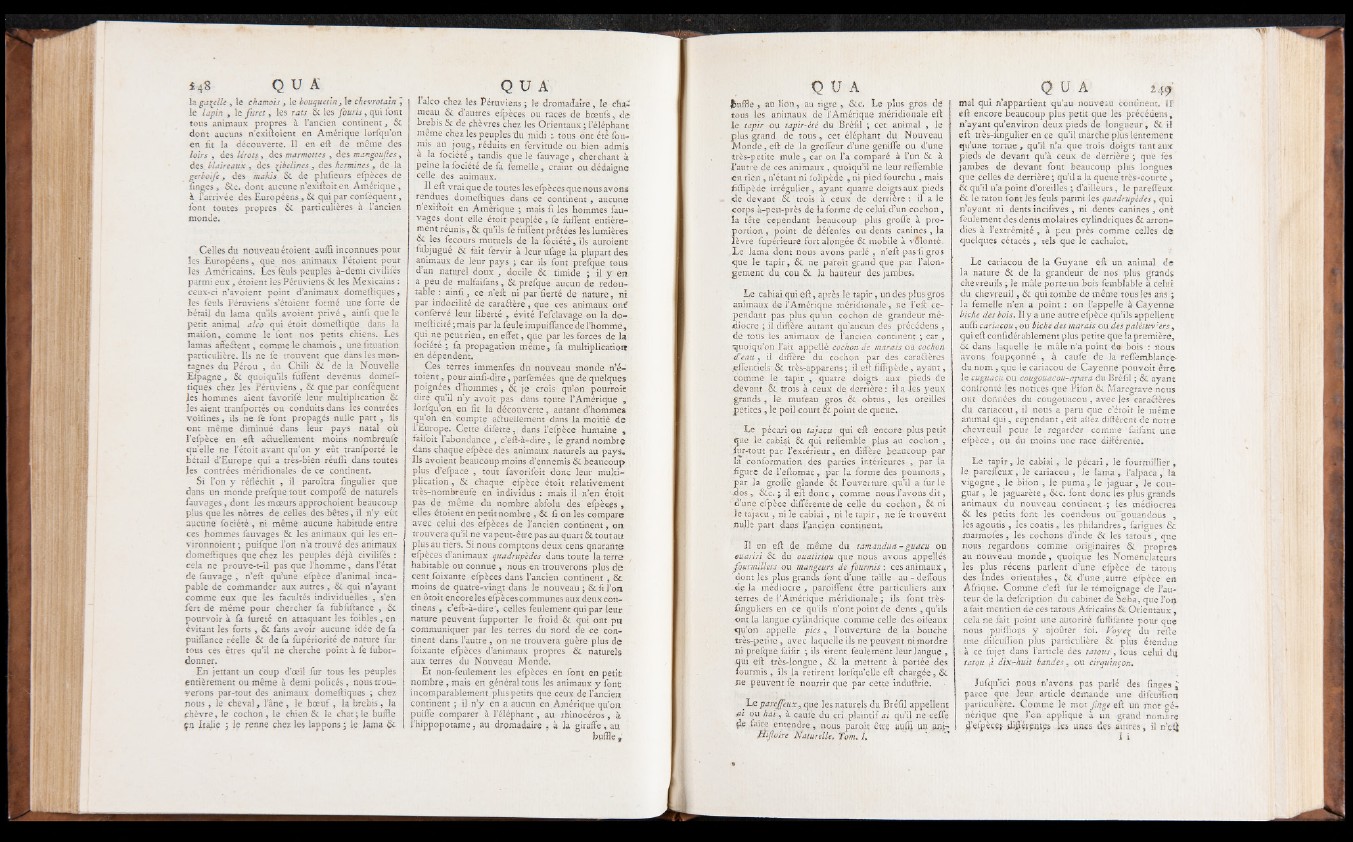
la gabelle, le chamois 3 le bouquetin 3 le chevrotait!
le lapin 3 le furet, les rats ôc les fouris, qui font
tous animaux propres à l’ancien continent , ôc
dont aucuns n exiftoient en Amérique lorfqu’on
en fit la découverte. Il en eft de même des
loirs , des lérots, des marmottes , des mangouf.es,
des.blaireaux , des gibelines 3 des hermines 3 de la
gerboife 3 des makis ÔC de plufieurs efpèces de
linges , ôcc. dont aucune n’exiftoit en Amérique ,
à l’arrivée des Européens, ôc qui par conléquent,
font toutes propres & particulières à l’ancien
inonde.
Celles du nouveau étoient auffi inconnues pour
les Européens, que nos animaux l’étoient pour
les Américains. Les feuls peuples à-demi civilifés
parmi eux 3 étoient les Péruviens & les Mexicains
ceux-ci n’avoient point d’animaux domeftiques,
les feuls Péruviens s’étoient formé une forte de
bétail du lama qu’ils avoient privé, ainfi que le
petit animal alco qui étoit domeftiqûe dans la
maifon, comme le font nos petits chiens. Les
lamas affe ôtent, comme le chamois , une fituation
particulière. Ils ne fe trouvent que dans les montagnes
du Pérou , du Chili ôc de la Nouvelle
Elpagne 3 ôc quoiqu’ils fuffent devenus domeftiques
chez les Péruviens , & que par conféquent
les hommes aient favorifé leur multiplication &
les aient tranfportés ou conduits dans les contrées
voifines, ils ne fe font propagés nulle part , ils
ont même diminué dans leur pays natal où
î’efpèce en eft actuellement moins nombreufe
qu’elle ne l’étoit avant qu’on y eût tranfporté le
bétail d’Europe qui a très-bien réufli dans toutes
les contrées méridionales de ce continent.
Si l’on y réfléchit , il paroîtra fingulier que
dans un monde prefque tout compofé de naturels
fauvages , dont les moeurs approchoient beaucoup
plus que les nôtres de celles des bêtes, il n’y eût
aucune fociété, ni même aucune habitude entre
ces hommes fauvages & les animaux qui les en-
vironnoient ; puifque l’on n’a trouvé des animaux
domeftiques que chez les peuples déjà civilifés :
cela ne prouve-t-il pas que l’homme, dans l’état
de fauvage , n’eft qu’une efpèce d’animal incapable
de commander aux autres, & qui n’ayant
comme eux que les facultés individuelles , s’en
fert de même pour chercher fa fubfiftance , &
pourvoir à fa fureté en attaquant les foibles, en
évitant les forts , & fans avoir aucune idée de fa ■
puiflance réelle ôc de fa fupériorité de nature fur
tous ces êtres qu’il ne cherche point à fe fubor-
d.onner.
En jettant un coup d’oeil fur tous les peuples
entièrement ou même à demi policés , nous trouverons
par-tout des animaux domeftiques ; chez
nous , le cheval l’âne , le boeuf , la brebis, la
chèvre, le cochon , le chien ôc le chat ; le buffle
f n Italie ; le renne chez les lappons ; le lama ôc
1 alco chez les Péruviens ; le dromadaire, le chameau
ôc d’autres efpèces ou races de boeufs, de
brebis ôc de chèvres chez les Orientaux ; l’éléphant
meme chez les peuples du midi tous ont été fournis
au joug, réduits en fervitude ou bien admis
a la fociété , tandis que le fauvage, cherchant à
peine la fociete de fà femelle, craint ou .dédaigne
celle des animaux.
Il eft vrai que de toutes les efpèces que nous avons
rendues domeftiques dans ce continent , aucune
n exiftoit en Amérique ; mais fi les hommes fauvages
dont elle étoit peuplée , fe fuflent entièrement
reunis, ôc qu’ils fe fuflent prêtées les lumières
& les fe cours mutuels de la fociété , ils auroient
fubjugué & fait fervir à leur ufage la plupart des
animaux de leur pays ; car ils font prefque tous
d’un naturel doux , docile & timide ; il y en
a peu de malfaifans, ôc prefque aucun de redoutable
: ainfi, ce n’eft ni par fierté de nature, ni
par indocilité de caraétère, que ces animaux ont'
confervé leur liberté , évité l’efclavage ou la do-
mefticité ; mais par la feule impuiflance de l’hommé,
qui ne peut rien, en effet, que par les forces de la
fociété ; fa propagation même, fa multiplication
en dépendent.
Ces terres immenfes du nouveau monde n’é-
toient, pour ainfi-dire, parfemées que de quelques
poignées d’hommes , ôc je crois qu’on pourroit
dire qu’il n’y avoit pas dans tçute l’Amérique |
lorfqu’ot^ en fit la découverte, autant d’hommes
qu’on en compte aétuellement dans la moitié de
l’Europe. Cette difétte, dans Tefpècë humaine ,
faifoit l’abondance , c’eft-à-dire, le grand nombre
dans chaque efpèce des animaux naturels au pays.
Ils avoient beaucoup moins d’ennemis & beaucoup
plus d’efpace , tout favorifoit donc leur multiplication
, ôc chaque efpèce étoit relativement
tres-nombreufe en individus : mais il n’en étoit
pas de même du nombre abfolu des efpècgs,
elles étoient en petit nombre , & fi on les compare
avec celui des efpèces de l’ancien continent, on
trouvera qu’il ne va peut-être pas au quart & tout au
plus au tiers. Si nous comptons deux cens qnarante
efpèces d’animaux quadrupèdes dans toute la terre
habitable ou connue , nous en trouverons plus de
cent .foixante efpèces dans l’ancien continent , ÔC
moins de quatre-vingt dans le nouveau ; & fi l’on
en ôtoit encore les efpèces communes aux deux confinons
, c’eft-à-dire', celles feulement qui par leur,
nature peuvent fupporter le froid & qui ont pu
communiquer par les terres du nord de ce continent
dans l’autre , on ne trouvera guère plus de
foixante efpèces d’animaux propres ôc naturels
aux terres du Nouveau Monde.
Et non-feulement les efpèces en font en petit
nombre , mais en général tous les animaux y font
incomparablement plus petits que ceux de l’ancien
continent ; il n’y en a aucun en Amérique qu’on
puifle comparer à l’éléphant, au rhinocéros , à
l’hippopotame, au dromadaire , à la giraffe, au buffle |
fjuffle, aü lion, au tigre , ôcc. Le plus gros dé
tous les animaux de l’Amérique méridionale eft
le tapir ou tapir-été du Bréfil ; cet animal , le
plus grand de tous , cet éléphant du Nouveau
Monde , eft de la grofleur d’une geniffe ou d’une
très-petite mule, car on l’a comparé à l’un & à
l’autre de ces animaux , quoiqu’il ne leur reffemble
en rien , n’étant ni folipède , ni pied fourchu , mais
fiflïpède irrégulier, ayant quatre doigts aux pieds
de devant oc trois à ceux de derrière ; il a le
corps à-peu-près de la forme de celui d’un cochon,
la tête cependant beaucoup plus grofle à proportion
, point de défe.nles ou dents canines , la
lèvre fupérieure fort alongée Ôc mobile à volonté.
..Le lama dont nous avons parlé , n’eft pas iï gros
que le tapir, & ne paroît grand que par l’alon-
gement du cou ôc la hauteur des jambes.
Le cabiai qui eft, après le tapir, un des plus gros
animaux de l’Amérique méridionale, ne l’eû cependant
pas plus qu’un cochon de grandeur médiocre
; il diffère autant qu’aucun des précédens ,
de tous les animaux de l’ancien continent ; car
quoiqu’on l’ait appellé cochon de marais où cochon
tfeau, il diffère du cochon par des caraôlères
.eflentiels ÔC très-apparens ; il eft fiflïpède, ayant,
comme le tapir , quatre doigts aux pieds de
devant ôc trois à ceux de derrière : il a -les yeux
grands , le mufeau gros ôc obtus, les oreilles
petites , le poil court ôc point de queue.
Le pécari ou tajacu qui eft encore plus petit
que le cabiai ôc qui reffemble plus au cochon ,
fur-tout par l’extérieur, en diffère beaucoup par
la conformation des parties intérieures , par la
figure de l’eftomac, par la forme des poumons,
par la grofle glande ôc l’ouverture, qu’il a fur le
dos , ÔCc. ; il eft donc , comme nous l’avons dit,
d’une efpèce différente de celle du cochon , ôc ni
le tajacu , ni le cabiai, ni le tapir, ne fe trouvent
nulle part dans l’un ci en confinent.
Il en eft de même du tamandua- guacu ou
euariri ôc du ouatiriou que nous avons appelles
fourmiliers ou mangeurs de fourmis : ces animaux,
dont les plus grands font d’une taille au - deflous
de la médiocre , par biffent être particuliers aux
terres de l’Amérique méridionale.; ils font très-
finguliers en ce qu’ils n’ont point de dents , qu’ils
ont la langue cylindrique comme celle des oifeaux
qu’on appelle pics, l’ouverture de la bouche
très-petite, avec laquelle ils ne peuvent ni mordre
ni prefquè faifir ; ils firent feulement leur langue ,
qui eft très-longue, ôç la mettent à portée des
fourmis , ils la retirent lorfqu’elle eft chargée, ôc
ne peuvent fe nourrir que par cette induftrie.
Le parejfeux? que les naturçls du Bréfil appellent
fii ou hài, à caufie du cri plaintif ai qu’il ne celle
fte faire ^entendre , nous paroît être aufij un janj-
Hifoire Naturelle. Tarn. 7,
mal qui n’appartient qu’au nouveau continent. If
eft encore beaucoup plus petit que les précédens,
n’ayant qu’environ deux pieds de longueur, ôc il
eft très-fingulier en ce qu’il marche plus lentement
qu’une tortue 3 qu’il a’a que trois doigts'tant aux
pieds de devant qu’à ceux de derrière ; que fes
jambes de devant font beaucoup plus longues
que celles de derrière ; qu’il a la queue très-courte,
ôc qu’il n’a point d’oreilles ; d’ailleurs, le pareffeux
ôc le tatou font les feuls parmi les quadrupèdes, qui
n’ayant ni dents incifiyes , ni dents canines 3 ont
feulement des dents molaires cylindriques ôc arrondies
à l’extrémité, à peu près comme celles de
quelques cétacés, tels que le cachalot.
Le cariacou de la Guyane eft un animal de
la nature ôc de la grandeur de nos plus grands
chevreuils ; le mâle porte un bois femblable a celui
du chevreuil, ôc qui tombe de même tous les ans ;
la femelle n’en a point : on l’appelle à Cayenne
biche des bois. Il y a une autre efpèce qu’ils appellent
au fli cariacou, ou biche des marais ou des palétuviers ,
qui eft confidérablement plus petite que la première,
ôc dans laquelle le mâle n’a point de bois : nous
avons foupçonné , à caufe de la reflemblance-
du nom , que le cariacou de Cayenne pouvoit être
le cuguacu ou cougouacou-apara du Bréfil ; ÔC ayant
confronté les notices que Pilon ôc Marcgrave nous
ont données du cougouacou , avec les caractères
du cariacou, il nous a paru que c’étoit le même
animal qui, cependant, eft aflez différent de notre
chevreuil pour le regarder comme faifant une
efpèce, ou du moins une race différente.
Le tapir, le cabiai, le pécari, le fourmillier,
le parefteux , lè cariacou , le lama , l’alpaca, la
vigogne, le bifon , le puma, le jaguar, le couguar
, le jaguarète, ôcc. font donc lés plus grands
animaux du nouveau continent-5 les médiocres
ôc les petits font les coendous ou"*gouandous ,
les agoutis , les coatis , les philandres, farigues ôc
marjnpfes, les cochons d’inde ôc les tatous ., que
nous regardons comme originaires ôc propres
au nouveau monde, quoique les Nomenclateurs
les plus récens parlent d’iine efpèce de tatous
des Indes orientales, ôc d’une, autre efpèce en
Afrique. Comme .c’eft furie témoignage de fauteur
de la defcription du cabinet de Seba, que l’otji
a fait mention de ces tatous Africains ôc Orientaux,
cela ne fait point une autorité fuffifante pour que
nous puiffiops y ajoûter foi. Voyeç du refte
une .difcuflion plus particulière ôc plus étendue
à ce fujçt dans l’article des tatous, tous celui dq
tatou u dixr-huit bandes,. ou cirquinçon.
Jufqu’ici nous n’avons pas parlé des finges a'
parce que leur article demande une difcuflion
particulière. Comme le mot Jinge eft un mot gé*
nérique que l’on applique à un grand nombre
4’efpèceg diftireutes les unes des .autres, il n’eft
I i