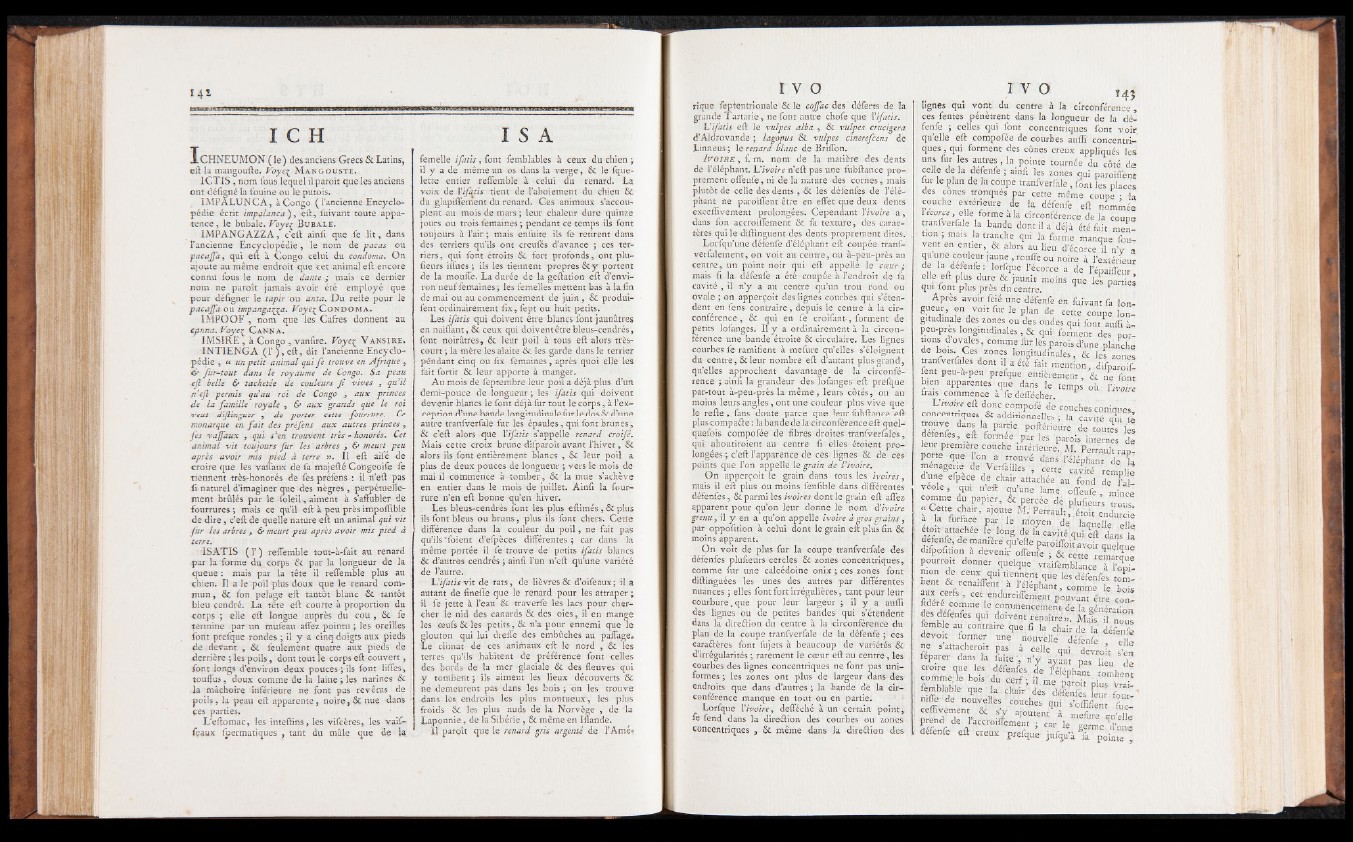
eaREiufSH BHmffy-VTMtn1 '« ru
I C H
IcHNEUMON (le ) des anciens Grecs & Latins,
eft la mangoufte. Voye^ M a n g o u s t e . 1CTIS , nom fous lequel il paroît que les anciens
ont défxgné la fouine ou le putois.
IMPALUNCA, à Congo ( l’ancienne Encyclopédie
écrit impolanca ) , eft , fuivant toute appa-
tence, le bubale. Voye%B u b a l e .
IMPANGAZZA, c’eft ainft que fe lit, dans
l’ancienne Encyclopédie, le nom de pacas ou
pacaJJ'a, qui eft à Congo celui du condoma. On
ajoute au même endroit que cet animal eft encore
connu fous le nom de dante ; mais ce dernier
nom ne paroît jamais avoir été employé que
pour défigner le tapir ou anta. Du relie pour le
pacaJJ'a ou impanga^a. Voye%_ C o n d o m a .
IMPOOF , nom que les Cafres donnent au
cpnna. Voyeç C a n n a .
IMSIRE , à Congo , vanftre. Voye£ V a n s ir e .
INTIENGA ( f ) , eft, dit l’ancienne Encyclopédie
, « un petit animal qui fe trouve en Afrique ,
fur-tout dans le royaume de Congo. Sa peau
.efi belle 6* tachetée de couleurs f i vives , quïl
ne fi permis qu’au roi de Congo , aux princes
de la famille royale , 6* aux grands que le roi
veut difiinguer , de porter cette fourrure. Ce
monarque en fait des préfens aux autres princes ,
jes vaffaux 3 qui s'en trouvent très •‘ honorés. Cet
animal vit toujours fur les arbres > & meurt peu
après avoir mis pied à terre ». Il eft âife de
croire que les vaüaux de fa majefté Coiigeoife fe
tiennent très-honorés de fes préfens : il n’eft pas
li naturel d’imaginer que des nègres, perpétuellement
brûlés par le foleil , aiment à s’affubler de
fourrures ; mais ce qu’il eft à peu près impoflible
de dire, c’eft de quelle nature eft un animal qui vit
fur les arbres 3 b meurt peu après avoir mis pied à
terre.
ISATIS ( 1’ ) reffemble tout-à-fait au renard
par la forme du corps 6c par la longueur de la
queue : mais par la tête il reffemble plus au
çhien. Il a le poil plüs doux que le renard commun
, & fon pelage eft tantôt blanc & tantôt
bleu cendré. La tête eft courte à proportion du
corps ; elle eft longue auprès du cou , & fe
termine par un mufeau allez pointu ; les oreilles
font prefque rondes ; il y a cinq doigts aux pieds
de devant , & feulement quatre aux pieds de
derrière ; les poils, dont tout le corps eft couvert,
font-longs d’environ deux pouces ; ils font lilfes ,
touffus, doux comme de la laine ; les narines &
la mâchoire inférieure ne font pas revêtus de
poils, la peau eft apparente, noire, ôt nue dans
ces parties.
L’eftomac, les inteftins, les vifcères, les vaif-
fçaux fpermatiques . tant du mâle que de la
I S A
femelle ifatis, font femblables à ceux du chien ;
il y a de même un os dans la verge, & le fque-
lette entier reffemble à celui du renard. La
voix de Y ifatis tient de l’aboiement du chien 6c
du glapiffement du renard. Ces animaux s’accouplent
au mois de mars ; leur chaleur dure quinze
jours ou trois femaines ; pendant ce temps ils font
toujours à l’air ; mais enfuite ils fe retirent dans
des terriers qu’ils ont creufés d’avance ; ces terriers
, qui font étroits & fort profonds, ont plusieurs
ilfues ; ils les tiennent propres & y portent
de la moufTe. La durée de la geftation eft d’environ
neuf femaines; les femelles mettent bas à la fin
de mai ou au commencement de juin , & produf-
fent ordinairement fix, fept ou huit petits.
Les ifatis qui doivent être blancs font jaunâtres
en naifl’ant, & ceux qui doivent être bleus-cendrés,
font noirâtres, & leur poil à tous eft alors très-
court ; la mère les alaite & les garde dans le terrier
pendant cinq ou fix femaines, après quoi elle les
fait fortir & leur apporte à manger.
Au mois de Septembre leur poil a déjà plus d’un
demi-pouce de longueur ; les ifatis qui doivent
devenir blancs le font déjà fur tout le corps, à l’exception
d’une bande longitudinale fur le dos & d’une
autre tranfverfale fur les épaules, qui font brunes,
& c’eft alors que Y ifatis s’appelle renard croifé.
Mais cette croix brune difparoît avant l’hiver, &
alors ils font entièrement blancs , & leur poil a
plus de deux pouces de longueur ; vers le mois de
mai il commence à tomber , & la mue s’achève
en entier dans le mois de juillet. Ainfi la fourrure
n’en eft bonne qu’en hiver.
Les bleus-cendrés iont les plus eftimés , & plus
ils font bleus ou bruns, plus ils font chers. Cette
différence dans la couleur du poil, ne fait pas
qu’ils ’foient d’efpèces différentes ; car dans la
même pprtée il fe trouve de petits ifatis blancs
& d’autres cendrés ; ainfi l’un n’eft qu’une variété
de l’autre.
L’ifatis vit de rats, de lièvres & d’oifeaux ; il a
autant de finefle que le renard pour les attraper ;
il fe jette à l’eau & traverfe les lacs pour chercher
le nid des canards & des oies, il en mangé
les oeufs & les petits, & n’a pour ennemi que le
glouton qui lui dreffe des embûches au paffage.
Le climat de ces animaux eft • le nord , & les
terres qu’ils habitent de préférence font celles
des- bords de la mer glaciale & des fleuves qui
-y tombent ; ils aiment les lieux découverts ÔC
ne demeurent pas dans les bois; on les trouve
dans les endroits les plus montueux , les plus
froids Sc les plus nuds de là Norvège , de 'la
Laponnie, de la Sibérie , & même en Iflande.
il paroît que le renard gris argenté de l’Amé?
r v o
rique feptentrîonale & le cojfac des déferts de la
grande Tartarie, ne font autre chofe que Y ifatis.
U ifatis eft le vulpes alba , & vulpes crucigera
d’Aldrovande ; lagopus & vulpes cinerefcens de
Linneus ; le renard blanc de Briffon.
Ivoire , f. m. nom de la matière des dents
de l’éléphant. YIivoire n’eft pas une fubftance proprement
offeufe, ni de la nature des cornes, mais
plutôt de celle des dents , & les défenfes de l’éléphant
ne paroiffent être en effet que deux dents
exceflivement prolongées. Cependant Yivoïre a ,
dans fon accroiffement & fa texture, des caractères
qui le diftinguent des dents proprement dites.
Lorfqu’une défenfe d’éléphant eft coupée tranf-
verfalement, on voit au centre, ou à-peu-près au
centre, un point noir qui eft appellé le coeur ;
mais fi la défenfe a été coupée à l’endroit de fa
cavité , il n’y a au centre qu?un trou fond ou
ovale ; on apperçoit des lignes courbes qui s’étendent
en fens contraire, depuis le centre à la circonférence
, & qui en fe croifant-, forment de
petits lofanges. Il y a ordinairement à la circonférence
une bande étroite & circulaire. Les lignes
courbes fe ramifient à mefure qu’elles s’éloignent
du centre, &leur nombre eft d’autant plus grand,
qu’elles approchent davantage de la circonférence
; ainfi la grandeur des lofanges eft prefque
par-tout à-peu-près la même, leurs côtés, ou au
moins leurs angles, ont une couleur plus vive que
le refte , fans doute parce que leur fubftance eft
plus compacte : la bande de la circonférence eft quelquefois
compofée de fibres droites tranfverfalés,
qui aboutiroient au centre fi elles étoient prolongées^
c’eft l’apparence de ces lignes & de ces
points que l’on appelle le grain de l ’ivoire.
On apperçoit le grain dans tous les ivoirès,
mais il eft plus ou moins féhfible dans différentes
défenfes, & parmi les ivoires dont le grain eft affez
apparent pour qu’on leur donne le nom d’ivoire
grenu, il y en a qu’on appelle ivoire à gros grains,
par oppofition à celui dont le grain eft plus fin &
moins apparent.
On voit de plus fur la coupe tranfverfale des
défenfes plufieurs cercles & zones concentriques,
comme fur une calcédoine onix ; ces zones font
diftinguées les unes des autres par différentes
nuances ; elles font fort irrégulières, tant pour leur
courbure.que pour leur largeur ; il y a aufîi
des lignes ou de petites bandes ‘ qui s’étendent
dans la direétion du centre à la circonférence du
plan de la coupe tranfverfale de la défenfe ; ces
cara&ères font fujets à beaucoup de variétés &
d’irrégularités ; rarement le coeur eft au centre, les
courbes des lignes concentriques ne font pas uniformes
; les zones ont plus de largeur dans des
endroits que dans d’autres ; la bande de la circonférence
manque en tout ou en partie.
Lorfque Y ivoire, defféché à un certain point,
fe fend dans la direâion des courbes ou zones
concentriques , &. même dans la direction des
î v o ,4J
lignes qui vont du centre à la circonférence ,
ces fentes pénètrent dans la longueur de la défenfe
; celles qui font concentriques font voir,
qu’elle eft compofée de courbes autîi concentriques
, qui forment des cônes creux appliqués les
uns fur les autres , la pointe tournée du côté de
celle de la défenfe ; ainfi les zones qui paroiffent
fur le plan de la coupe tranfverfale , font les places
des cônes tronques par cette même coupe • la
couche extérieure de la défenfe eft nommée
\ ecorce, elle forme a la circonférence de la coupe
tranfverfale la bande dont il a'déjà été fait mention
; mais g tranche qui la forme manque fou-
vent en entier, & alors au lieu d’écorce il n’y a
qu une couleur jaune , touffe ou noire à. l'extérieur
eUe an.défelrfj : lor/qVe IW c e a de l’épaiffeur,
elle, eft plus dure & jaunit moins que les parties
qui iont plus près du centre. r
Après avoir fcié- une défenfe en' fuivant fa lon-
gueur, on voit fur le plan de cette coupe longitudinale
des zones pu des ondes qui font aufii àpeu
pres longitudinales., & qui forment des portions
d ovales, comme fur les parois d’une planche
de bois. Ces zones longitudinales, & les zones
tranfverfales dont .la ■ fai, mention, diiparoii-
ient peu-a-peu prefque, entièrement, & ne font
bien apparentes -qué dans le'temps oh IW c
fraK commence à fe deffécher.
Vivoire eft donc compo.fê dé couches coniques,
concentriques^ additionnellesj la cavité qui fe
M M Partie pofférieure de toutes les
efenfes, eft formée par les parois internes de
leur première couche intérieure. M. Perrault ri,-,
porte -que- l’on a trouvé dans d’éléphant de- la
ménagerie de Veuilles g cette' cavité rempl e
dune efpèce de chair attachée’ au fond de l’a
véole j qui n’eft ;qufehe 'làme ‘offeufe , mince
comme du pap.er, & percée g | plufieurs trous
mgÊMÊÊÊÊÈm M/FertapItj-.jÉtoii endurais
a l a furface partie moyen. ; de, laquelle elle
etoit attachée le long de la cavité qui, eft dans la
défenfe, de manière qu’elle' paroiffoit,avoir quoique
difpoüf on a devenir offeufe ; & cétte refilante
pourrait donner quelque vraifemblance à l w !
W île ceu? „ tîul :t;e" 1E.nt que les défenfes, tom- •
bent &_renaiffe.it a 1 éléphant, comme le bois
aux cerfs , cet endurciffement pouvant être con-
Üe' u fC0? me Ie “ mmerjeement, de la génération
des défenfes qui doivent .renaître ,i.. Mais il, nous
femble au contraire que. fi la chair de. la -défenfe
devoit former une nôuvellë défenfe , elle
ne s attacherait pas' à celle qui devra t s’en
feparer dans la fuite',, n’y àyant pas lieu de
croire que les défenfes. de l’éléphant tombent
comme;le bois .du cerf ; il me o L i , „ !„ . » •
fèmblable- que ; k c h * ’;des d é S feur W '
mflè de nouvelles 'couches qui s’olfifient fuc-
W $ aj'outenf à mefure qu’elle
de l accrP>ftement ; car le germe^d’urn»
défenfe eft creux prefque jufqu’à Sfe poiBte