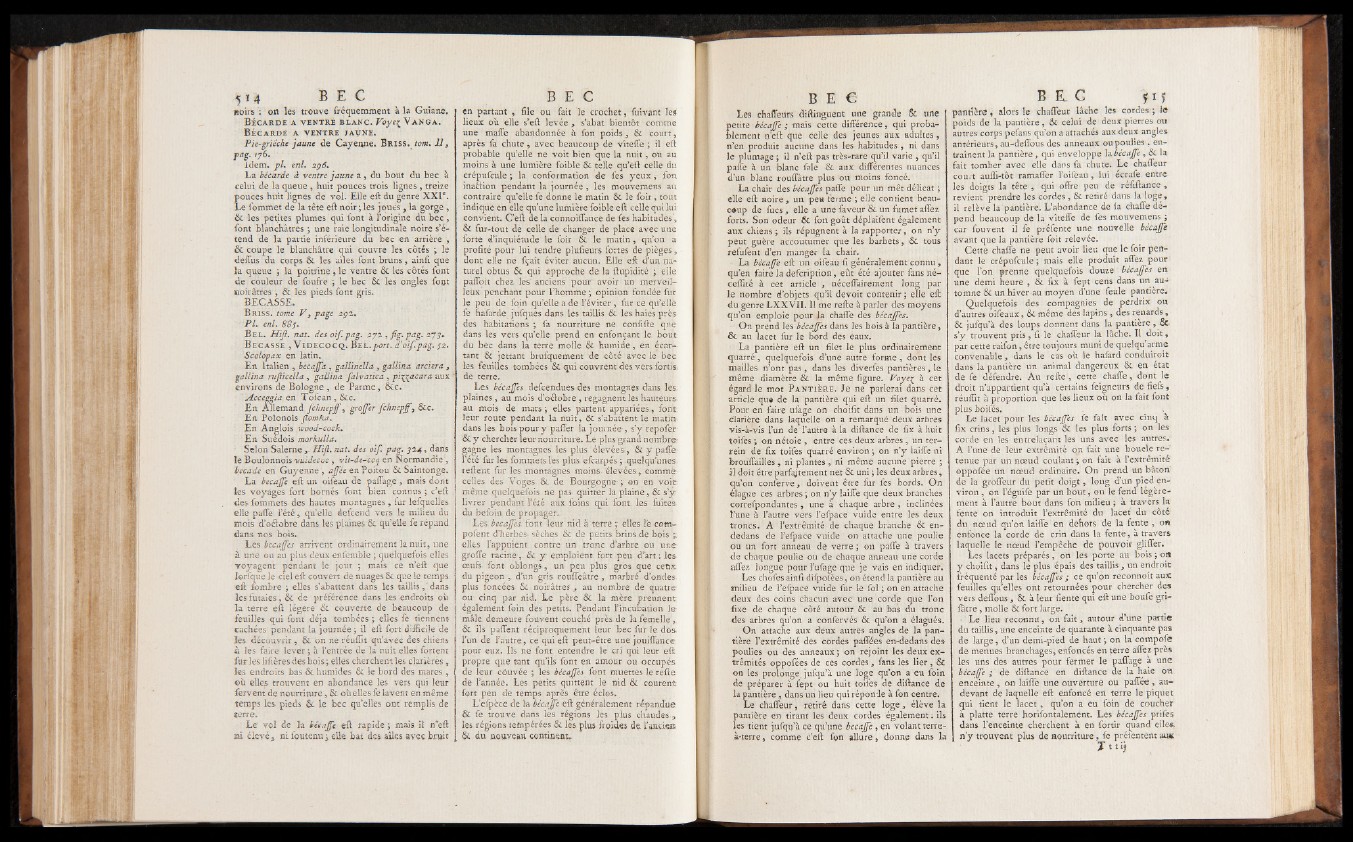
5 M B E C
noirs : on les trouve fréquemment à la Guiane.
Bécarde a ven tr e b l a n c . Voye^ V a n g a .
B é card e a ven tr e jaun e.
Pie-griéçhe jaune de Cayenne. Br is s . tom. U 3
Fag. 176.
idem. pL enl. 296.
La bécarde à ventre jaune a , du bout du bec à
celui de la queue , huit pouces trois lignes , treize
pouces huit lignes de vol. Elle eft du genre XXIe.
Le fommet de la tête eft noir ; les joues , la gorge ,
6 les petites plumes qui font à l’origine du bec,
font blanchâtres ; une raie longitudinale noire s’étend
de la partie inférieure du bec en arrière ,-
& coupe le blanchâtre qui couvre les côtés ; le
deffus du corps & les ailes font bruns, ainfi que
la queue ; la poitrine , le ventre & les côtés font
de couleur de foufre ; le bec ôc les ongles font
noirâtres , & les pieds font gris.
BECASSE.
B riss. tome V3 page 292»
PL enl. 88SB
e l . Hifi. nat. des oif. pag. 272 , fig. pag. 2 7 3 *
BECASSE , VlDECOCQi BeL.port. d'oif.pag. $2.
Scolopax en latin.
En Italien , becafa , gallinella 3 gallina arciera 3
g a llïn a ruflicella, gallina falvatica , pi^acara aux
environs de Bologne, de Parme, &c.
Acceggïa en Tolcan , &c.
En Allemand fchnepjf, grojfer fchnepjf, &c.
En Polonois Jlomka_
En Anglois wood-cock.
En Suédois morkulla.
Selon Salerne Hifi. nat. des oif. pag. 924, dans
le Boulonnois viiidecoc , vit-de-coq en Normandie',
becade en Guyenne , a fée en Poitou & Saintonge.
La becajfe eft un oifeau de paffage , mais dont
tes voyages fort bornés font bien connus ;. c’eft
des fommets des hautes montagnes , fur lefquelles
elle pafle l’été, qu’elle defcend vers le milieu du
mois cL’oâobre dans les plaines & qu’elle fe répand
dans- nos bois.
Les becafes arrivent ordinairement la nuit, une
à une ou au plus deux enfemble ; quelquefois elles
voyagent pendant le jour ; mais ce n’eft que
Iorfque le ciel eft couvert de nuages & que le temps,
eft fombre ; elles s’abattent dans les taillis, 'dans,
les futaies, & de préférence dans les -endroits où
la terre eft légère & couverte de beaucoup de
feuilles qui font déjà tombées ; elles fe tiennent-
cachées pendant la journée ; il eft fort difficile de
les découvrir , & on ne réufîit qu’avec des chiens
à les faire lever ; à l’entrée de la nuit elles fortent
furies libères des bois; elles cherchent les clarièrès ,
les endroits bas & humides & le bord des mares ,
©ù elles trouvent en abondance les vers qui leur
fervent de nourriture, & où elles fe lavent en même
temps les pieds & le bec qu’elles ont remplis de
terre.
Le' vol de la èeeajfe eft rapide ; mais îî n’eft
ai élevé x ni foutenu \ elle bat des ailes avec bruit
B E C
en partant , file ou fait le crochet, fuivant les
lieux où elle s’eft levée , s’abat bientôt comme
une mafte abandonnée à fon poids, & court,
après 1a chute, avec beaucoup de vîteffe ; il eft
probable qu’elle ne voit bien que la nuit, ou au
moins à une lumière foible &. telle qu’eft celle du
crépufcule ; la conformation de fies yeux,- fion
inaéfion pendant la journée , les mouvemens au
contraire qu’elle fe do.nne le matin & le foir, tout
indique en elle qu’une lumière foible eft celle qui lui
convient. C’eft de la connoiffance de fes habitudes,
& fur-tout de celle de changer de place avec une
forte d’inquiétude le foir & le matin, qu’on a
profité pour lui tendre plufieurs fortes de pièges,
dont elle ne fçaît éviter aucun. Elle eft d’un naturel
obtus & qui approche de la ftupidité ; elle
pafloit chez les' anciens pour avoir un merveilleux
penchant pour l ’homme ; opinion fondée fur
le peu de foin qu’elle a de l’éviter , fur ce qu’elle
fe hafarde jüfiques dans les taillis & les haies près
des habitations ; fa nourriture ne confifte que
dans les vers qu’elle prend en enfonçant le bout
du bec dans la terre molle & humide, en écartant
& jettant brufquement de côté avec le bec
les feuilles tombées & qui couvrent des vers fortis.
de terre.
Les bécafes defcendues des montagnes dans les
plaines , au mois d’oélobre , regagnent les hauteurs-
au mois de mars ; elles partent appariées., font
leur route pendant la nuit, & s’abattent le matin,
dans les. bois pour y paffer la journée , s’y repofer
& y chercher leur nourriture. Le plus grand nombre;
gagne les montagnes, les plus, élevées,,. & y paffe-
l’été fur les fommets les plus, efcarpés ; quel qu’unes,
relient fur les montagnes, moins, élevées r comme
celles des Voges- & de Bourgogne-; on en voit:
même quelquefois ne pas quitter la plaine, & s’y
livrer pendant l’été aux. foins qui font, les fuites
du befoin de propager..
Les becaJfes. font leur nid a terre elfes le com-
pofent d’herhes: sèches &c de petits, brins de bois ^
elles l’appuient : contre un tronc d’arbre ou une
grofle racine,. & y emploient fort peu d’àrt : les
oeufs font oblongs, un peu plus gros que ceux
du pigeon , d’un gris rouffeâtre , marbré, d’ondes
plus foncées & noirâtres'au nombre de quatre
ou cinq par nid. Le père & la mère prennent:
également foin des petits. Pendant l’incubation le
mâle demeure fouvent couché près, de la femelle ,.
& ils paftent réciproquement leur bec fur le dos,
l’un de l’autre, ce qui eft peut-être une jouiffance
pour eux. Ils ne font entendre le cri qui leur eft
propre que tant qu’ils font en amour ou occupés-
de leur couvée ; les bécajfes font muettes le refte
de l’année. Les petits quittent le nid & courent
fort peu de temps après être éclos-
L’efpèce de la bécajfe eft généralement répandue;
& fe trouve dans les régions les plus chaudes.,
les régions tempérées & les plus froides de l’ancieiî
& du nouveau continentbe
e
Les chaffeurs diftinguent une grande & une
petite bécajfe ; mais cette différence, qui probablement
n’eft que celle des jeunes aux adultes,
n’en produit aucune dans les habitudes , ni dans
le plumage ; il n’eft pas très-rare qu’il varie , qu’il
pafle à un blanc fale de aux différentes nuances
d’un blanc rouffâtre plus ou moins foncé.
La chair des bée a fes pafle pour un mêt délicat ;
elle eft noire , un peu ferme ; elle contient beaucoup
de fucs, elle a une faveur & un fumet allez
forts. Son odeur & fon goût déplaifent également
aux chiens; ils répugnent à la rapporter, on n’y
peut guère accoutumer que les barbets, & tous
refufent d’en manger la chair.
La bécajfe eft un oifeau fi généralement connu ,
qu’en faire la defeription, eût été ajouter fans né-
ceflité à cet article , néceffairement long par
le nombre d’objets qu’il de voit contenir ; elle eft
du genre LXXVII. 11 me refte à parler des moyens
qu’on emploie pour Ja chaffe des bécajfes.
On prend les bécajfes dans les bois à la pantière,
&. au lacet fur le bord des eaux.
La pantière eft un filet le plus ordinairement
quarré, quelquefois d’une autre forme, dont les
mailles n’ont pas, dans les diverfes pantières,le
même diamètre & la même figure. Voyeç à cet
égard le mot Pan t iè r e . Je ne parlerai dans cet
article que de la pantière qui eft un filet quarré.
Pour en faire ufage on choifit dans un bois une
clarière dans laquelle on a remarqué deux arbres
vis-à-vis l’un de l’autre à la diftance de fix à huit
toifes ; on nétoie , entre ces deux arbres, un ter-
rein de fix toifes quarré environ ; on n’y laifle ni
broùffailles, ni plantes, ni même aucune pierre ;
il doit être parfaitement net & uni ; les deux arbres,
qu’on conferve, doivent être fur fes bords. On
élague ces arbres ; on n’y laifle que deux branches
correfpondantes, une à chaque arbre , inclinées
l’une à l’autre vers l’efpace vuide entre les deux
troncs. A l’extrémité de chaque branche & en-
dedans de l’efpace vuide on attache une poulie
ou un fort anneau de verre ; on pafle à travers
de chaque poulie ou de chaque anneau une corde
affez longue pour l’ufage que je vais en indiquer.
Les chofes ainfi difpolees, on étend la pantière au
milieu de l’efpacé vuide fur le fol ; on en attache
deux des coins chacun avec une corde que l’on
fixe de chaque côté autour & au bas du tronc
des arbres qu’on a cortfervés & qu’on a élagués.
On attache aux deux autres angles de la pantière
l’extrémité des cordes paflees en-dedans des
poulies ou des anneaux ; on rejoint les deux extrémités
oppofées de ces cordes, fans les lier, &
on les prolonge, jüfqu’à une loge qu’on a eu foin
de préparer à fept ou huit toifes de diftance de
la pantière § dans un lieu qui réponde à fon centre.
Le chaffeur, retiré dans cette loge, élève la
pantière en tirant les deux cordes également ; ils
les tient jufqu’à ce qu’une becajfe , en volant terre-,
à*terre, comme ç’eft fon allure, donne dans la
B E. G j i f
pantière, alors le chaffeur lâche les cordes ; le
poids de la pantière, & celui de deux pierres ou
autres corps pefans qu’on a attachés aux deux angles
antérieurs, au-deffous des anneaux ou poulies . entraînent
la pantière , qui enveloppe la bécajfe, & la
fait tomber avec elle dans fa chute. Le chaffeur
court aufli-tôt ramaffer l’oifeau, lui. écrafe entra
les doigts la tête , qui offre peu de réfiftance ,
revient prendre les cordes , & retiré dans la loge ,
il relève la pantière. L’abondance de la chaffe dépend
beaucoup de la vîteffe de fes mouvemens ;
car fouvent il fe préfente une nouvelle bécajfe
avant que la pantière foit relevée.
Cette chaffe ne peut avoir lieu que le foir pendant
le crépufcule ; mais elle produit affez pour
que l’on prenne quelquefois douze bécajfes en.
une demi heure , & fix à fept cens dans un au*1
tomne & un hiver au moyen d’une feule pantière*
Quelquefois des compagnies de perdrix ou
d’autres oifeaux, & même des lapins , des renards,
& jufqu’à des loups donnent dans la pantière , &•
s’y trouvent pris, fi le chaffeur la lâche. Il doit,
par cette raifon, être toujours muni de quelqu’arme
convenable, dans le cas où le hafard conduiroit
dans la pantière un animal dangereux & en état
de fe défendre. Au refte, cette chaffe, dont le
droit n’appartient qu’à certains feigneurs de fiefs ,
réuflit à proportion que les lieux où on la fait font
plus boifés.
Le lacet pour les bécajfes fe fait avec cinq a
fix crins, les plus longs & les plus forts ; on les
corde en les entrelaçant les uns avec les autres*
A l’une de leur extrémité qn fait une boucle retenue
par un noeud coulant ; on fait à l’extrêmite
oppofée un noeud ordinaire. On prend un bâton
de la groffeur du petit doigt, long d’un pied environ,
on l’éguife par un bout, on le fend légère-
j ment à l’autre bout dans fon milieu ; à travers la
fente on introduit l’extrémité du lacet du côté
du noeud qu’on laifle en dehors de la fente , on
enfonce la corde de crin dans la fente, à travers
laquelle le noeud l’empêche de pouvoir gliffer.
Les lacets préparés, on les porte au bois ; on
y choifit, dans le plus épais des taillis , un endroit
fréquenté par les bécajfes ; ce qu’on reconnoît aux
feuilles qu’elles ont retournées pour chercher des
vers deffous , & à leur fiente qui eft une boufe gri-
fatre, molle & fort large.
• Le lieu reconnu, on fait, autour d’une partie
du taillis, une enceinte de quarante à cinquante pas
de large, d’un demi-pied de haut ; on la compofe
de menues branchages, enfoncés en terre affez près
les uns des autres pour fermer le paffage à une
bécafe ; de diftance en diftance de la haie ou
enceinte, on laifle une ouverture ou paffée, au-
devant de laquelle eft enfoncé en terre le piquet
qui tient le lacet, qu’on a eu foin de coucher
à platte terre horifontalement. Les bécajfes prifes
dans l’enceinte cherchent à en fortir quand elles,
n’y trouvent plus de nourriture, fe présentent aux