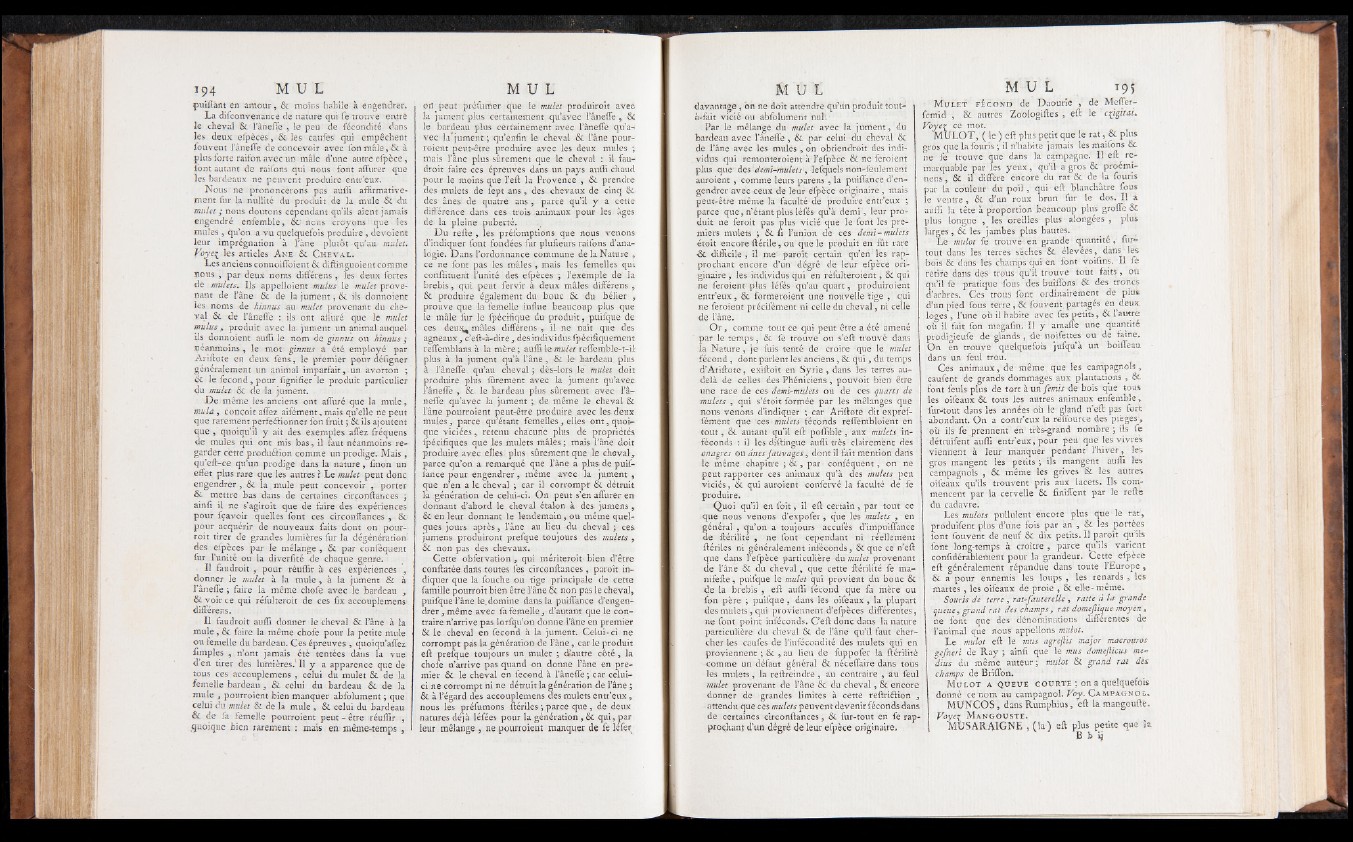
i94 MU L
puiflânt en amour, & moins habile à engendrer,
La difconvenance de nature qui fe trouve entré
le cheval 6c l’ânefTe , le peu de fécondité dans
les deux efpèces', & les caufes' qui empêchent
fouvent l’âneflfe de concevoir avec fon mâle, & à
plus forte raifon avec un mâle d’une autre efpèce ,
lont autant de raifons qui nous font affiner que
les bardeaux ne peuvent produire entr’eux.
Nous ne prononcerons pas aüffi affirmativement
fur la -nullité du produit de la mule & du
mulet ; nous doutons cependant qu’ils aient jamais
engendré enfemble, 6c- nous croyons que les
mules , qu’on a vu quelquefois produire, dévoient
leur imprégnation à l’âne plutôt-qu’au mulet,
Foÿei les articles Ane- & C h e v a l .
Les anciens connoifioient & diftinguoient comme
nous , par deux noms diffère ns les deux fortes
de mulets. Ils appelloient mulus le mulet provenant
de l’âne • & de la jument, & ils donnoient
les noms de hinnus au mulet provenant du cheval
& de l’âneile : ils ont alluré que le mulet
mulus y produit avec la jument un animal auquel-
ils donnoient auffi le nom de ginnus ou hinnus ;
néanmoins , le mot ginnus a été employé par
Ariftote en deux fens, le premier pour défigner
généralement un animal imparfait, un avorton ;
de lè fécond, pour lignifier le produit particulier
du mulet. & de la jument.
De même les anciens ont alluré que la mule,
mu la , conçoit alfez aifément, mais qu’elle ne peut
que rarement perfectionner fon fruit ; 8c ils ajoutent
que , quoiqu’il y ait des exemples alfez fréquens
de mules qui ont mis bas, il faut néanmoins regarder
cette production comme un prodige. Mais ,
qu’eft-ce qu’un prodige dans la nature, linon un
effet plus rare que les autres ? Le mulet peut donc
engendrer, 6c la mule peut concevoir , porter
& mettre bas dans de certaines circonfiances ;
ainfi il ne s’agiroit que de faire des expériences
pouf fçavoir quelles font ces circonfiances ,. &
pour acquérir de nouveaux faits dont on pour-
roit tirer dé grandes lumières fur la dégénération
des efpèces par le mélange , 8c par conféquent
fur l’unité ou la diverfité de chaque genre.
Il faudroit pour réufîir à ces expériences ,
donner le mulet à la mule , à la jument & à
l’ânelfe ; faire la même chofe avec le bardeau , 6c voir ce qui réfulteroit de ces fix accouplemens'
différons.
Il faudroit auffi donner le cheval & l’âne à la
mule, 8c faire la même chofe pour la petite mule
ou femelle du bardeau. Ces épreuves , quoiqu’affez
fimples , n’ont jamais été tentées dans la vue
d’en tirer des lumières.' Il y a apparence que de
tous ces accouplemens , celui du mulet & de la
femelle bardeau, & celui du bardeau 8c de la
mule , pourroient bien manquer abfolument ; que
celui du mulet 8c de la mule , 8c celui du bardeau
& de fa femelle pourroient peut - être réuffir .,
quoique bien rarement : mais en même-temps ,
M U L
on peut préfumer que le mulet produirait avec
la jument plus certainement qu’avec l’âneffe , 8c
le bardeau plus certainement avec l’âneffe qu’avec
la* jument ; qu’enfin le cheval & l’âne pourroient
peut-être produire avec les deux mules ;
mais l’âne plus sûrement que le cheval : il faudroit
faire ces épreuves dans un pays auffi chaud
pour le moins que l’eft la Provence , 8c prendre
des mulets de fept ans , des chevaux de cinq 6c
des ânes de quatre ans , parce qu’il y a cette
différence dans ces trois animaux pour les âges
de la pleine puberté.
Du refte , les préfomptions que nous venons
d’indiquer font fondées fur plufieurs raifons d’analogie.
Dans l’ordonnance commune de la Nature ,
ce ne font pas les mâles , mais les femelles qui
conftituent l’unité des efpèces ; l’exemple de la
brebis, qui. peut fervir à deux mâles différens ,
& produire également du bouc 6c du bélier ,
prouve que. la femelle influe beaucoup plus que
le mâle fur le fpécifique du produit, puifque de
ces deux^ mâles différens , il ne naît que des
agneaux c’eft-à-dire y des individus fpécifiquement
reffemblans à la mère; auffi le mulet refTemble-t-il
plus à la jument qu’à l’âne, 8c le bardeau, plus
à l’âneffe qu’au cheval ; dès-lors Je mulet doit
produire plus fûrement avec la jument qu’avec
l’ânefle , &. le bardeau plus sûrement avec l’â—
neffe qu’avec la jument ; de même le cheval 6c
l’âne pourroient peut-être produire avec les deux
mules , parce qu’étant femelles , elles ont, quoique
viciées, retenu chacune plus dé propriétés
fpécifiques que les mulets mâles ; mais l’âne doit
produire avec elles plus sûrement que le cheval>
parce qu’on a remarqué que l’âne a plus de puif-
fance pour engendrer, même avec la jument ,
que n’en a le cheval ; car il corrompt" & détruit
la .génération de celui-ci. On peut s’en affurer en
donnant d’abord le cheval étalon à des- jumens ,
& en leur donnant le lendemain, ou même quelques
jours après, l’âne au lieu du cheval ; ces
jumens produiront prefque toujours des mulets. , 8c non pas des chevaux.
Cette obfervation , qui mériterait- bien d’être
conftatée dans toutes fes circ.onftances , paraît indiquer
que la fouche ou tige principale de cette
famille pourroit bien être l’âne 6c non pas le cheval,
puifque l’âne le. domine dans la puiffance d’engendrer
, même avec fa femelle , d’autant que le contraire
n’arrive pas lorfqu’on donne l’âne en premier
6c le cheval en fécond à la jument. Celui-ci ne
corrompt pas la génération de l’âne, car le produit
eft prefque toujours un mulet ; diautre côté, la
chofe n’arrive pas quand on donne l’âne en premier
& le cheval en fécond à l’âneffe ; car celui-
ci ne corrompt ni ne détruit la génération de l’âne ;
6c à l’égard des accouplemens des mulets entr’eux,
nous les préfumons ftériles ; parce que , de deux
natures déjà léfées pour la génération , 6c qui, par
leur mélange , ne pourroient manquer de fe léfer
M U L
davantage, on ne doit attendre qu’un produit tout-
à-fait vicié ou abfolument nul.
Par le mélange du mulet avec la jument, du
bardeau avec l’âneffe , 6c par celui du cheval 6c
de l’âne avec les mules , on obtiendrait des individus
qui remonteraient à l’efpèce & ne feraient
plus que" des demi-mulets!, lefquels non-feulement
auraient, comme leurs parens , la puiffance d’engendrer
avec ceux de leur éfpèçe originaire , mais
peut-être même la faculté dë produire entr’eux ;
parce que, n’étant plus léfés qu’à demi, leur produit
ne feroit pas plus vicié que le font les premiers
mulets ; 6c fi l’union de ces demi-mulets
étoit encore ftérile, ou que le produit en fût rare 8c difficile , il me- paraît certain qu’en' les rapprochant
encore d’un dégré de leur efpèce originaire
, les individus qui en réfulteroient, 8c qui
ne feraient plus léfés qu’au quart, produiraient
entr’eux, & formeraient une nouvelle tige , qui
ne feraient précifément ni celle du cheval, ni celle
de l’âne.
O r , comme tout ce qui peut être a été amené
par le temps', & fe trouve ou s’éft trouvé dans ’■
la Nature , je fuis tenté de croire que le mulet
fécond , dont parlent les’anciens, 6c qui, du temps
d’Ariftote, exiftoit en Syrie, dans les terres au-
delà de celles des Phéniciens, pouvoir bien être
une race de ces demi-mulets ou de ces quarts de
mulets , qui s’étoit formée par les mélanges qu.e
nous venons d’indiquer ; car Ariftote dit expref-
lément que ces mulets féconds reffembloient en
tout, 6c autant qu’il eft poffible , aux mulets inféconds
: il les diftingue auffi très clairement des
onagres ou ânes Jauvages j dont il fait mention dans
le même chapitre ; 6c , par - conféquent, on ne
peut rapporter ces animaux qu’à des mulets peu
viciés, 6c qui auraient confervé la faculté de fe
produire.
Quoi qu’il en foit, il eft certain, par tout ce
que nous venons d’expofer, que les mulets , en
général , qu’on a toujours accufés d’impuifTance
de ftérilité , ne font cependant ni réellement
ftériles ni généralement inféconds, & que ce n’eft
que daps l’efpèce particulière du mulet provenant
de l’âne & du cheval, que cette ftérilité fe ma-
nifefte, puifque le mulet qui provient du bouc &
de la brebis , eft auffi fécond que fa mère ou
fon père ; puifque , dans les oifeaux , la plupart
des mulets, qui proviennent, d’efpèces différentes,
ne font point inféconds. C’eft donc dans la nature
particulière du cheval 6c de l’âne qu’il faut chercher
les caufes de l’infécondité des mulets qui en
proviennent ; 6c , au lieu de fuppofer la ftérilité
-comme un défaut général 6c néceffaire dans tous
les mulets, la reftreindre, au contraire , au feul
mulet provenant de l’âne 6c du cheval, & encore
donner de grandes limites à cette reftriélion ,
attendu que ces mulets peuvent devenir féconds dans
de certaines circonftances, 8c fur-tout eri fe rapprochant
d’un dégré de leur efpèce originaire.
M U L i 9î
M u l e t f é c o n d de Daourie , d e Meffer-
fcmid ‘ , 6c autres Zoologiftes , eft le cfigitau
Voye^ ce mot. .
MULOT, ( le ) eft plus petit que le rat, 8c plus
gros que la fouris ; il n’habite jamais les maifons 6c
ne fe trouve que dans la campagne.' Il eft remarquable
par les y eux, qu’il a gros & proemi-
nehs , & il diffère encore du rat 6c de la fouris
par la coulèûr du poil, qui êft blanchâtre fous
le ventre, 8c d’un roux brun fur le dos. Il a
auffi la tête à proportion beaucoup plus groffe 6c
plus longue , les oreilles plus I alongees , plus
larges, & les jambes plus hautes.
Le mulot fe. trouve en grande quantité, fur-
tout dans les terres seches & élevées, dans les
bois 6c dans les champs qui èn font voifins. Il fè
retire dans des trOus qu’il trouve toiit faits, ou
qu’il fe pratique‘fous des buiffons 8c des troncs
d’arbres. Ces trous font ordinairement de plus
d’un pied fous terre ,& fouvent partages en deux
loges , l’une où il habite avec fes petits, 8c l’autre
où il fait fon magafin. Il y amafle une quantité
prodigieufe de glands , de noifettes ou de faîne.
On en trouve quelquefois jufqu’à un boiffeau
dans un feul trou.
Ces anitnaux, dë même, que les campagnols,
caufent de grands dommages aux plantations , 6c
Font feuls plus de tort à un femis de bois que tous
les oifeaux 6c tous les autres animaux enfemble,
Jùr-tout dans les années où le gland n’eft pas fort
abondant. On a contr’eux la reffource des pièges-,
ou ils fe prennent en très-grand nombre ; ils fe
détrüifent auffi entr’eux, pour peu' que les vivres
viennent à leur manquer pendant l’hiver, les
gros mangent les petits ; ils mangent auffi les
campagnols , 6c même les grives & les autres
oifeaux qu’ils trouvent pris aux lacets. Ils commencent
par la cervelle 6c finiffent par le refte
du cadavre.
Les mulots pullulent encore plus que le rat,
produifent plus d’une fois par an , 6c les portées
font fouvent de .neuf 6c dix petits. Il paraît qu’ils
font long-temps à croître , parce qu’ils varient
confidérablement pour la grandeur. Cette efpèce
eft généralement répandue dans toute l’Europe, 6c a pour ennemis les loups , les renards, lës
martes , les oifeaux de proie , 6c elle-même.
Souris de terre , Vat-fauter elle , ratte à la grande
queue, grand rat des champs , rat dômeflique moyen 3
ne font que' des dénominations différentes de
l’animal que nous appelions mulot.
Le mulot eft le mus agreftis major macropros
gefneri de Ray ; ainfi que le mus domefiicus médius
du même auteur; mulot 6c grand rat dès
champs de Briflon.
M u l o t a q u e u e c o u r t e ; on a quelquefois
donné ce nom au campagnol. Voy. C a m p a g n o l .
MUNCOS, dans Rumphius, eft lamangoufte.
Voyez M a n g o u s t e .
MUSARAIGNE , (la ) eft plus petite que la
B b ij