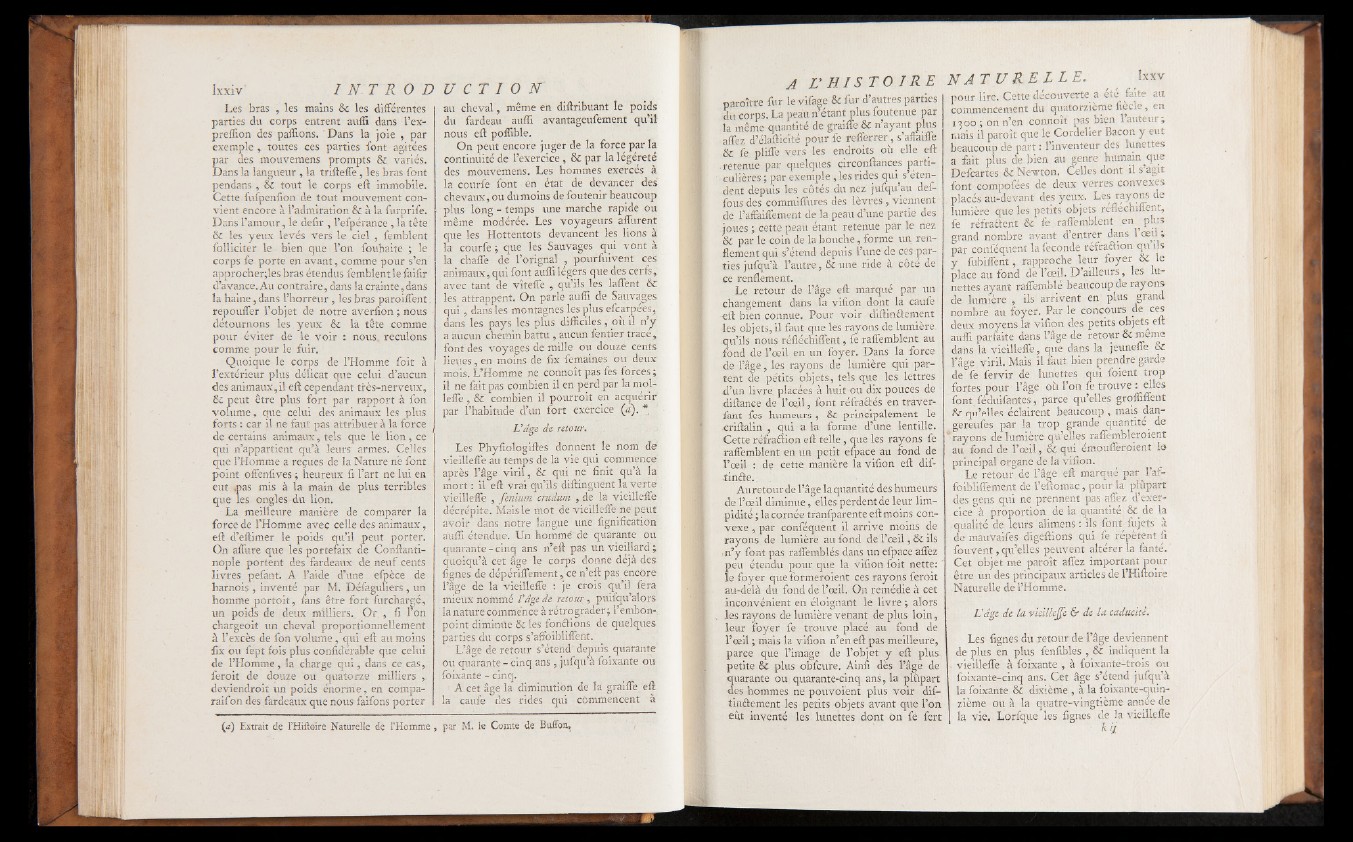
Les bras , les mains & les différentes
parties du corps entrent aufli dans l ’ex-
preflion des pallions. ' Dans la joie , par
exemple , toutes ces parties font agitées
par des mouvemens prompts & variés.
Dans la langueur , la trifteffe, les bras font
pendans , & tout le corps eft immobile.
Cette fufpenfion de tout mouvement convient
encore à l’admiration & à la furprife.
Dans l’amour , 1e defir , l’efpérance, la tête
& les yeux levés vers le ciel , femblent
folliciter le bien que l’on fouhaite ; le
corps fe porte en avant, comme pour s’en
approcher;les bras étendus femblent le faifir
d’avance. Au contraire, dans la crainte, dans
la haine, dans l’horreur, les bras paroiffent.
repouffer l’objet de notre averfion ; nous -
détournons les yeux & là tête comme
pour éviter de le voir : nous, reculons
comme pour le fuir.
Quoique le corps de l’Homme foit à
l ’extérieur plus délicat que celui d’aucun
des animaux,il eft cependant très-nerveux,
& peut être plus fort par rapport à fon
volume, que celui des animaux les plus,
forts : car il ne faut, pas attribuer à la force
de certains animaux, tels que le lion , ce
qui n’appartient qu’à leurs armes. Celles
que l’Homme a reçues de la Nature né font
point offenfives ; heureux fi l’art ne lui en
eut .pas mis à la main de plus terribles
que les ongles du lion.
La meilleure manière de comparer la
force de l’Homme avec celle des animaux,
eft d’eftimer le poids qu’il peut porter.
On affure que les portefaix de Conftanti-
nople portent des fardeaux de neuf cents
livres pefant. A l’aide d’une efpèce de
harnois , inventé par M. Défaguliers , un
homme portoit, fans être fort furchargé,
un poids de deux milliers.. Or , fi l’on
chargeoit un cheval proportionnellement
à l’excès de fon volume, qui eft au moins
fix ou fept fois plus confiderable que celui
de l’Homme, la charge q u i, dans ce cas,
feroit de douze ou quatorze milliers ,
deviendroit un poids énorme, en compa-
raifon des fardeaux que nous faifons porter
au cheval, même en diftribuant le poids
du fardeau aufli avantageufement qu’il
nous eft poflible.
On peut encore juger de la force par la
continuité de l’exercice , & par la légèreté
des mouvemens. Les hommes exerces a
la courfe font en état de devancer des
chevaux, ou du moins de foutenir beaucoup
plus long - temps une marche rapide ou
même modérée. Les voyageurs affurent
que les Hottentots devancent les lions à
la courfe ; que les Sauvages qui vont à
la chaffe de l’orignal , pourfuivent ces
animaux, qui font aufli légers que des cerfs,
avec tant de vîteffe , qu’ils les laffent &
les attrappént. On parle aufli de Sauvages
q u i, dans les montagnes les plus efcarpées,
dans les pays les plus difficiles, ou il n’y
a aucun chemin battu , aucun fentier trace,
font des voyages de mille ou douze cents
lieues, en moins de fix femaines ou deux
mois. L’Homme ne connoît pas fes forces ;
il ne fait pas combien il en perd par la mol-
leffe , 6c combien il pourroit en acquérir1
par l’habitude d’un fort exercice (a). *
L ’âge de retour.
Les Phyfiologiftes donnent le nom de
vieilleffe au temps de la vie qui commence
après l’âge v ir il, & qui ne finit qu’à la
mort : il eft vrai qu’ils diftinguént la verte
vieilleffe , fenium crudum , de la vieilleffe
décrépite. Mais le mot .de vieilleffe ne peut
avoir dans notre langue une lignification
aufli étendue. Un hommë' de quarante ou
quarante - cinq ans n’eft pas un vieillard ;
quoiqu’à cet âge le corps donne déjà des
Agnes de dépériffement, ce n’eft pas encore
l’âge de la vieilleffe : je crois qu’il fera
mieux nommé l ’âge de retour-, puifqu’alors
la nature commence à rétrograder ; l’embonpoint
diminue & les fondions de quelques
parties du corps s’affoibliffent.
L’âge de retour s’étend' depuis quarante
ou quarante - cinq ans, jufqu’à foixante ou
foixante - cinq.
A. cet âge la- diminution de la graiffe eft
la caufe des -rides qui commencent à
(a) Extrait de l’Hiftoire Naturelle de l’Homme, par M. le Comte de BufFou,
paroître fur le vifage & fur d’autres parties
du corps. La peau n’étant plus foutenue par
la même quantité de graiffe & n’ayant plus
affez d’élafficïté pour fe refferrer, s’affaiffe
6c fe pliffe vers les endroits où elle eft
.retenue par quelques çirconftances particulières
; par exemple, les rides qui s’étendent
depuis les côtés du nez jufqu’au def-
fous des commiffures des lèvres , viennent
de l’affaiffement de la peau d’une partie des
joues ; cette peau étant retenue par le nez
& par le coin de la bouche, forme un renflement
qui s’étend depuis l’une de ces parties
jufqu’à l’autre, 6c une ride à côté de
ce renflement.
Le retour de l’âge eft marqué par un
changement dans \la vifion dont la caufe
eft bien connue. Pour voir diftinél eurent
les objets, il faut, que les rayons de lumière,
qu’ils nous réfléchiffent, fe raffemblent au
fond de l’oeil en un foyer. Dans la force
de l’âge, les rayons de lumière qui partent
de petits objets, tels que les lettres
d’un livre., placées à huit ou dix pouces de
diftance de l’o ÿ l, font réfraâés en traver-
fant fes humeurs , & principalement le
criftalin , qui a la forme d’une lentille.
Cette réfraftion eft telle, que les rayons fe
raffemblent en un petit efpace au fond de
l ’oeil : de cette manière la vifion eft dif-
tinéfe..
Auretourde l’âge la quantité des humeurs
de l’oeil diminue, elles perdent de leur limpidité
; la cornée tranfparente eft moins convexe
, par conféquènt il arrive moins de
pour lire. Cette découverte, a été faite au
commencement du quatorzième fiecle, en
1300; on n’en connoît pas bien l’auteur;
mais il paroît que le Cordelier Bacon y eut
beaucoup de part : l’inventeur des lunettes
a fait plus debien.au genre humain ^que
Defcartes & Newton. Celles dont il s’agit
font compofées de deux verres convexes
, placés au-devant des yeux-. Les rayons de
lumière que les petits objets réfléchiffent,
fe réfra&ent & fe raffemblent en , plus
grand nombre avant d’entrer dans 1 oeil ;
par conféquènt la fécondé réfraction qu ils
y fubiffent, rapproche leur foyer & le
place au fond de l’oeil. D ’ailleurs, les lunettes
rayons de lumière au fond de l’oe i l, & ils
n’y font pas raffemblés dans un efpace affez
peu étendu pour que la vifion foit nette: '
le foyer que formeroient ces rayons feroit
au-delà du fond de l’oeil. On remédie à cet
inconvénient en éloignant le livre ; alors
les rayons de lumière venant de plus loin,
leur foyer fe trouve placé au fond de
l’oeil ; mais la vifion n’en eft pas meilleure,
parce que l’image de l’objet y eft plus,
petite & plus obfcure. Ainfi dès l’âgé de
quarante ou quarante-cinq ans, la plûpart
des hommes ne pouvoient plus voir dif-
tinâement les petits objets avant que l’on
eut inventé les lunettes dont on fè fert
ayant raffemble beaucoup de rayons
de lumière , ils arrivent en plus grand
nombre au foyer. Par le concours de ces
deux moyens la vifion des petits objets eft
aufli parfaite dans l’âge de retour & meme
dans là vieilleffe, que dans la jeuneffe 6c
l’âge viril. Mais il faut bien prendre garde
de fe fervir de lunettes qui forent trop
fortes pour l ’âge où l’on fè trouve : elles
font, féduifantes, parce qu’elles grofliffent
6c qu’elles éclairent beaucoup , mais dan-
gereufes par la trop grande quantité^ de
* rayons de lumière qu’elles raffembleroient
au fond de l’oe il, & qui emouflèroient ls
principal organe de la vifion.
Le retour.de l’âge eft marqué par l’af-
foibliffement de l’eftomac, pour la plûpart
des gens qui ne prennent pas affez d’exercice
à proportion de la quantité & de la
-qualité de leurs alimens: ils font fujets à
de mauvaifes digeftions qui fe répètent fi
fouvent, qu’elles peuvent altérer la fanté.
Cet objet me paroît affez important pour
être un des principaux articles de l’Hiftoire
Naturelle de l’Homme.
L'âge de la vieilleffe & de la caducité.
Les lignes du retour de l’ âge deviennent
de plus en plus fenfibles , & indiquent la
. vieilleffe à foixante , à foixante-trois ou
foixante-cinq ans. Cet âge s’étend jufqu’à
la foixante & dixième , à la foixante-quin-
zième ou à la quatre-vingtième année de
| la vie. Lorfque les fignes de la vieillefle