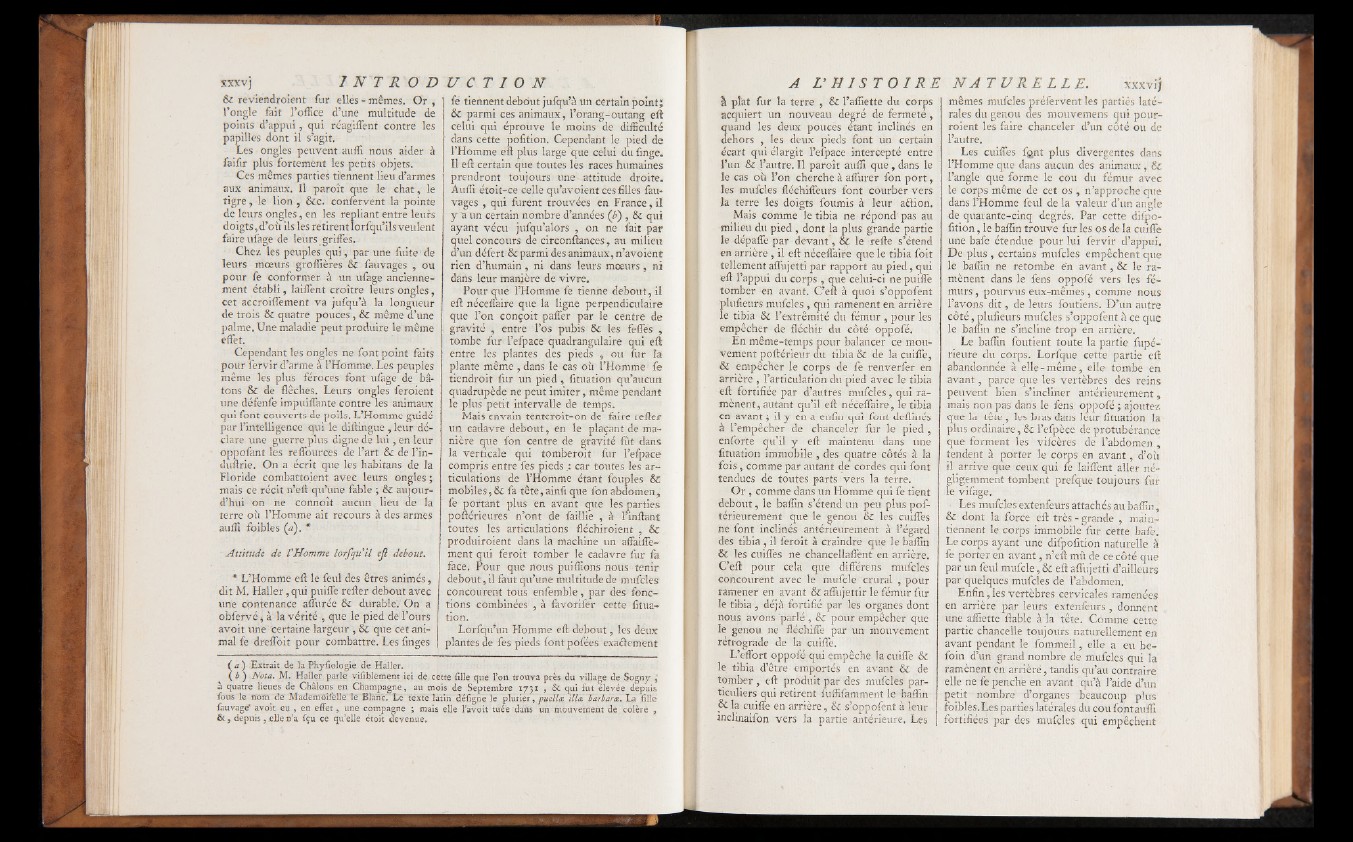
& reviendroient fur elles - mêmes. Or ,
l’ongle fait l ’office d’une multitude de
points d’appui, qui réagiffent contre les
papilles dont il s’agit,-
Les ongles peuvent auffi nous aider à
faifir plus fortement les petits objets.
Ces mêmes parties tiennent lieu d’armes
aux animaux. Il paroît que le chat, le
tigre , le lion , &c. conlervent la pointe
de leurs ongles, en les repliant entre leurs
doigts, d’oii ils les retirent lorfqu’ils veulent
faire ufage de leurs griffes.
Chez les peuples qui, par une fuite'de
leurs moeurs groffières & fauvages , ou
pour fe conformer à un ufage anciennement
établi, laiffent croître leurs ongles,
cet accroiffement va jufqu’à la longueur
de trois & quatre pouces, & même d’une
palme. Une maladie peut produire le même
effet.
Cependant les ongles ne font point faits
pour fervir d’arme à l’Homme. Les peuples
même les plus féroces font ufage de bâtons
& de flèches. Leurs ongles feroient
une défenfe impuiffante contre les animaux
qui font couverts de poils. L’Homme guidé
par l’intelligence qui le diftingue , leur déclare
une guerre plus digne de lu i , en leur
oppofant les reffourcës de l’art & de l’in-
duftrie. On a écrit que les habitans de la
Floride combattoient avec leurs ongles ;
mais ce récit n’eft qu’une fable ; & aujourd’hui
on ne connoît aucun lieu de la
terre oit l’Homme ait recours à des armes
auffi foibles (a). *
Attitude de l'Homme lorfqu'il ejl debout.
* L’Homme eft le feul des êtres animés,
dit M. Haller, qui puiffe relier debout avec
une contenance allurée & durable; On a
obfervé $ à la vérité , qtie le pied dé l ’ours
avoit une certaine largeur , & que cét animal
fe dreffoit pour combattre. Les linges
fe tiennent debout jufqu’à lin certain point;
& parmi ces animaux, l’orang-outang eft
celui qui éprouve le moins de difficulté
' dans cette polition. Cependant le pied de
l’Homme ell plus large que celui du linge.
Il ell certain que toutes les races humaines
prendront toujours une attitude droite.
Auffi étoit-ce celle qu’avoient ces filles fauvages
, qui furent trouvées en France, il
y a un certain nombre d’années (’b) , & qui
ayant vécu jufqu’alors , on ne fait par
quel concours de circonllances, au milieu
d’un défert & parmi des animaux, n’avoient
rien d’humain , ni dans leurs moeurs, ni
dans leur manière de vivre.
Pour que l’Homme fe tienne debout, il
ell néceffaire que la ligne perpendiculaire
que l’on conçoit paffer par le centre de
gravité , entre l’os pubis & les feffés ,
tombe fur l’efpace quadrangulaire qui ell
entre les plantes des pieds , ou fur la
plante même , dans le cas oh l ’Homme fe
tiendroit fur un pied , fituation qu’aucun
quadrupède ne peut imiter, même pendant
le plus petit intervalle de temps.
Mais envain tenteroit-on de faire relier
un cadavre debout, en le plaçant de manière
que fon centre de gravité fût dans
la verticale qui tomberoit fur l’efpace
compris entre fes p ie d s c a r toutes les articulations
de l’Homme étant fouples &
mobiles, & fa tête, ainfi que fon abdomen,
fe portant plus en avant que les parties
poftérieures n’ont de faillie , à l’inllant
toutes les articulations fléchiroient , &
produiroient dans la machine un affaiffe-
ment qui feroit tomber le cadavre fur la
face. Pour que nous publions nous tenir
debout, il faut qu’une multitude de mufcles
concourent tous enfemble, par des fonctions
combinées , à favorifer cette litua-
tion.
Lorfqu’un Homme ell debout, les deux
plantes de fes pieds font pofées exaâement
( a ) Extrait de la Phyfiologie de Haller.
( l ) Nota. M. Haller parle vifibîement ici de cette fille que l’on trouva près du village de Sogny
à quatre lieues de Châlons en Champagne, au mois de Septembre 1731 , & qui fut élevée depuis
fous le nom de Mademôifelle le Blanc. Le texte latin défigne le pluriel’ , puelliz ilia, harbara. La "fille
fauvage' avoit eu , en effet, une compagne ; mais elle l’avoit tuée dans un mouvement de colère ,
& , depuis, elle n’a fçu ce quelle étoit devenue.
à plat fur la terre , & l’affiette du corps
acquiert un nouveau degré de fermete,
quand les deux pouces étant inclinés en
dehors , les deux pieds font un certain
écart qui élargit l’efpace intercepté entre
l’un & l’autre. Il paroît auffi que, dans le
le cas oh l’on cherche à affurer fon p o r t,
les mufcles fléchiffeurs font courber vers
la terre les doigts fournis à leur aftion.
Mais comme le tibia ne répond' pas au
milieu du pied , dont la plus grande partie
le dépaffe par devant, &ç le relie s’étend
en arrière, il ell néceffaire que le tibia foit
tellement affujetti par rapport au pied, qui
eu l’appui du corps , que celui-ci ne puiffe
tomber en avant. C’en à quoi s’oppofent
plufietirs mufcles, qui ramènent en arrière
le tibia & l’extrémité du fémur , pour les
empêcher de fléchir du côté oppofé.
En même-temps pour balancer ce mouvement
poltérieur du tibia & de la cuiffe,
& empêcher le corps de fe renverfer en
arrière, l’articulation du pied avec le tibia
ell fortifiée par d’autres mufcles, qui ramènent,
autant qu’il ell néceffaire, le tibia
en avant ; il y en a enfin qui font deftinés
à l’empêcher de chanceler fur le pied ,
enforte qu’il y ell maintenu dans une
fituation immobile , des quatre côtés â la
fo is , comme par autant de cordes qui font
tendues de toutes, parts vers la terre.
Or , comme dans un Homme qui fe tient
debout, le baffin s’étend un peu plus pof-
térieurement que le genou & les cuiffes
ne font inclinés antérieurement à l’égard
des tibia, il feroit à craindre que le baffin
& les cuiffes ne chancellaffent en arrière.
C’elt pour cela que différens mufcles
concourent avec le mufcle crural , pour
ramener en avant & affujettir le fémur fur
le tibia , déjà fortifié par les organes dont
nous avons "parlé , & pour empêcher que
le genou ne fiéchiffe par un mouvement
rétrograde de la cuiffe.
L’effort oppofé qui empêche la cuiffe &
le tibia d’être emportés en avant & de
tomber, ell produit par des mufcles particuliers
qui retirent fuffifamment le baffin
& la cuiffe en arrière, & s’oppofent à leur
inclinaifon vers la partie antérieure, Les
mêmes mufcles préfervent les partiés latérales
du genou des mouvemens qui pour-
roient les faire chanceler d’un côté ou de
l’autre.
Les cuiffes fgnt plus divergentes dans
l’Homme que dans aucun des animaux, &c
l’angle que forme le cou du fémur avec
le corps même de cet os i, n’approche que
dans l’Homme feul de la valeur d’un angle
de quarante-cinq degrés. Par cette difpo-
fition, le baffin trouve fur les os de la cuiffe
une bafe étendue pour lui fervir d’appui.
De plus , certains mufcles empêchent que
le baffin ne retombe e'n avant, & le ramènent
dans le fens oppofé vers les fémurs
, pourvus eux-mêmes, comme nous
l’avons d i t , de leurs foutiens. D ’un autre
côté ,;plufieurs mufcles s’oppofent à ce que
le baffin ne s’incline trop en arrière.
Le baffin foutient toute la partie fupé-
rieure du corps. Lorfque cette partie ell
abandonnée à elle-même, elle tombe en
avant, parce que les vertèbres des reins
peuvent bien s’incliner antérieurement,
mais non pas dans le fens oppofé ; ajoutez
que la tête , les bras dans leur fituation la
plus ordinaire, & l’efpèce de protubérance
que forment les vilcères de l ’abdomen ,
tendent à porter le corps en avant, d’oh
il arrive que ceux qui fe laiffent aller négligemment
tombent prefque toujours fur
le vifage.
• Les mufcles extenfeurs attachés au baffin,
& dont la force eft très - grande , maintiennent
le corps immobile fur cette bafe.
Le corps ayant une difpofition naturelle â
fe porter en avant, n’eft mû de ce côté que
par un feul mufcle, & eft affujetti d’ailleurs
par quelques mufcles de l’abdomen.
Enfin, les vertèbres cervicales ramenées
en arrière par leurs extenfeurs, donnent
une affiette ftable à la tête. Comme cette
partie chancelle toujours naturellement en
avant pendant le fommeil, elle a eu be-
foin d’un grand nombre de mufcles qui la
ramènent en arrière, tandis qu’au contraire
elle ne fe penche en avant qu’à l’aide d’un
petit nombre d’organes beaucoup plus
foibles. Les parties latérales du cou fontauffi
fortifiées par des mufcles qui empêchent