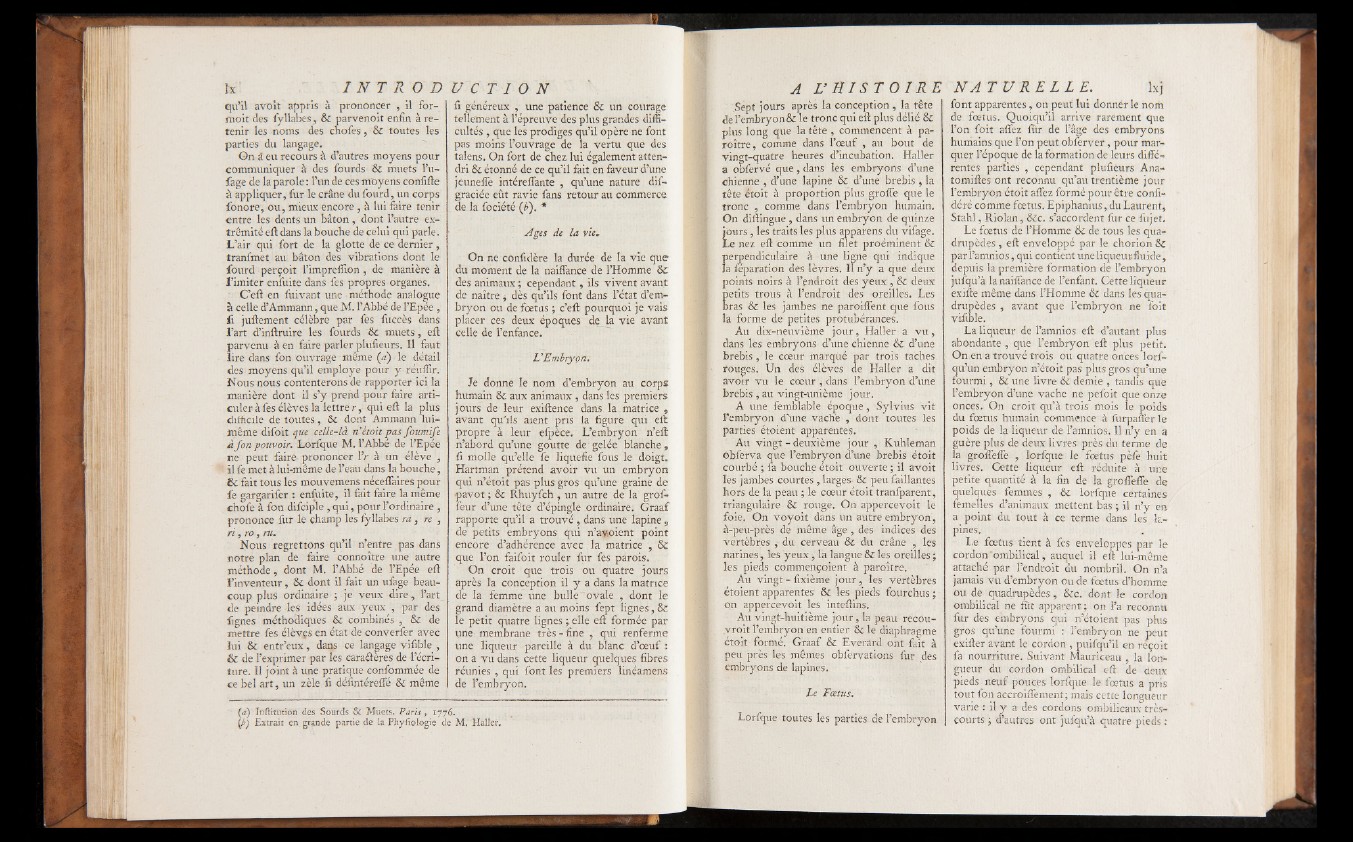
qu’il avoit appris à prononcer , il for-
moit des fyllabes, & parvenoit enfin à retenir
les noms des chofes, 8c toutes les
parties du langage.
On A eu recours à d’autres moyens pour
communiquer à des lourds 8c muets l’u-
fage de la parole : l’un de ces moyens confifte
à appliquer, fur le crâne du fourd, un corps
fonore, ou, mieux encore , à lui Élire tenir
entre les dents un bâton, dont l’autre extrémité
eft dans la bouche de celui qui parle.
L ’air qui fort de la glotte de ce dernier,
tranfmet au bâton des vibrations dont le
fourd perçoit l’impreflion , de manière à
l ’imiter enfuite dans fes propres organes.
C ’eft en fuivant une méthode analogue
à celle d’Ammann, que M. l’Abbé de l’Epée,
fi juftement célèbre par fes fuccès dans
l ’art d’inftruire les fourds 8c muets, elt
parvenu à en faire parler plufieurs. Il faut
lire dans fon ouvrage même (a) le détail
des moyens qu’il employé pour y réuffir.
Nous nous contenterons de rapporter ici la
manière dont il s’y prend pour faire articuler
à fes élèves la lettre r , qui elt la plus
difficile de toutes, & dont Ammann lui-
même difoit que celle-là n étoit pas foumife
À fon pouvoir. Lorfque M. l’Abbé de l’Epéè
ne peut faire- prononcer l’r à un élève ,
il fe met à lui-meme de l’eau dans la bouche,
&c fait tous les mouvemens néceffaires pour
fe gargarifer : enfuite, il fait faire la même
chofe à fon difciple , qui, pour l’ordinaire ,
prononce liir le champ les fyllabes m , re ,
ri ,r o , ru.
Nous regrettons qu’il n’entre pas dans
notre plan de faire connoître une autre
méthode, dont M. l’Abbé de l’Epée elt
l ’inventeur, 8c dont il fait un ufage beaucoup
plus ordinaire ; je veux dire, l’art
de peindre les idées aux yeux , par des
lignes méthodiques & combinés , 8c de
mettre fes élèves en état de converfer avec
lui & entr’eux, dans ce langage vifible ,
& de l’exprimer par les caraéleres de l’écriture.
Il joint à une pratique confommée de
ce bel art, un zèle fi défintéreffé & même
fi généreux , une patience 8c un courage
tellement à l’épreuve des plus grandes difficultés
, que les prodiges qu’il opère ne font
pas moins l’ouvrage de la vertu que des
talens. On fort de chez lui également attendri
& étonné de ce qu’il fait en faveur d’une
jeuneffe intéreffante , qu’une nature disgraciée
eût ravie fans retour au commerce
de la fociété (é), *
Ages de la vie »
On ne confidère la durée de la vie que
du moment de la naiffance de l’Homme &
des animaux ; cependant, ils vivent avant
de naître , dès qu’ils font dans l’état d’embryon
ou de foetus ; c’eft pourquoi je vais
placer ces deux époques de la vie avant
celle de l’enfance.
L'Embryon;
Je donne le nom d’embryon au corps
humain & aux animaux, dans les premiers
jours de leur exiftence dans la matrice ,
avant qu’ils aient pris la figure qui ell
propre à leur efpèce. L’embryon n’eft
n’abord qu’une goutte de gelée blanche ,
fi molle qu’elle fe liquéfié fous le doigt.
Hartman prétend avoir vu un embryon
qui n’étoit pas plus gros qu’une graine de
pavot ; & Rhuyfch , un autre de la grof-
feur d’une tête d’épingle ordinaire; Graaf
rapporte qu’il a trouv é, dans une lapine,
de petits embryons qui n’atsoient point
encore d’adhérence avec la matrice , 8c
que l’on faifoit rouler fur fes parois.
On croit que trois ou quatre jours
après la conception il y a dans la matrice
de la femme une bulle ovale , dont le
grand diamètre a au moins fept lignes, &
le petit quatre lignes ; elle ell formée par
çme membrane très - fine , qui renferme
une liqueur pareille à du blanc d’oeuf :
on a vu dans cette liqueur quelques fibres
réunies , qui font les premiers linéamens
de l’embryon.
(a) Inftitution des Sourds & Muets. Paris 3 1776.
(Sj Extrait en grande partie de la Phyfioiogie de M. Haller.
Sept jours après la conception, la tête
de l’embryon& le tronc qui ell plus délié 8c
plus long que la tête , commencent à pa-
roître, comme dans l’oeuf , au bout de
vingt-quatre heures d’incubation. Haller
a obfervé que, dans les embryons d’une
chienne , d’une lapine & d’une brebis, la
tête étoit à proportion plus grolfe que le
tronc , comme dans l’embryon humain.
On dillingue, dans un embryon de quinze
jours, les traits les plus apparens du vifage.
Le nez ell comme un filet proéminent 8c
perpendiculaire à une ligne qui indique
la féparation des lèvres. Il n’y a que deux
points noirs à l’endroit des yeux , 8c deux
petits trous à l’endroit des oreilles. Les
bras 8c les jambes ne paroiffent que fous
la forme de petites protubérances.
Au dix-neuvième jou r , Haller a v u ,
dans les embryons d’une chienne 8c d’une
brebis, le coeur marqué par trois taches,
rouges. Un des élèves de Haller a dit
avoir vu le coeur , dans l’embryon d’une
brebis , au vingt-unième jour.
A une. femblable époque , Sylvius v it
l’embryon d’une vache , dont toutes les
parties étoient apparentes.
Au vingt - deuxième jour , Kuhleman
obferva que l’embryon d’une brebis étoit
courbé ; fa bouche etoit ouverte ; il avoit
les jambes courtes, larges- 8c peu faillantes
hors de la peau ; le coeur étoit tranfparent,
triangulaire 8c rouge. On appercevoit le
foie. On voyoit dans un autre embryon,
à-peu-près de même âge, des indices des
vertèbres , du cerveau 8c du crâne , les
narines, les y e u x , la langue & les oreilles ;
les pieds commençoient à paroître.
Au vingt - fixième jo u r , les vertèbres
étoient apparentes & les pieds fourchus ;
on appercevoit les inteftins.
Au vingt-huitième jou r, la peau recou-
vroit l’embryon en entier & le diaphragme
étoit formé. Graaf 8c Everard ont fait à
peu près les mêmes obfervations fur des
embryons de lapines.
Le Foetus.
Lorfque toutes les parties de l’embryon
font apparentes, on peut lui donner le nom
de foetus. Quoiqu’il arrive rarement que
l’on foit allez fur de l’âge des embryons
humains que l’on peut obferver, pour marquer
l’époque de la formation de leurs différentes
parties , cependant plufieurs Ana-
tomilles ont reconnu qu’au trentième jour
l’embryon étoit affez formé pour être confi-
déré comme foetus. Epiphanius, du Laurent,
Stahl, Riolan, &c . s’accordent fur ce fujet.
Le foetus de l’Homme 8c de tous les quadrupèdes
, ell enveloppé par le chorion 8c
parl’amnios, qui contient une liqueurfluide,
depuis la première formation de l’embryon
jufqu’à la naiffance de l’enfant. Cette liqueur
exille même dans l’Homme & dans les quadrupèdes
, avant que l’embryon ne foit
vifible.
La liqueur de l’amnios ell d’autant plus
abondante , que l’embryon ell plus petit.
On en a trouvé trois ou quatre onces lorf-
qu’un embryon n’étoit pas plus gros qu’une
fourmi, 8c une livre & demie , tandis que
l’embryon d’une vache ne pefoit que onze
onces. On croit qu’à trois mois le poids
du foetus humain commence à furpaffer le
poids de la liqueur de l’amnios. Il n’y en a
guère plus de deux livres près du terme de
la groffeffe , lorfque le foetus pèle huit
livres. Cette liqueur ell réduite à une
petite quantité à la fin de la groffeffe de
quelques femmes , 8c lorfque certaines
femelles d’animaux mettent bas ; il n’y en
a point du tout à ce terme dans les lapines.
Le foetus tient â fes enveloppes par le
cordon'ombilical, auquel il eft lui-même
attaché par l’endroit du nombril. On n’a
jamais vu d’embryon ou de foetus d’homme
ou de quadrupèdes, &c. dont le cordon
ombilical ne fut apparent- ; on l’a reconnu
fur des embryons qui n’étoient pas plus
gros qu’une fourmi : l’embryon ne peut
exiller avant le cordon , puifqu’il en reçoit
fa nourriture. Suivant Mauriceau , la longueur
du cordon ombilical eft de deux
pieds neuf pouces lorfque le foetus a pris
tout fon accroiffement; mais cette longueur
varie : il y a des cordons ombilicaux très-
courts ; d’autres ont jufqu’à quatre pieds :