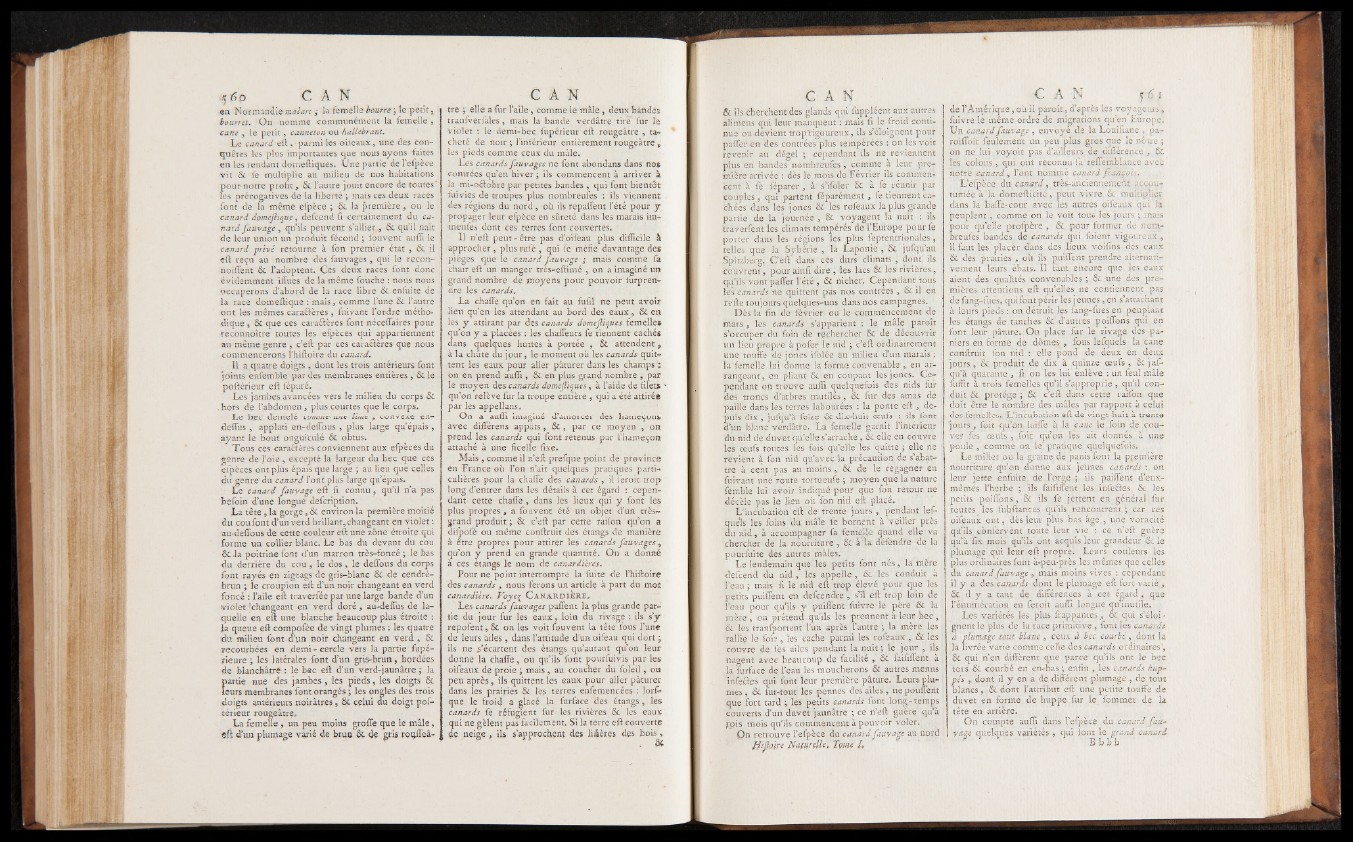
6 p C À N
en Normandie màlart ,• la femelle bourre ; le petit,
bourret. On nomme communément la femelle ,
cane , le petit, canneton o\x hallebrant.
Le canard eft . parmi les oiieaux, une des conquêtes
les plus importantes que nous ayons faites
en les rendant domeftiques. Ùne partie de l’efpèce
vit & le multiplie au milieu de nos habitations
pour- notre profit, & l’autre jouit encore de toutes* les prérogatives de la liberté ; mais ces deux races
font de la même .efpèce ; 8c la première , ou le
canard domeftique, defcend fi certainement du canard
fauvage , qu’ils peuvent s’allier , & qu’il naît
de leur union un produit fécond ; fouvent aufli le
canard privé retourne à fon premier état , 8c il
eft reçu au nombre des fauvages, qui le recon-
rioiffent 8c l’adoptent. Ces deux races font donc
évidemment iffues de la thème fouche : nous nous
«occuperons d’abord de la race libre & enfuite de
la race domeftique : mais, comme l’une 8c l’autre
ont les mêmes cara&ères , fuivant l’ordre méthodique
, & que ces cara&ères font néceffaires pour
reconnoître toutes les efpèces qui appartiennent
au même genre , ç’eft par ces caractères que nous
commencerons l’hiftoire du canard.
Il a quatre doigts , dont les trois antérieurs font
joints enfemble par des membranes entières , & le
poflérieur eft féparé,
Les jambes avancées vers le milieu du corps &
.hors de l’abdomen, plus courtes que le corps.
Le b.ec dentelé commet une lime 3 convexe en-_ defîus , applati en-deffous , plus large qu’épais,
ayant le bout onguiculé 8c obtus.
Tous ces caraatères conviennent aux efpèces du
genre de l’oie, excepté la largeur du bec que ces
efpèces ont plus épais que large ; au lieu que celles
du genre' du canard l’ont plus large qu’épais.
Le canard fauvage eft ft connu, qu’il n’a pas befoin d’une longué defcription.
La tête, la gorge, 8c environ la première moitié
du cou font d’un ver d brillant, changeant en violet :
au-defïous de cette couleur eft une zone étroite qui
forme un collier blanc. Le bas du devant du cou
& -la poitrine font d’un marron très-foncé ; le bas
du derrière du cou , le dos, le deflous du corps
font rayés en zigzags de gris-blanc 8c de cendré-
brun ; le croupion eft d’un noir changeant en verd
foncé : l’aile eft traverféepar une large bande d’un
violet échangeant en verd doré, au-deffus de laquelle
en eft une blanche beaucoup plus étroite :
Ja queue eft compofée de vingt plumes : les quatre
du milieu font d’un noir changeant en verd , 8c
recourbées en demi-cercle vers la partie fupé-
tieure ; les latérales font d’un gris-brun, bordées
de blanchâtre : le bec eft d’un verd-jaunâtre ; la
partie nue des jambes, les pieds, les doigts 8c
leurs membranes font orangés y les ongles des trois
doigts antérieurs noirâtres, 8c celui du doigt ppf-
térieur rougeâtre,
La femelle , un peu moins groffe que le mâle,
«ft d’un plumage varié de brun 8c de gris roqffeâ-
C A N
tre ; elle a fur l’aile, comme le mâle, deux bàndes
tranfverfales, mais la bande verdâtre tire fur le
violet : le demi-bec fupérieur eft rougeâtre , tacheté
de noir ; l’inférieur entièrement rougeâtre ,
les pieds comme ceux du mâle.
Les canards fau va ge s ne font abondans dans nos
contrées qu’en hiver ; ils commencent à arriver à
la mi-oâobre par petites bandes , qui font bientôt
fui vies de troupes plus nombréufes : ils viennent
des régions du nord , où ils repaffent l’été pour y
propager leur efpèce en sûreté dans les marais im-
•menfes dont ces terres font couvertes.
Il n’eft peut - être pas d’oifeau plus difficile à
approcher , plus mfé , qui fe méfie davantage des
pièges que le canard fa u va g e ; mais comme fa
chair eft un manger très-eftimé , on a imaginé un
grand nombre de moyens pour pouvoir furpren»
dre les canards,
La chafle qu’on en fait au fufil ne peut avoir
lieu qu’en les attendant au bord des eaux, 8c en
les y attirant par des canards domejliques femelles
qu’on y a placées : les chaffeurs fe tiennent cachés
dans quelques huttes à portée , 8c attendent t
à la chûte du jour, le-moment où les canards quittent
les eaux pour aller pâturer dans les champs-;
on en prend aufli, 8c en plus grand nombre , par
le moyen des canards domejliques, à l’aide de filets ■
qu’on relève fur la troupe entière , qui a été attirée
par les appelons.
On a aufli imaginé d’amorcer des hameçons
avec différens appâts, 8c . par ce moyen , ont
prend les canards qui font retenus par l’hameçon
attaché à une ficelle fixe.
Mais , comme il n’eft prefque point de province
en France où l’on n’ait quelques pratiques particulières
pour la chafle des canards , il feroit trop
long d’entrer dans les détails à cet égard : cependant
cette chafle , dans les lieux qui y font les
plus propres, a fouvent été un objet d’un très-
grand produit ; 8c c?eft par cette raifon qu’on a
aifpofé ou même conftruit des étangs de manière
à être propres pour attirer les canards fa u v a g e s ,
qu’on y prend en grande quantité. On a donné
à ces étangs le nom de canardiéres.
Pour ne point interrompre la fuite de l’hiftoir*
des canards , nous ferons un article à part du mot
canardiére. Voy e£ CanardiÈRE,
Les canards fa u v a g e s paffent la plus grande partie
du jour fur lès eaux, loin du rivage : ils s’y
repofent, 8c on les voit fouvent la tête fous l’une
de leurs ailes , dans l’attitude d’un oifeau qui dort y
ils ne s’écartent des étangs qu’autant qu’on leur
donne la chafle, ou qu’ils font pourfuivis par les
oifeaux de proie y mais , au coucher du foleil, ou
peu après, ils quittent les eaux pour aller pâturer
dans les prairies 8c les terres enfemencées : lorsque
le froid a glacé la furface des étangs, les
canards fe réfugient fur les rivières 8c les eaux
qui ne gèlent pas facilement. Si la terre eft couvert*
de neige L> ils s’approchent des Mères des bois,
C A N
& ils cherchent des glands qui fuppléent aux autres
alimens qui leur manquent : mais fi le froid continue
ou devient trop "rigoureux, ils s’éloignent pour
paffer en des contrées plus tempérées : on les voit
revenir au dégel ; cependant ils ne reviennent
plus en bandes nombreufes, comme à leur pre^ j
mière arrivée : dès le mois de Février ils commencent
à fe féparer , à s’ifoler 8c à fe réunir par
couples , qui partent féparément , fe tiennent cachées
dans les joncs 8c les rbféaux la plus grande
partie de la journée > 8c voyagent la nuit : -ils
traverfent les climats tempérés de l’Europe pour fe
porter dans les régions les plus fe-ptentrionales ,
telles que la Sÿberiê , la Laponie , 8c jufqu’au
Spitzberg. C’eft dans ces durs climats , dont' ils
couvrent, pour ainfi dire , les lacs 8c les r iv iè r e s ,
qu’ils vont paffer l’été , 8c nicher. Cependant tous
\os'canards,Jnz quittent pas nos contrées , 8c il en
refte toujours quelques-uns dans nos campagnes.
Dès la fin de février, ou le commencement de
mars, les canards s’apparient : le mâle paroît
s’occuper du foin de rechercher 8c de découvrir
un lieu propre à pofer le nid ; c’eft ordinairement
une touffe de joncs ifolée au milieu d’un marais : -■
la femelle lui donne là forme convenable , en arrangeant,
en pliant 8c en coupant les joncs. Ce- ,
pendant on trouve aufli quelquefois des nids fur
des tronçs d’arbres mutilés, 8c fur des amas de
paille dans les terres labourées : la ponte eft ^ depuis
dix, jufqü’à feize 8c dix-huit oeufs : ils font
d’un blanc verdâtre. La femelle garnit l’intérieur
du nid de duvet qu’elle s’arrache , & elle en couvre
les oeufs toutes les fois qu’elle les quitte ; elle ne ’
revient a fon nid qu’avec la précaution de s’abattre
à cent pas au moins, 8c de le regagner en
fuivant une route tortueufe ; moyen que la nature
femble lui avoir indiqué pour que fon retour ne
décèle pas le lieu où fon nid eft placé.
L’incubatiôiveft de trente jours , pendant lesquels
les foins du mâle fe bornent a'veiller près
du nid, à accompagner fa femelle quand elle va
chercher de la nourriture , 8c â^la défendre de la
pourfuite des autres mâles.
Le lendemain que les petits font nés, la mère
defcend du nid , les appelle, 8c les conduit a
l’eau ; mais fi le nid eft trop élevé pour que les
. petits puiffent en defcendre , s’il eft trop loin de
l’eau pour qu’ils y puiffent fuivre le père 8c la
mère, on prétend qu’ils, les prennentà leur bec , 8c les traniportent l’un après l’autre ; la mère les
rallie !e foir, les cache parmi les rofeaüx , 8c les
couvre de fes ailes pendant la nuit ; le jour , ils
nagent avec beaucoup de facilité , 8c faififfent a
la furface de l’eau les moucherons & autres menus
infe.ftes qui font leur première pâture. Leurs plumes
, 8c fur-tout les pennés des ailes, ne pouffent
que fort tard ; les petits canards font long--temps
couverts d’un duvet.jaunâtre ; ce n’eft guère qu’à
jjpis mois qu’ils commencent à pouvoir voler.
Qn retrouve l’efpèce du canard fau va ge au nord
ffiflo f/ e N a tu re lle , Tome /,
•C A N j f> i
de l’Amérique, où il paroît, d’après les voyageurs,
fuivre le même ordre de migrations qu’en Europe.'
Un canard fa u v a g e , envoyé,de la Louifiane , pa~
roiffoit feulement un pëu plus gros que le nôtre ;
on ne lui voyoit pas d’ailleurs de différence , 8c
les colons , qui ont reconnu là reffemblance avec
notre c a n a r d , l’ont nommé canard f r a n c ois.
L’efpèce, du canard , très-anciennement, acçpu?
tumée à "la domeftîçit.é, peut vivre. 8c multiplier
dans la baffe-cour avec les autres oifeaux qui la
peuplent, comme on le voit tous les jours ; mais
pour qu’elle profpère , 8c pour former de no.m-
breufes bandes, dq canards qui foient vigoureux,
il faut , les placer dans des lieux voifins dès eaux 8c des prairies , .où ils puiffent prendre alternativement
leurs ébats. Il faut encore que les eaux
aient des qualités convenables'; 8c une des premières
attentions eft qu’elles ne contiennent pas
de fang-fues, qui font périr les jeunes, en s’attachant
à leurs pieds :. on détruit les fang-fues en peuplant
les étangs de tanches 8c d’autres poiffons qui en
font leur pâture. On placé fur le rivage des paniers
en forme de dômes, , fous lesquels la Cane
conftruit fon nid : elle pond de deux en deux
jours., 8c produit de dix à quinze oeufs, 8c juf-
qu’à quarante , fi on les lui enlève : un feul mâle
fuffit à trois femelles qu’il s’ approprie , qu’il conduit
8c. protège'; 8c c’eft dans cette raifon. que
doit être le nombre des mâles par rapport à celui
des femelles. L’incubation eft de v.ingt-huit à trente
jours, foit qu’on laiffe à la cane le,foin de couver
fes 'oeufs , foit qu’on lés ait donnés à une
p'oule , comme on le' pratique quelquefois.
Le millet .bu la graine de panis font la première
nourriture qu’on donne aux jeunes canards : on
leur jette enfuite, de l’orge •; ils paiffent d’eux-
mêmes l’herbe ; " ils faififfent le,s. infeftes 8c les
petits, poiffons,, & ils fe jettent en général fur
toutes les ffubftancésl: qu’ils rencontrent ; car ces
oifeaux ont, dès Jeur plus bas âge , une voracité
qu’ils cônfervént toute leur vie : ce n’eft guère
qu’à fix mois qu’ils ont acquis leur grandeur ,8c le
plumage qui leur eft propre’. Leurs couleurs les
plus ordinaires font à-peù-près les mêmes que celles
du canard fa u v a g e , mais moins vives : cépendant
il y a des canards dont le plumage eft fort varié,, 8c il y a tant de différences à cet égard , que
l’énumération en feroit aufli longue qu’inutile.
Les variétés les plus frappantes, 8c qui s’éloignent
le plus de la race primitive., font les canards
à plumage tout blanc , ceux à bec cou rb é , dont la
là livrée varie comme celle des canards ordinaires’, 8c qui n’en diffèrent que parce qu’ils ont le bec
tors. 8c courbé en en-bas, ; enfin , les canards h upp
és , dont il y en a de. différent plumage , de tout
blancs, 8c dont l’attribut eft une petite touffe de.
duvet en forme de huppe fur le fommet de la
tête en arrière.
On compte aufli dans l’efpèce du canard fauvage
quelques variétés , qui font le grand canard
B b b b