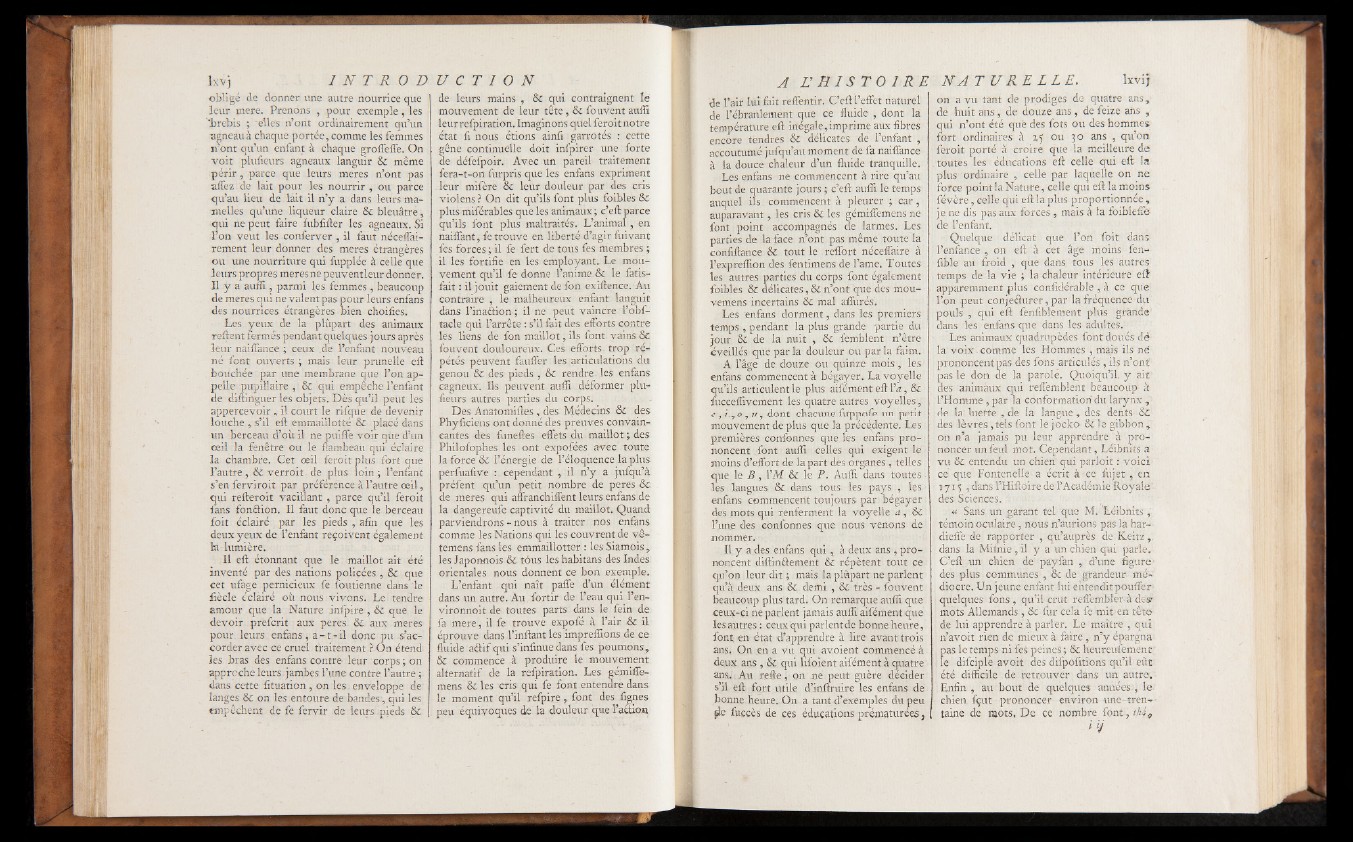
obligé de donner une autre nourrice que
leur mere. Prenons , pour exemple, les
Ibrebis ; 'elles n’ont ordinairement qu’un
agneau à chaque portée, comme les femmes
iront qu’un enfant à chaque groffeffe. On
voit plufieurs agneaux languir & même
périr , parce que leurs meres n’ont pas
alfez de lait pour les nourrir , ou parce
qu’au lieu de lait il n’y a dans leurs mamelles
qu’une liqueur claire & bleuâtre,
qui ne peut faire fubfifter les agneaux. Si
l ’on veut les conferver , il faut néceffai-
rement leur donner des meres étrangères
ou une nourriture qui fupplée à celle que
leurs propres meres ne peuventleur donner.
Il y a auffi , parmi les femmes, beaucoup
de meres qui ne valent pas pour leurs enfans
des nourrices étrangères bien choifies.
Les yeux de la plupart des animaux
relient fermés pendant quelques jours après
leur naiffance ; ceux .de l’enfant nouveau
né font ouverts ; mais leur prunelle eft
bouchée par une membrane que l’on apr
pelle pupillaire , & qui empêche l’enfant
de difîinguer les objets. Dès qu’il peut les
appercevoir, il court le rifque de devenir
louche , s’il eft emmaillotté & placé dans
un berceau d’où il ne puiffe voir que d’un
oeil la fenêtre ou le flambeau qui éclaire
la chambre. Cet oeil feroit plus fort que
l ’autre , & verroit de plus loin ; l’enfant
s’en ferviroit par préférence à l’autre oe il,
qui refteroit vacillant , parce qu’il feroit
fans fonction. Il faut donc que le berceau
foit éclairé par les pieds , afin que les
deux yeux de l’enfànt reçoivent également
la-lumière.
Il eft étonnant que le maillot ait été
inventé par des nations policées , & que
cet ufage pernicieux fe foutienne dans le
fiècle éclairé où nous vivons. Le tendre \
amour que la Nature infpire., & que le
devoir prefcrit aux peres & aux meres
pour, leurs enfàns ,-a-t.*il donc pu s’accorder
avec ce cruel traitement ? On étend
les bras des enfans contre leur corps; on
approche leurs jambes l’une contre l’autre ;
dans cette fituation , on les; enveloppe de
langes & on les entoure de bandes', qui les
empêchent de fe fervir de leurs -pieds &
de leurs mains , & qui contraignent le
mouvement de leur tê te , & fouvent auffi
leurrefpiration. Imaginons quel feroit notre
état fi nous étions ainfi garrotés : cette
gêne continuelle doit infpirer une forte
de défefpoir. Avec un pareil traitement
fera-t-on furpris que les enfans expriment
leur mifère & leur douleur par des cris
violens ? On dit qu’ils font plus foibles &C
plusmiférables que les animaux; c’eft parce
qu’ils font plus maltraités. L’animal , en
naiffant, fe trouve en liberté d’agir fuivant
fes forces; il fe fert de tous fes membres ;
il les fortifie en les employant. Le mouvement
qu’il fie donne l’anime & le fatis-
fait : il jouit gaiement de fon exiftence. Au
contraire , le malheureux enfant languit
dans l ’inaâion-; il ne peut vaincre l’obf-
tacle qui l’arrête ; s’il fait des efforts contre
les liens de fon maillot, ils font vains &
fouvent douloureux. Ces efforts, trop répétés.
peuvent fauffer les articulations du
genou & des pieds , & rendre les enfàns
cagneux. Ils peuvent auffi déformer plufieurs
autres parties du corps;
Des Anatomiftes, des Médecins Sc des
Phyficiens ont donné des preuves convaincantes
des fùneftes effets du maillot ; des
Philofophes les ont expofées avec toute
la force & l’énergie de. l’éloquence la plus
perfuafive cependant , il n’y a jufqu’à
préfent qu’un petit nombre de peres SC
de meres qui aftranchiffentleursenfans.de
la dangereufe captivité du maillot. Quand
parviendrons - nous à traiter nos enfans
comme les Nations qui les couvrent de vê-
temens fans les emmaillotter : les Siamois,
les Japonnois & tôus leshabitans des Indes
orientales nous donnent ce bon exemple.
L’enfant qui naît paffe d’un élément
dans un autre. Au, fortir de l’eau qui l’en-
vironnoit de toutes parts dans le fein de
fa mere, il fe trouve expofé à l’air & il
éprouve dans l’inftant les impreffions de ce
fluide a â if qui s’infinue dans fes poumons,
& commence à produire le mouvement
alternatif de la refpiration. Les gémiffe-
mens & les cris qui fe font.entendre dans
le moment qu’il refpire, font des fignes
peu équivoques de" la douleur que l’aüioii
de l’air lui fait reffentir. C ’eft l’effet naturel
de l’ébranlement que ce fluide , dont la
température eft inégale,imprime aux fibres
encore tendres & délicates de l’enfant ,
accoutumé jufqu’au moment de fa naiffance
à la douce chaleur d’un fluide tranquille. ’
Les enfans ne commencent à rire qu’au
bout de quarante jours ; c’eft auffi le temps
auquel ils commencent à pleurer ; c a r ,
auparavant, les cris & les gémiffemens ne
font point accompagnés de larmes. Les
parties de la face n’ont pas même toute la
confiftance & tout le reffort néceffaire à,
l ’expreffion des fentimens de l’ame. T o u te s .
les autres parties du corps font également
foibles & délicates, & n’ont que des mou-
vemens incertains & mal affûtés.
Les enfans dorment, dans les premiers
temps , pendant la plus grande partie du
jour & de la nuit , & femblent n’être
éveillés que par la douleur ou par la faim.
A l’âge de douze ou quinze m o is , les
enfans commencent à bégayer. La v o y e lle
qu’ils articulent le plus aifément eft Y a , &
fucceffivement les quatre autres v o y e lle s ,
e , i_,o, a, dont chacune fitppofe un petit
mouvement de plus que la précédente. Les
premières confonnes. que. les enfans prononcent
.font auffi celles qui exigent lé
moins d’effort de la part dès organes, telles
que le B , YM & le P. Auffi dans toutes,
les langues & dans tous, les pays , les -
enfans commencent toujours par bégayer
dés mots qui renferment la v o y e lle a , &
l’une des confonnes que nous venons de
nommer.
Il y a.des enfans q u i, à deux ans, prononcent
diftindlement & répètent tout ce
qu’on leur dit ; maïs la plupart ne parlent
qu’à deux ans & demi , & très - fouvent
beaucoup plus tard. On remarque auffi que
ceux-ci ne parlent jamais aulfi aifément que
les autres : ceux qui parlentde bonne heure,
font; en état d’apprendre à lire avant trois
ans. On en a vu qui .avoient commencé à
deux ans , & qui lifoient aifément à quatre
ans.:. Au refte, on ne peut guère décider
s’il eft fort utile d’inftruire les enfans de
bonne heure. On a tant d’exemples du peu
fie fuccès de ces éducations prématurées 3
on a vu tant de prodiges de quatre ans,
de huit ans , de douze ans, de feize airs ,
qui n’ont été que des fots ou des hommes
fort ordinaires à 2,5 ou 30 ans , qu’on
feroit porté à croire que la meilleure de
toutes les éducations eft celle qui eft la
plus ordinaire , celle par laquelle on ne
force point la Nature, celle qui eft la moins
févère, celle qui eft la plus proportionnée,
je ne dis pas aux forces, mais à la foibleff®
de l’enfant.
Quelque délicat que l’on foit dans
l’enfance , on eft à cet âge moins fen-
fible au froid , que dans tous les autres .
temps de la vie ; la chaleur intérieure eft
apparemment plus confidérable , à ce que
l’on peut conjecturer, par la fréquence du
pouls , qui eft fenfibiement plus grande
dans les enfans que dans les..adultes/--
Les animaux quadrupèdes font doués dé
la v o ix . comme les Hommes , mais ils në
prononcent pas des fions articulés, ils n’ont
pas le don de la parole. Quoiqu’il, y ait’
des animaux qui reffemblent beaucoup à
l’Homme , par la conformation du larynx ,
de la luette , de la langue , des dents &
des lèvres ,tels font le jocko & le gibbon,
on n’a jamais pu leur apprendre à prononcer
unfeul mot. Cependant, Léibmts a
vu & entendu un chien qui parloit : voici
ce que Fontenelle a écrit à-ce fujet , en
1715 , dans l’Hiftoire de l’Académie Royale'
des Sciences. -
« Sans un garant tel que M. Léibnits ,.
témoin oculaire, nous n’aurions pas la hat—
diefiè de rapporter , qu’auprès de Keitz
dans la Mifnie , il y a un chien qui parle.
G’eft un chien de payfan , d’une figure ■
des plus communes , & de .grandeur médiocre.
Un jeune enfant lui entendit pouffer
quelques fons., qu’il crut refîèmbler à de®
mots Allemands , & fur cela fe mit en tête
de lui apprendre’ à parler. Le maître , qui
n’avoit rien de. mieux à faire, n’y épargna
pas le temps ni fes peines ; & heureufement '
: le difciple avoit des difpofitions qu’il eût
été difficile de retrouver dans un autre.
Enfin , au bout de quelques années-, le
chien fçut prononcer environ une ■ tren- ■
taine de mots, De ce nombre font , thî9
| f