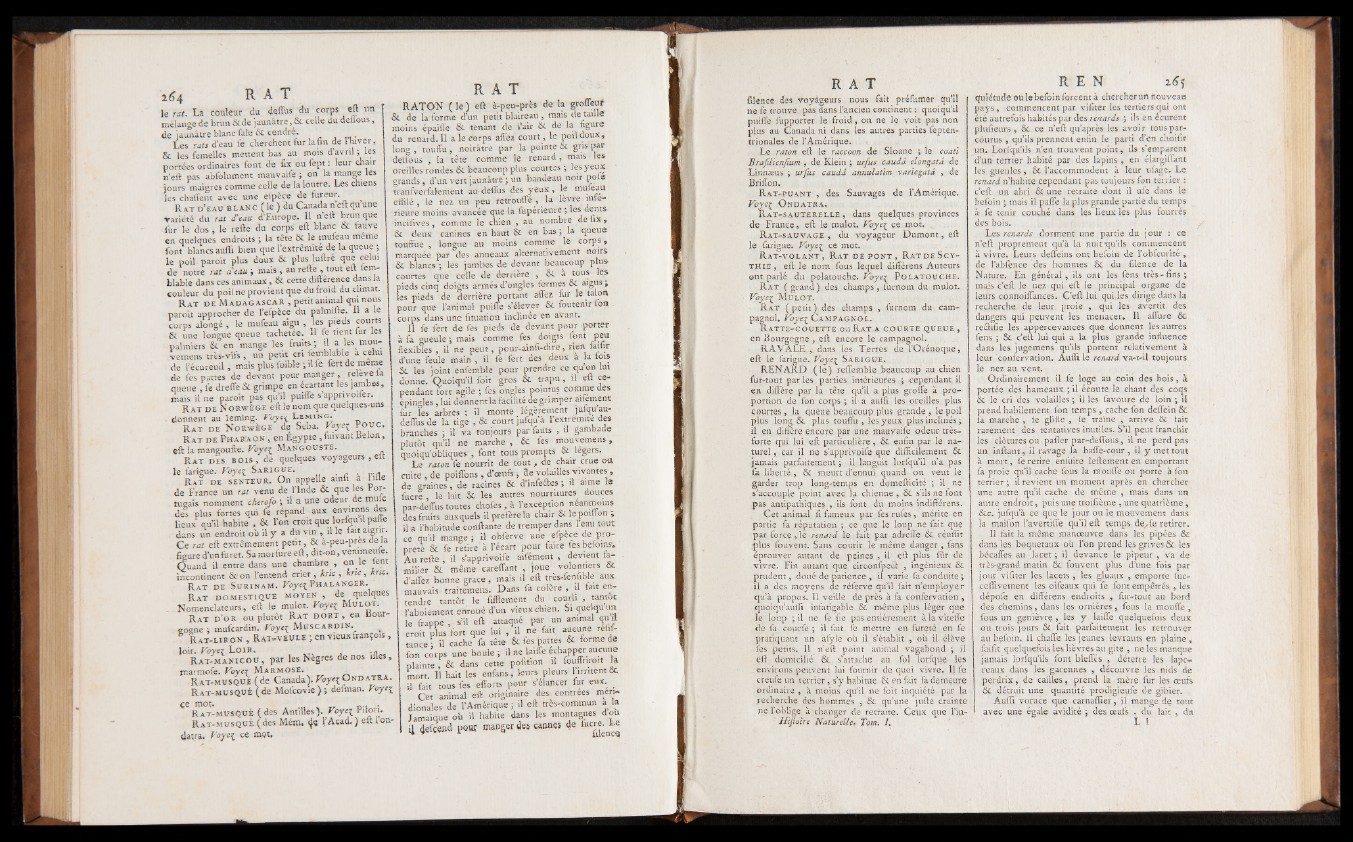
2 ^ 4 R A T
le rat. La couleur du deffus du corps eft un
mélange de brun &de jaunâtre, & celle du deflous,
de jaunâtre blanc fate &• cendré. .
Les rats d’eau fe cherchent fur la fin de 1 hiver,
& les femelles mettent bas au mois d’avril ; les
portées ordinaires font de fix ou fept : leur chair
n’ell pas abfolument mauvaife ; on la mange les
jours maigres comme celle de la loutre. Les chiens
les chaffent avec une el'pèçe de fureur. _
R at d ’ e a u b l anc ( le ) du Canada n eu eu une
Variété du rat d’eau d’Europe. Il n’eft brun que
l'ur le dos , le relie du corps eft blanc & fauve
en quelques endroits ; la tête 6c le mufeau meme
font blancs aufli bien que l’extrémité de la queue ;
le poil paroit plus doux 8c plus luftre que celui
de notre rat deau ; mais , au refte . tout eft Semblable
dans ces animaux, 8c cette différence dans la
couleur du poil ne provient que du froid du climat.
R a t d e M a d a g a s c a r , petit animal qui nous
paroit approcher de l’elpèce du palmifte. Il a le
corps alongé , le mufeau aigu , les pieds courts 8c une longue queue tachetée. Il fe tient fur les
palmiers 8c en mange les fruits ; il a les mou-
vemens très-vifs , un petit cri Semblable a celui
de l’écureuil, mais plus foible ; il fe fert de meme
de fes pattes de devant pour manger, releve la
queue , lé dreffe 8c grimpe en écartant lés jambes.,
mais il ne paroit pas qu’il puiffe s’appnvoifer.
R a t d e N o rw è g e eft le nom que quelques-uns
donnent au leming. Voye^ L e m in g .
R a t d e N o rw ÈGË de Sçba. Voye^ lo u e .
R a t d e P b a r 'a o n , en Égypte, Suivant B e lo n ,
eft la mangoufte. Vbyc{ M a n g o u s t e .
R a t d e s b o i s , de quelques voyageurs , elt
le fariguer Voyeç S a r ig u e . . ,, v
R a t d e s e n t e u r . On appelle ainli a Hue
de France un rat venu de l’Inde 8c que les Portugais
nomment cherofo ; il a une odeur de mu c
des plus fortes qui fe répand aux environs des
lieux qu’il habite , 8c l’on croit que lorfqu il pafle
dans un endroit où il y a du vm , il le fait aigrir.
Ce rat eft extrêmement petit, 8c à-peu-près de la
figure d’un furet. Sa morfure eft, dit-on, vemmeule.
Quand il entre dans une chambre , on le -lent
incontinent 8e on l’entend erier , kric , kne, km.
R a t d e S u r in a m . Voye^Ph a l a n g e r .
R a t d o m e s t iq u e m o y e n , de quelques
_ N omenc la teurs, eft le mulot. Vaye^ M u l o t .
R a t d ’o r ou plutôt R a t d o r t , en üou r-
o-ogne : mufeardin. Voyez Mus c a r d in . ?
R at-liron , Rat-yeule } en vieux françois,
loir. Voyez L oir.
R a t -m a n i c o u , par les Nègres de nos mes,
inarmofe. Voyez M a r m o s e .
R a t -m u s q u é ( de Canada). Voye[ O n d a t r a .
R a t -m u s q u é (de Moicovie); deiman. Voyez
çe mot. .
R a t -m u s q u é (des Antilles). Voyei Pilon.
R a t -m u s q u é (d e s Mém. <}ç i’Açad. ) eft 1 ondatra.
Voyez ce mot»
R A T
RATON ( le ) eft à-peu-près de la grofleuf
& de la forme d’un petit blaireau , mais de taule
moins épaifle ôc tenant de i5air ôt de la figure
du renard. Il a le corps afiez court, le poil doux,
long , touffu, noirâtre par la pointe & gns par
delious , la tête comme lé renard, mais les
oreilles rondes & beaucoup plus courtes ; les yeux
grands , d’un vert jaunâtre ; un bandeau noir pôle
tranfverfalement au-deffus des yeux, le muleau
effilé, le nez un peu retrouffé , la lèvre intérieure
moins avancée que la fupérieure ; les dents
incifives, comme le chien , au nombre d eu x ,
& deux canines en haut & en bas; la queue
touffue , longue au moins comme lé corps,
marquée par des anneaux alternativement noirs ,
ôc blancs ; les jambes de devant beaucoup plus,
courtes que celle de derrière , à tous les
pieds cinq doigts armés d’ongles fermes ôc aigus ;
les pieds de derrière portant affez fur le talon
pour que l’animal puiffe s’élever ôc foutenir Ion
corps dans une fituation inclinée en avant.
Il fe fert de fes pieds de devant pour porter
à- fa gueule ; mais comme fes doigts font peu
flexibles , il ne peut, pour-ainfi-dire, rien lailir
d’une feule main , il fe fert des deux a la lois
& les joint enfemble pour prendre ce qu on lui
donne. Quoiqu’il foit gros ôc trapu, il eft cependant
fort agile ; fes ongles pointus comme des
épingles , lui donnent la facilité de grimper aifement
fur les arbres ; il monte légèrement jufquau-
deffusde la tige , & court jufqu’à l’extremite des
branches ; il va toujours par fauts , il gambade
plutôt qu’il ’ ne marche , ôc fes- mouvement,
quoiqu’obliques , font tous prompts Ôc légers.
Le raton fe nourrit de tout, de chair crue ou
cuite , de poiffons , d’oeufs , de volailles vivantes ,
de graines, de racines ôc d’infe&es ; il aime le
fucre, le lait Sc les autres nourritures douces
par-deffus toutes chofes/à l’exception néanmoins
des fruits auxquels il préféré la chair & le poillon \
il a l’habitude confiante de tremper dans 1 eau tout
ce qu’il mange ; il obferve une efpèce de propreté
ôc fe retire à l’écart pour faire fes beloins.
Au refte , il s’apprivoife aifement , devient fa- -
milier & même careffant , joue volontiers ÔC
d’affez bonne grâce, mais il eft très-fenüble aux
mauvais traitemens. Dans fa colère , il fait en-
tendre tantôt le fifflemetit du courli , tantôt
l’aboiement enroué d’un vieux chien. Si quelquuii
le frappe , s’il eft attaqué par un animal qu a
croit plus fort que lui , il ne fait aucune refif-
tance; il cache là tête 8c fes pattes & forme de
fon corps une boule ; il ne laiffe échapper aucune
plainte , 8c dans cette pofition il fouffnroit fa.
Inort. Il hait les enfans, leurs pleurs 1 irritent 8î;
U fait tous fes efforts pour s’élancer fur eux. I
Cet animal eft originaire des contrées mért»
dionales de l’Amérique ; il eft très-commun a la
Jamaïque où il habite dans les montagnes dou
1 il defeeud pouî manger des cannes de P S g
R A T
fllence des voyâgeurs nous fait préfumer qu’il
ne fe trouve pas dans l’ancien continent : quoiqu’il
puiffe fupporter le froid, on ne le voit pas non
plus au Canada ni dans les autres parties fepten-
trionales de l’Amérique.
Le raton eft le raccoon de Sloane ; le coati
Brafilienfium , de Klein ; urfus caudâ elongatâ de
Linnæus ; urfus caudâ annulatim variegatâ , de
Briffon.
R a t - p u a n t , des Sauvages de l’Amérique.
Voyeç O n d a t r a .
R a t - s a u t e r e l l e , dans quelques provinces
de France, eft le mulot. Voyez ce ipot.
R a t - s a u v a g e , du voyageur Dumont, eft
le farigue. Voyez ce mot.
R a t -v o l a n t , R a t d e p o n t , R a t d e S c y -
t h ie , eft le nom fous lequel différens Auteurs
ont parlé du polatouche. Voyez P o l a t o u c h e .
R a t ( grand) des champs , iùrnom du-mulot.
Voye^ "Mu l o t .
R a t . (petit) des champs , furnom du campagnol.
Voyez C a m p a g n o l .
R a t t e - c o u e t t e ou R a t a c o u r t e q u e u e ,
en Bourgogne , eft encore le campagnol.
RAVALE ,_ dans les Terres de l’Orénoque,
eft- le farigue. 'Voyez Sa r ig u e .
RENARD (le ) reffemble beaucoup au chien
fur-tout par les parties intérieures ; cependant il
en diffère par la tête qu’il a plus groffe à proportion
de fon corps ; ilva aufli les oreilles plus
courtes , la queue beaucoup plus grande ,. le poil
plus long ôc plus touffu , les yeux plus inclinés ;
il en diffère encore par une mauvaife odeur très-
forte qui lui eft particulière, & enfin par le naturel,
car il ne s’apprivoife que difficilement ôc
jamais parfaitement ; il languit lorfqu’il n’a pas
fa liberté, ôc meurt d’pnnui quand, on veut le
garder trop long-temps en. domefticité ; il ne
s’accouple point avec la chienne, & s’ils ne font
pas antipathiques , ils font du moins indifférens.
Cet. animal fi fameux par fes rufes, mérite en
partie fa réputation ; ce que le loup ne fait que
par force , le renard le fait par adreffe ôc réufiît
iplus fouvent. Sans courir,le même danger, fans
éprouver autant de peines , il ejft plus fur de
vivre. Fin autant que circonfpeéf 9 ingénieux ôc
prudent, doué de patience , il varie fa conduite ;
il a de.s moyens de réferve qu’il fait n’employer
qu’à propos. Il veille de près à fa confervation ,
quoi qu’aufli infatigable & même. p}us léger que
le loup ; il ne fe fie pas entièrement à la vîteffe
de fa covirfe ; il fait fe mettre en fureté en fe
pratiquant un afyle ou il s’établit ,' ou il élève
les petits. Il n’eft point animal vagabond ; il
eft domicilié ôc s’attache au fol lorfque les
environs peuvent lui fournir de quoi vivre. Il fe
creufe un terrier, s’y habitue £c en fait fa demeure
ordinaire , à moins qu’il ne foit inquiété par la
recherche des hommes , ôc qu’une jufte crainte
ne l’oblige à changer de retraite. Ceux que fiji-
Hijioire Naturelle. Tom. /.
R E N
quiétude ou lebefoin forcent à chercher un nouveau
pays, commencent par vifiter les terriers qui ont
été autrefois habités par des renards ; ils en écurent
plufieurs , & ce n’eft qu’après les avoi r tous parcourus
, qu’ils prennent enfin le parti d’en choifir
un. Lorlqu’ils n’en trouvent point, ils s’emparent
d’un terrier habité par des lapins , en élargiffant
les gueules , & l’accommodent à leur ufage. Le
renard n’habite cependant pas toujours fon terrier :
c’eft un abri ôt une retraite dont il ufe dans le
befoin ; mais il paffe la plus grande partie du temps
à fe tenir couché dans lés lieux les plus fourrés
des bois.
Les renards dorment une partie du jour : ce
n’eft proprement qu’à la nuit qu’ils commencent
à vivre. Leurs deffeins ont befoin de l’obfcurité ,
de l’abfçnce des hommes ôc du filence de la
Nature. En général , ils ont les fens très-fins;
mais c’eft le nez qui eft le principal organe de
leurs connoiffances. C’eft lui qui,les dirige dans la
recherche de leur proie , qui les avertit des
dangers qui peuvent les menacer. Il affure 6c
re&ifie les apperceyahces que donnent les autres
fens ; Sc c’eft lui qui a la plus grande influence
dans les jugemens qu’ils portent relativement à
leur confervation. Aufli le renard va-t-il toujours
le nez au vent.
Ordinairement i l . fe loge au coin des bois , à
portée des hameaux ; il écoute le chant des coqs
& le cri 'des volailles ; il les- favoure de loin ; il
prend habilement, fon temps , cache fon deffein ôc
la marche , fe gliffe , fe traîne , arrive & fait
rarement des tentatives inutiles. S’il peut franchir
les clôtures ou paffer par-deffous, il ne perd pas
un inftant, il ravage la baffe-cour , il y met tout
à mort, fe retire enfuite leftement en emportant
fa proie qu’il cache fous la moufle ou porte à fon
terrier; il revient un moment après en chercher
une autre qu’il cache de même , mais dans un
autre endroit, puis une troifième , une quatrième ,
& g. jufqu’à çe que le jour ou le mouvement dans
la maifon Tavertiffe qu’il eft temps de/fe retirer.
Il fait la même manoeuvre dans les pipées ôc
dans les boquetaux où l’on prend les grives & les
bécaffes au .lacet; il devance le pipeur , va de
très-grand matin ôc fouvent plus d’une fois par
jour vifiter les lacets , les gluaux , emporte fuc-
çeflivement les oifeaux qui fe font empêtrés., les
i dépofe en différens endroits , fur-tout au bord
des chemins, dans les ornières, fous la moufle ,
fous un genièvre, les y laiffe quelquefois deux
ou trois jours & fait parfaitement les retrouver
au befoin. Il çhaffe les jeunes levrauts en plaine ,
faifit quelquefois les lièvres au gite , ne les manque
jamais lorlqu’ils font bleffés , déterre les lapereaux
dan? les garennes , découvre les nids de
perdrix, de cailles, prend la mère fur les oeufs
ôc détruit une quantité prodigieufe de gibier.
Aufli vorace que carnaflàer, il mange de tout
avec une égale avidité ; des oeufs . du lait , du
L i