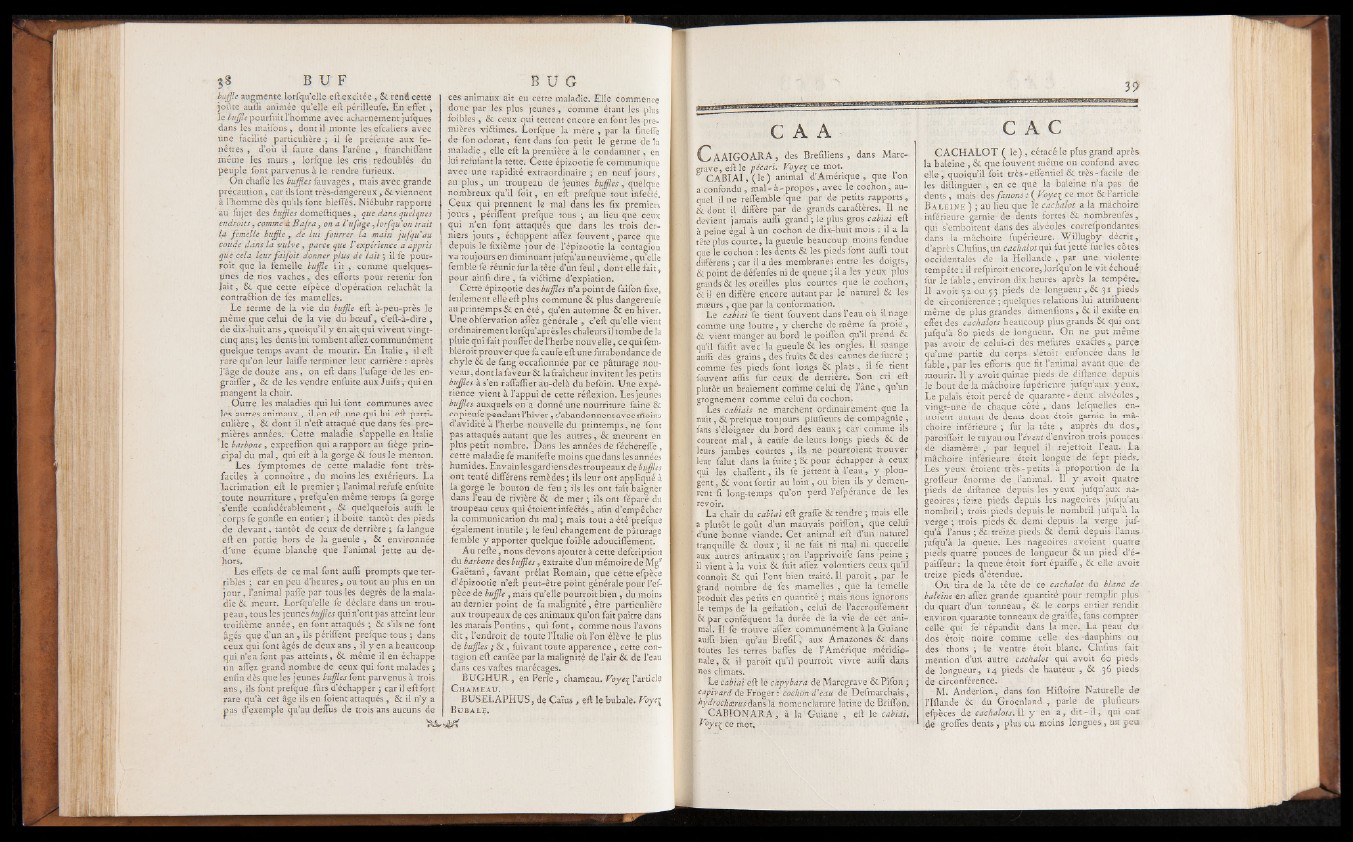
buffle augmente, lorfqu’elle eft excitée , & rend cette
joute auiîi animée qu’elle eft périlleufe. En effet ,
le buffle pourfuit l’homme avec acharnement jufques
dans les maifons , dont il monte les efcaliers avec
une facilité particulière ; il fe préfente aux fenêtres
, d’où il faute dans l’arêne , franchiffant
même les murs , lorfque les cris ; redoublés du
peuple font parvenus à le rendre furieux.
On chalfe les buffles fauvages , mais avec grande
précaution, car ils font très-dangereux g ÔL viennent
à l’homme dès qu’ils font blefles. Niébuhr rapporte
au fujet des buffles domeftiques , que dans quelques
endroits, comme à Bajra, on a l ’ufage, lorfqu'on trait
la femelle buffle t de lui fourrer la main jufqu'au
çoude dans la vulve , -parce que Vexpérience a appris
que cela leur faifoit donner plus de lait ; il fe pour-
roit que la femelle buffle fît ., comme quelques-
unes de nos vaches , des efforts pour retenir fon
Jait, & que cette efpèce d’opération relâchât la
contraction de fes mamelles.
Le terme de la vie du buffle eft à-peu-près le
même que celui de la vie du boeuf, c’eft-à-dire ,
de dix-huit ans , quoiqu’il y en ait qui vivent vingt-
cinq ans; les dents lui tombent affez communément
quelque temps avant de mourir. En Italie, il eft
rare qu’on leur laifTe terminer leur carrière : après
J’âge de douze ans, on eft dans l’ufage de les en-
graiffer, & de les vendre enfuite aux Juifsy qui en
jnangent la chair.
Outre les maladies qui lui font communes avec
Jes autres animaux , il en eft. une qui lui eft particulière
, §£ dont il n’eft attaqué que dans fes-pre-
jnières années. Cette maladie s’appelle en Italie
le barbçne , exprelBon qui a rapport au liège principal
du mal, qui eft à la gorge & fous le menton.
Les fymptomes de cette maladie font très-
faciles à eonnoître , du moins lés extérieurs. La
lacrimation eft le premier ; l’animal refufe enfuite
toute nourriture , prefqu’en même temps fa gorge
s’enfle confidérablement, & quelquefois aulli le
'corps fe gonfle en entier'; il boîte tantôt des pieds
de devant, tantôt de ceux de derrière ; fa langue
eft en partie hors de la gueule , & environnée
d’une éçume blanche que l’ànimal jette au dehors,
Les effets de ce mal font aufïi prompts que terribles
; car en peu d’heures, ou tout au plus en un
jour, l’animal paffe par tous les degrés de la maladie
& meurt. Lorfqu’elle fe déclare dans un troupeau
, tous les jeunes buffles qui n’ont pas atteint leur
troifième année , en font attaqués ; & s’ils ne font
âgés que d’un an , ils périffent prefque tous ; dans
ceux qui font âgés de deux ans , il y en a beaucoup
qui n’en font pas atteints, (k. même il en échappe
un affez grand nombre de ceux qui font malades ;
enfin dès que les jeunes buffles font parvenus à trois
ans, ils font prefque fûrs d’échapper ; car il eft fort
rare qu’à cet âge ils en foient attaqués , & il n’y a
pas d’exemple qu’au diffus de trois ans aucuns de
ces animaux ait eu cette maladie. Elle commence
donc par les plus jeunes , comme étant les plus
foibles , & ceux qui tettent encore en font les-pre-
mières viâimes. Lorfque la mère , par la ftnefTe
de fon odorat, fent dans fon petit le germe de la
maladie , elle eft la première à le condamner, çn
lui refufant la tette. Cette épizootie fe communique
avec une rapidité extraordinaire ; en neuf jours,
au plus, un troupeau de jeunes buffles, quelque
nombreux qu’il foit, en eft prefque tout infeélé.
Ceux qui prennent le mal dans les fix premiers
jours , périffent prefque tous ; au lieu que ceux
qui n’en font attaqués que dans les trois derniers
jours , échappent affez fouvent, parce que
depuis le fixième jour de l’épizootie la contagion
va toujours en diminuant jufqu’auneuvième, qu’elle
lemble fe réunir fur la tête d’un feul, dont elle fait,
pour ainfi. dire , fa viélimé d’expiation.
Cette épizootie des buffles n’a point de faifon fixe,
feulement elle eft plus commune & plus dangereufe
au printemps & en été, qu’en automne & en hiver.
Une obfervation affez générale , c’eft qu’elle vient
ordinairement lorfqu’après les chaleurs il tombe de la
pluie qui fait pouffer de l’herbe nouvelle, ce qui fem-
bleroit prouver que fa caufe eft une furabondance de
chyle & de fang occafionnée par ce pâturage nouveau,
dont la faveur & lafraîcheur invitent les petits
buffles à s’en raffaflier au-delà du befoin. Une expérience
vient à l’appui de cette réflexion. Lesjeunes
buffles, auxquels on a donné une nourriture faine &
copieufe pendant l’hiver, s’abandonnent avec riïoins
d’avidité à l’herbe nouvelle du printemps, ne font
pas attaqués autant que les autres , & meurent en
plus petit nombre. Dans les années de féchereffe ,
cette maladie fe manifefte moins que dans les années
humides. Envain les gardiens des troupeaux de buffles
ont tenté différens remèdes ; ils leur ont appliqué à
la gorge le bouton de feu ; ils les ont fait baigner
dans l’eau de rivière & de mer ; ils ont féparé du
troupeau ceux qui étoient infeâés , afin d’empêcher
la communication du mal ; mais tout a été prefque
. également inutile ; le feul changement de pâturage
femble y apporter quelque foible adoucillement.
Au refte, nous devons ajouter à cette defeription
du barbone des buffles, extraite d’un mémoire deMgr
Gaëtani, favant prélat Romain, que cette efpèce
d’épizootie n’eft peut-être point générale pour l’eft
pèçe de buffle , mais qu’elle pourroit bien , du moins
au dernier point de fa malignité , être particulière
aux troupeaux de ces animaux qu’on fait paître dans
les marais Pontins, qui fontcomme nous l’avons
dit, l’endroit de toute l’Italie où l’on élève le plus
de buffles ; fuivant toute apparence , cette con-?
tagion eft caufée par la malignité de l’air &. de l’eau
dans ces vaftes marécages.
BUGHUR„ en Perlé, chameau. Voye£ l’article
C h a m e a u ,
BUSELAPHUS, de Caïus, eft le bubale. Foyc{
B u b a l e .
C A A
C a AIGOARA, des Brefiliens , dans Marc-
gravé , eft le pécari. Voyeç ce mot.
C A B IA I ,( le ) animal d’Amérique, que l’on
a confondu , mal - à-propos , avec le cochon, auquel
il ne reffemble ’que par de petits rapports,
& dont il diffère par de grands caractères. Il ne
devient jamais aufïi grand ; le plus gros cabiai eft
à peine égal à un cochon de dix-huit mois ; il a la
tête plus courte, la gueule beaucoup moins fendue
que le cochon : les dents & les pjeds font aufïi tout
différens ; car il a des membranes entre les doigts,
& point de défenfes ni de queue ^il a les yeux plus
grands & les, oreilles plus courtés que le cochon,
&il en diffère encore autant par le naturel & les
moeurs , que par la conformation.
Le cabiai fe tient fouvent dans l’eau où il nage
comme un,e loutre , y cherche de même fa proie ,
& vient manger au bord le poiffon qu’il prend &
qu’il faifit avec la gueule & les ongles. Il mange
aufïi des grains, des fruits & des cannes de fucre ;
comme fes pieds font longs & plats, il fe tient
fouvent afïis fur ceux de derrière. Son cri eft
plutôt un braiement comme celui dej l’âne , qu’un
grognement comme Celui dû cochon,
Les cabiais ne marchent ordinairement que la
nuit, & prefque toujours plufieurs de^compagnie ,
fans s’éloigner du bord des eaux; car comme ils.
[courent mal, à caufe de leurs longs pieds &. de
leurs jambes courtes , ,ils ne pourroient trouver
leur falut dans la fuite ;& pour échapper a ceux
qui -les chaffent, ils. fe jettent à l’eau, y plongent,
& vont fortir au loin , ou bien ils y demeurent
fi long-temps qu’on perd l’efpérance de les
revoir.
La chair du cabiai eft graffe & tendre ; mais elle
a plutôt le goût d’un mauvais poiffon, que celui-
d’une bonne viande. Cet animal eft d’un, naturel
tranquille & doux ; il ne fait ni mal ni. querelle4-
aux autres animaux;'on l’apprivoife fans peine ;
il vient à la voix 6L fuit affez volontiers ceux qu’il
connoît & qui l’ont bien traité. Il paroît, par le
grand nombre de. fes mamelles , que la femelle
produit des petits en quantité ; mais nous ignorons
le' temps de la geftatïon, celui de l’accroiffement
&- par conféquent la durée de là vie de cet animal.
Il fe trouve affez communément à la Guiane
auiîi bien qu’au Bv&Kf) aux Amazones &\ dans
Itôutès les terres Baffes de l’Amérique méridionale,
& il paroît qu’il pourroit vivre aufïi dans
f nos climats.
Le cabiai eft lé capybara de Marcgrave & Pifon ;
eapivard de Froger : cochon d'eau de Defmarchais,
[ hydrochoerus dans la nomenclature latine de Briffôn.
CABIONARA, à la Guiane , eft le cabiais
! V ce mot.
C A C
CACHALOT ( le) , cétacé le plus grand après
la baleine , & que fouvent même on confond avec
elleÿ; quoiqu’il foit très-effentiel & t rè s - facile de
les diftinguer , en ce que la baleine n’a pas de
dents , mais des fanons : ( Voye^ .ce mot & l’article
B a l e in e ) ; au lieu que le cachalot a la mâchoire
-inférieure garnie de dents fortes & nombreufes,
qui s’emboîtent dans des alvéoles correfpondantes
dans la mâchoire fupérieure. Willugby décrit,
d’après Clufius,un cachalot api fut jette fur les côtes
occidentales de la Hollande , par une violente-
tempête: il refpiroit encore, lorfqu’on le vit échoué
fur le fable, environ dix heures après la tempête-
Il avoir 5 2 ou. 5 3 pieds de longueur ,& 31 pieds
de circonférence ; quelques relations lui attribuent
même de plus grandes dimenfions, Si il exifte en
effet des cachalots beaucoup plus grands & qui ont
jufqu’à 80 pieds de longueur. On ne put même
pas avoir de celui-ci des mefures exaâes ,. parce
qu’une partie du corps s’étoit • enfonc.ee dans le
fable , par les efforts que fit l’animal avant que« de
mourir. Il y avoit quinze pieds de diftance depuis
le bout de la mâchoire fupérieure jufqu’aux yeux.
Le palais étoit percé de quarante - deux alvéoles ,
.vingt-une de chaque côté, dans lefqüelles entroient
autant de dents dont étoit garnie la mâchoire
inférieure ; fur la tête , auprès du dos.y
paroiffoit le tuyau ou l’évent d’environ trois pouces
de diamètre , par lequel il rejettoit l’eau. La
mâchoire inférieure étoit longue de fept pieds.
Les yeux étoient très -petits' à proportion de la
groffeur énorme de.l’animal. 11 y. avoit. quatre
pieds de diftance depuis les yeux jufqu’aux nageoires
; feize pieds depuis les nageoires jufqu’au
nombril; trois pieds depuis le nombril jüfqu’à la
verge ; trois pieds & demi depuis la verge jufi
qu’à l’anus ; & treize pieds. & demi depuis: l’anus
jufqu’à la queue. Les nageoires avoient quatre
pieds quatre pouces de longueur & un pied d’é-
paiffeur: la queue étoit fort épaiffe ,& elle avoit
treize pieds d’étendue.
On tira ;de la tête de ce cachalot du blanc de
baleine en affez grande quantité pour remplir plus
du quart d’un tonneau , & le corps entier rendit
environ quarante tonneaux de graifïe, fans compter
celle qui fe: répandit: dans la mer.. La peau du
dos étoit noire comme celle des ..-dauphins ou
des thons ; le ventre étoit blanc. Clufius fait
mention d’un autre cachalot qui avoit 60 pieds
de longueur, 14 pieds de hauteur , & 36 pieds
de circonférence.
M. Aiiderfon, dans fon Hiftoire Naturelle de
[l’Iflande & du Groenland , parle de plufieurs
efpèces de cachalots. Il y en a , d it - il, qui ont
■ de groffes dents, plus ou moins longues, un pea