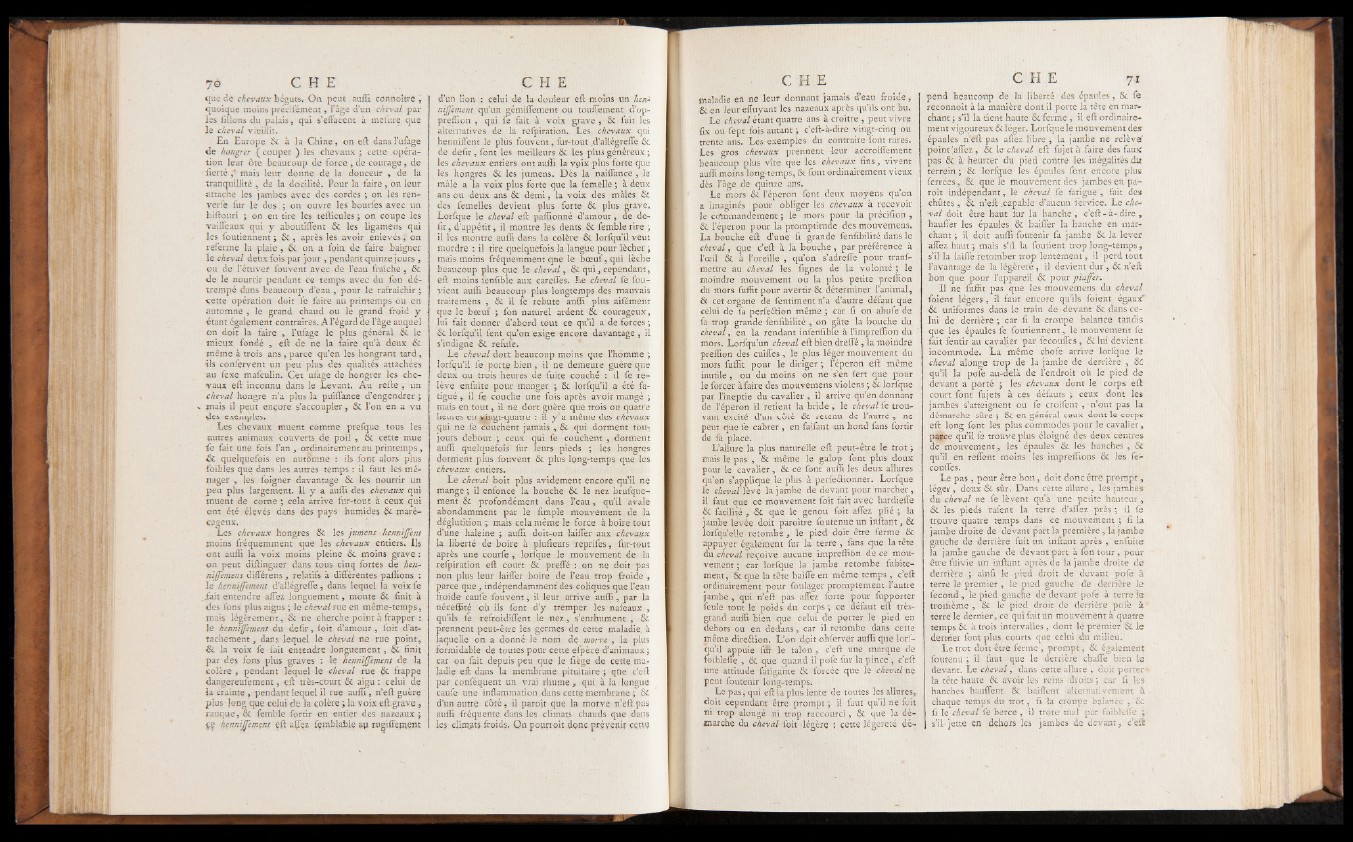
q u e de chevaux béguts. O n p eu t aufli. co n n o ître ,
q u o iq u e moins p ré c i f ém e n t, l’âge d’un cheval p a r
le s filions du p a la i s , qui s’effacen t à m e lu re que
le cheval v ie illit.
E n E u ro p e 8c à la C h in e , o n e ft dans l’ufage
d e honorer ( co u p e r ) les ch e v a u x c e tte .o p é ra tio
n leur ô te b e au cou p de fo rc e , dé co u ra g e , de
f i e r t é m a i s leu r d o n n e de la dou ceu r , de la
tranquillité , de la d o c ilité . P o u r la faire , o n leur
a tta ch e les jam b e s a v e c des co rd e s ; o n les r e n -
v e rfe fur le dos ; o n o u v re les bourfes a v e c un
b iftou ri ; on .en tire les tefticules ; o n co u p e les
v a ifle au x qui y aboutiffent & les ligamens qui
le s fou tien n en t ; 8c , après le s a v o ir en lev és-, on
re fe rm e la plaie , Sc o n a fo in de faire baigner
le cheval d eu x fois p ar jo u r , p en d an t quinze jou rs ,
o u de l’é tu v e r l'ouvent a v e c de l’eau f r a î c h e , 8c
d e le n o u rrir p en d an t ce tem p s a v e c du fon d é t
r em p é dans b e au cou p d’e a u , p o u r le rafraîch ir ;
c e t t e o p é ra tio n do it fe faire au printemps o u en
au tom n e , le g ran d chau d ou le g ran d froid y
é ta n t ég a lem en t co n tra ire s . A l’ég ard d e l’âge auquel
o n d o it la faire , l’ùfage le plus g én é ra l 8c le
m ie u x fon d é , e ft de n e la faire qu’à d eu x &
m êm e à tro is ans , p a r c e qu’en les h on gran t t a r d ,
ils co n fe rv en t un p eu plus d es qualités atta ch é e s
a u fe x e mafculin. C e t ufage de h o n g re r les chev
a u x e ft inconn u dans le L e v a n t . A u re fte ,~ u n
cheval h on gre n’a plus la püiffance d’en g en d re r ;
m a is il p eu t en co re s’a c c o u p le r , & l’o n en a v u
d e s ex em p le s .
L e s ch e v a u x m u en t com m e prefque to u s les
au tre s an im au x co u v e r ts de po il , oc c e tte mue
fie fa it une fois l ’an , o rd in a irem en t au p r in tem p s ,
<8c quelquefois en au tom n e : ils fo n t alors plus
fô ib le s que dans les autres tem p s : il faut le s mén
a g e r , les fo ign e r dav an tag e Ôç les nou rrir un
p e u plus ' la rg em en t. Il y a auffi d es chevaux qui
m u en t d e c o rn e ; c e la arriv e lu r -to u t à ce u x qui
o n t é té élev é s dans des p a y s humides 8c ma ré c
a g e u x .
L e s chevaux h on gre s 8c les jumens henni(fent
mo in s fréq u em m en t que les chevaux en tie rs . Ils
o n t auffi la v o ix mo ins pleine 8c moins g ra v e :
o n p eu t diftinguer dans to u s cin q fo rte s de hen-
nijfemens différens , relatifs à différentes pallions :
le hçnniffement d’a llég re ffe , dans lequel la v o ix fe
f a i t en ten d re allez lo n g u em e n t, m o n te ÔC finit à
d e s fons plus aigus ; le cheval ru e en m êm e -tem p s ,
mais lé g è r em e n t, 8c ne ch e rch e p o in t à frapper
le hennijfement du d e f i r , lo it d’am o u r , fo it d’atta
c h em e n t , dans leq u e l le cheval n e ru e p o in t,
8c la v o ix fe fait en ten d re lo n g u em e n t, 8c finit
p a r des fons plus g rav e s : le henniJJ'ement de la
c o lè r e ÿ p en d an t leq u e l le cheval ru e £ c frappe
d a n g e re u fem e n t, eft tr è s -c o u r t 8c aigu : celu i de
la c rain te , p en d an t lequel il ru e a u ffi, n’e ft gu ère
plus }o n g que celui d e la co lè re ; la v o i x eft,g rav e ,
ra u q u e , 8c femble fo rtir en en tier des n a z e au x ;
ÇÇ hcmiJJ'emçnt e ft allez fçmb|able au rugiffejuent
d’un lion : celui de la d o u leu r eft mo in s un lien-
niffement qu’un gémiffement o u touffement d’op-
preffion , qui fe fait à v o ix g ra v e , 8c fuit les
alte rn a tiv e s de la refp iration . L e s chevaux qui
henniffent le plüs fo u v e n t , fur-tout .d’allégreffe 8c
de d e f ir , font les meilleurs 8c les plus g én éreu x ;
les chevaux entiers o n t auffi la v o ix plus fo rte que
les hon gres 8c les jumen s . D è s la. naiffance , le
m â le a la v o ix plus fo rte que la femelle ; à deux
ans o u d e u x ans 8c d em i , la v o i x des m â le s 8ç
des femelles d e v ien t plus fo rte 8c plus g ra v e .
L o rfq u e le cheval eft paflionné d’am o u r , d e defir
, d’a p p é ti t, il m o n tre le s dents 8c fem b le rire ;
il les m o n tre auffi dans la co lè re 8c lorfqu’il v eu t
m o rd re : il tire quelquefois la langue p ou r lé ch e r ;
mais moins fréq u emmen t que le b oe u f , qui lè ch e
beau cou p plus que le cheval, 8c q u i , c e p en d an t,
e ft moins fenfible au x careffes. L e cheval fe fo u -
v ien t auffi b e au cou p plus long temps des mauvais
txaitemens , 8c il fe reb u te auffi plus aifément
que le boe u f ; fon n atu rel a rd en t 8c co u r a g e u x ,
lui fa it d onner d’ab o rd to u t ce qu’il a de fo rce s ;
8c lorfqu’il fent qu’on e x ig e en co re dav an tag e , il
s’indigne 8c refufe.
L e cheval d o rt b e au cou p mo in s que l’h om m e ;
Iorfqu’il fe p o rte b ie n , il ne d emeure gu ère que
d eu x ou tro is heures de fuite co u ch é : il fe re lè
v e enfuite p o u r man g e r ; 8c lorfqu’il a é té fatigué
, il fe co u ch e une fois après a v o ir mang é ;
mais en t o u t , il ne d o r t g u è re que tro is ou quatre
h eu res en y ipg t-quatre : il y 'a m êm e des chevaux
qui n e fe co u ch en t jamais , 8c qui d o rm en t tou-;
jou rs d eb ou t ; ce u x qui fe co u ch en t , d o rm en t
auffi quelquefois fur leurs pieds ; les hongres
d o rm en t plus fo u v en t 8c plus lon g -temp s que les
chevaux entiers.
L e cheval b o it plus av id em en t e n co re qu’il n e
mang e ; il en fon ce 1a b o u ch e 8c le ne z b ru fq u e-
m e n t 8c p ro fon d ém en t dans l’eau , qu’il av a le
ab o n d am m en t p a r le fimple m o u v em en t de la
déglutition ; mais c e la m êm e le fo rc e à bo ire to u t
d’une haleine ; auffi d o it-o n laiffer au x chevaux
la lib e rté de b o ire à plufieurs r e p r if e s , fur-tout
après une cou rfe , lo rlque le m o u v em en t de la
re fp ira tion e ft co u r t 8c preffé : on ne do it pas
n o n plus leur laiffer b o ire de l’eau tro p froid e ,
p a rce q u e , ind ép en d ammen t des coliques que l’eau
froide caufe f o u v e n t , il leu r arriv e a u f f i, p a r la
n éceffité o u ils font d’y trem p e r les n afeau x ,
qu’ils fe refroidiffent le n e z , s’en rhument , 8c
p ren n en t p eu t-ê tre les g ermes de c e tte maladie, à
laquelle on a donné le n om de morve , la plus
formidable de to u te s pour c e tte e fp è ce d’animaux ;
ca r o n fait depuis peu que le fièg e de c e tte maladie
e ft dans la m em b ran e pituitaire ; qüe c ’eft
p a r con féq u en t u n v ra i rhume , qui à la longue
caufe u n e inflammation dans c e tte memb ran e ; 8c
d’un au tre c ô t é , il p a ro ît que la m o rv e n’eft pas
auffi freq u en te dans, les climats chauds que dans
les climats froids. O n p o u r ro it don c p ré v en ir ç ç tte
maladie en ne leu r d on n an t jamais d’eau f r o id e ,
8c en leur e flu y an t les n a zeau x après qu’ils o n t bu.
L e cheval étan t q u a tre ans à cro ître , p eu t v iv r e
fix ou fept fois autant ; c’eft-à-d ire v in g t-c in q ou
trente ans. L e s e x em p le s du co n tra ire font ra re s.
Les g ro s chevaux p ren n en t -leur a cc roiffemen t
beaucoup plus v ite que les chevaux f in s , v iv e n t
auffi moins lon g -temp s , 8c font o rd in a irem en t v ieu x
dès l’âge de quinze ans.
L e mo rs 8c l’ép e ro n font d eu x m o y e n s qu’on
a imaginés p o u r ob lig er les. chevaux à re c e v o ir
le com m an d em en t ; le m o rs p ou r -la précifion ,
8c l’ép eron p ou r la p romptitude des m o u v em en s .
L a bouche eft d’une fi gran d e fenfibilité dans le
cheval, que c ’eft à la b o u c h e , p a r p ré fé ren ce à
l’oeil 8c à l’oreille , qu’o n s’adreffe p ou r tran f-
mettre au cheval les lignes de la v o lo n té ; le
moindre m o u v em e n t ou la plus p e tite preflion
du m o rs fufiît p ou r a v e rtir 8c d éterminer l’an im a l,
8t c e t o rgan e de fentiment n’a d’autre défaut que
celui d é fa p erfe&ion m êm e j ca r fi o n abufe de
fa tro p gran de fenfibilité , on g â te la b o u ch e du
cheval, en la ren d an t infenfible à l’impreflion du
mo rs. L o rfq u ’un cheval eft bien dreffé , la mo indre
preflion des cu iffe s, le plus lé g e r m o u v em en t du
mors fuffit pour le diriger ; l’ép e ro n e ft m êm e
inutile , o u du moins o n n e s’en fe rt que p o u r
le fo rce r à faire des m o u v em en s v iolen s ; 8c lorfque
par l’ineptie du cav a lie r , il a rriv e qu’en donnant
de l’éperon il re tien t la bride , le cheval fe tro u v
ant e x c ité d’un c ô té 8c re ten u de l’au tre , ne
peut que fe c a b r e r , en faifant \u'n b on d fans fo rtir
de fa p la ce .
L ’allure la plus n atu relle e ft p e u t-ê tre le tro t ;
mais le pas , 8c m êm e le galop font plus d ou x
pour le ca v a lie r , 8c c e fo n t auffi les d eu x allures
qu’on s’applique le plus à perfeêHonner. L orfq u e
le cheval lè v e la jam b e de d ev an t p ou r m a rch e r ,
il faut que ce m o u v em en t fo it fait a v e c hardiefle
8c facilité , 8c que le g en ou fo it aflez plié ; la
jambe le v é e do it p a ro ître foutenue un in f t a n t, 8c
lorfqu’elle re tom b e , le p ied do it ê tre ferme 8c
appuy er ég a lem en t fur la te r re , fans que la tê te
du cheval r e ç o iv e aucu ne impreflibn de ce m ou vemen
t ; c a r lorfque la jamb e re tom b e fu b ite -
m e n t, 8c que la fê te baifle en m êm e temps , c ’eft
ordinairement p ou r foulager p rom p tem en t l’au tre
jambe , qui n’e ft pas aflez fo rte p o u r fuppo rter
feule to u t le poids du co rp s ; ce défaut e ft très-
grand auffi bien que celu i de p o rte r le pied en
dehors ou en d e d a n s , ca r il re tom b e dans c e tte
m ême d ir e â io n . L ’on doit ob fe rve r auffi que lorfqu’il
appuie f i t le ta lon , c ’eft une. marq u e de
foibleffe , 8c que quand il pofe fur'la p in c e , c ’eft
une attitude fatigante 8c fo rc é e que le cheval ne
peut foutenir lon g -tem p s .
L e p a s , qui e ft la plus lente de to u te s les allures,
d o it cepen dant ê tre p rom p t ; il faut qu’il ne foit
n i tro p alongé ni tro p r a c c o u r c i , 8c que la dém
a r ch e du cheval fo it-lé g è r e ; c e tte lé g è re té dé-!
pen d b e au cou p de la lib e rté des é p a u le s , 8c fe
r e co n n o ît à la m an iè re don t il p o r te la tê te en march
an t ; s’il la tien t haute 8c fe rm e , il-eft ordinairem
en t v ig o u reu x 8c lég e r. L orfq u e le m o u v em en t d e s
épaules n’é ft pas allez libre , la jam b e n e r e lè v e ’
p o in t ; a f le z , 8c le cheval e ft fujet à faire des fau x
p as 8c à h eu rte r du pied co n tre les inégalités .du
te r re in ; 8c lorfque les épaules fo n t e n co re plus
f e r r é e s , 8c que le m o u v em en t des jam b e s en paro
ît in d é p e n d a n t, le cheval fe fatigue , fait des
chû tes , 8c n ’e ft .capab le d’aucun f e rv ic e . L e cheval
do it ê tre h au t fur la h a n c h e , c ’e f t - à - d i r e ,
hauffer les épaules 8c bailler la han ch e en marchan
t ; il d o it auffi foutenir fa jam b e 8c la le v e r
aflez haut ; mais s’il la fo u tien t tro p lo n g -tem p s ,
s’il la laiffe re tom b e r tro p le n t em e n t, il p e rd to u t
... L’av an tag e de la lé g è re té , il d ev ien t d u r , 8c n’e ft
b o n que pour l’appareil 8c p o u r piaffer»
Il ne fuffit pas que les m o u v em en s du cheval
fo ien t lé g e r s , il faut en co re qu’ils fo ien t égaux*
8c uniformes dans le tra in de > d e v a n t 8c dans c e lui
de d e rriè re ; ca r fi la cro u p e b a lan c e tandis
que les épaules fe fo u tie n n e n t, le m o u v em en t fe
fait fentir au ca v a lie r p a r f e co u f le s , 8c lui d e v ien t
in com m o d e . L a m êm e chofe a rriv e lorfque le
cheval alonge tro p de la jam b e de d e rriè re , SC.
qu’il la p ô le au -d e là de l’en d ro it o ù le pied d e
d e v a n t a p o rté ; les chevaux d o n t le co rp s e f t
co u r t fo n t fujets à c e s défauts ; c e u x d o n t le s
jam b e s s’a tte ign en t ou fe cro ifen t n’o n t pas la
d ém a rch e sûre ; 8c en g én éral ce u x d o n t le co rp s
e ft lon g font les plus com m od e s p o u r le c a v a lie r ,
p a c te qu’il fe tro ù ve .p lu s éloigné des d eux cen tre s
de m o u v em e n t, le s épaules 8c les hanches , 8c
qu’il en re lien t moins les impreflions 8t le s féco
n d é s .
L e pas , p o u r ê tre b o n , d o it d o n c ê tre p r o m p t ,
lég e r , d o u x 8c sûr. D a n s c e tte allure , le s jam b e s
du cheval ne fe lè v en t qu’à une p e tite hauteu r ,
8c le s pieds ra fen t la te r re d’aflez près ; il fe
trp u v e quatre tem p s dans ce m o u v em en t ; fi la
jam b e dro ite de d ev an t p a rt la p r em iè r e , la jam b e
g auche de d errière fuit un inftant ap rè s , enfuite
la jam b e g auche de d e v an t p a r t à fon to u r , p o u r
ê tre fiiivie Un inftant ap rès de la jam b e d ro ite de
d e rriè re ; ainfi le p ied d ro it de d e v an t p o fe à
te r r e le p rem ie r , le pied, g auche de d e rriè re le
fé co n d , le p ied g auche de d ev an t pofe à te r re le
tro ifièm e , 8c le p ied d ro it de d e rriè re pofe à
te r re le d e rn ie r , ce qui fait un m o u v em en t à q u a tre
tem p s 8c à tro is intervalles , d o n t le p rem ie r 8c le
d ern ier font plus cou rts que celui du milieu.
L e tro t d o it ê tre ferme , p r o m p t , 8c é g a lem en t
foutenu ; il faut que le d e rriè re chafle bien le
d ev an t. L e cheval, dans c e tte allure , d o it p o r te r -
la tê te haute 8c a v o ir les réins droits ; c a r fi le s
hanches hauffent 8c baiffent a lte rn a tiv em en t à
; chaq ue tem p s du t r o t , fi la cro u p e b a lan ce , 8c
fi le cheval fe b e r c e ,• il t r o te m a l p ar foibleffe ;
| s’il -je t te en dehors les jam b e s de d e v a n t , c ’e f t