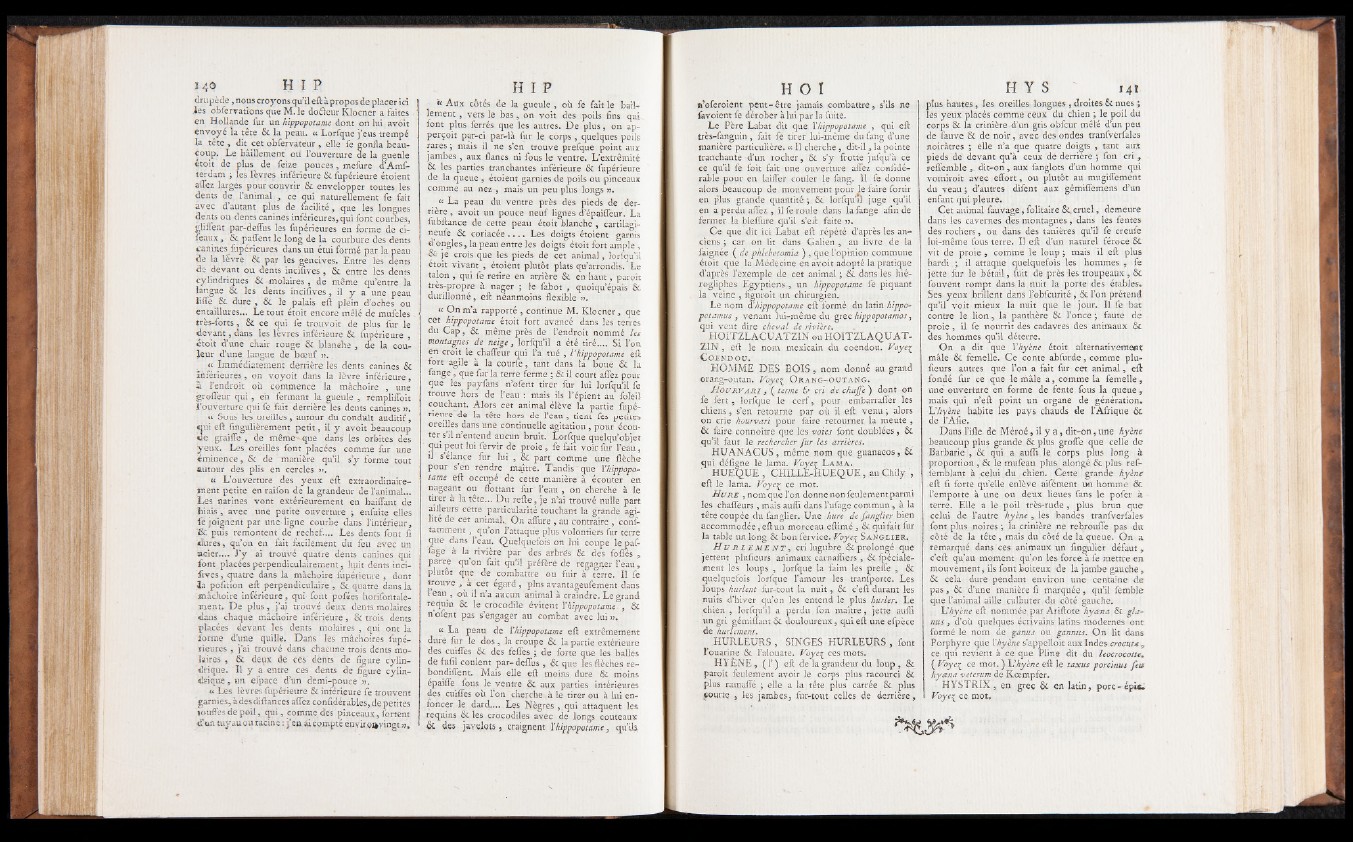
drupède, nous croyons qu’il eft à propos de placer ici
.les obfervations que M. le doéleur Klocner a faites
en Hollande fur un hippopotame dont on lui avoit
envoyé la tête &. la peau. « Lorfque j’eus trempé
la tete , dit cet obfervateur , elle fe gonfla beaucoup.
Le bâillement où l’ouverture de la gueule
étoit de plus^ de feize pouces, mefure d’Amf-
terdam ; les lèvres inférieure & fupérieure étoient
aflez larges pour couvrir & envelopper toutes les
dents de l’animal , ce qui naturellement fe fait
avec d autant plus de facilité, que les longues
dents ou dents canines inférieures, qui font courbes,
êliflent par-deflùs les fupérieures en forme de ci-
ieaux , & paflent le long de la courbure des dents
canines fupérieures dans un étui formé par la peau
de la lèvre &. par les gencives. Entre les dents
de devant ou dents incifives , & entre les dents
cylindriques & molaires , de même qu’entre la
langue & les dents incifives, il y a une peau
lifle & dure, & le palais eft plein d’oches ou
entaillures... Le tout étoit encore mêlé de mufcles -
très-forts, & ce qui fe trouvoit de plus fur le
devant, dans les lèvres inférieure & fupérieure ,
étoit d’une chair rouge & blanehe , de la couleur
d’une langue de boeuf ».
<« Immédiatement derrière les dents canines &
inférieures, on voyoit dans la lèvre inférieure,
a l’endroit où commence la mâchoire , une
groflfeur qui, en fermant la gueule , rempliffoit
l ’ouverture qui fe fait derrière les dents canines ».
« Sous les oreilles, autour du conduit auditif,
ui eft fmgulièrement petit, il y avoit beaucoup
e graifle , de même-* que dans les orbites des
yeux. Les oreilles font placées comme fur une
éminence, & de "manière qu’il s’y forme tout
autour des plis en cercles ».
u L’ouverture des yeux eft extraordinairement
petite en raîfon de la grandeur de l’animal...
Les narines vont extérieurement en haiflant de
Liais , avec une petite ouverture ; enfuite elles
le joignent par une ligne courbe dans l’intérieur,
puis remontent de rechef.... Les dents font fi
dures, qu’on en fait facilement du feu avec un
acier.... J’y aï trouvé quatre dents canines qui
font placées perpendiculairement, huit dents incifives,
quatre dans la mâchoire fupérieure , dont
2a pofition eft perpendiculaire , & quatre dans la
mâchoire inférieure, qui- font pofées horifontale-
ment. De plus, j’ai trouvé deux dents molaires
dans chaque mâchoire inférieure, & trois dents
placées devant les dents molaires , qui ont la
forme d’une quille. Dans les mâchoires fupé-r
rieures , j’ai trouvé dans chacune trois dents molaires
, & deux de cés dents de figure cylindrique.
Il y a entre ces dents de figure cylindrique
un efpace d’un demi-pouce ».
« Les lèvres fupérieure & inférieure fe trouvent
garnies, à des diftanees aflez confidérables, de petites
lotiffesde poil, qui, comme dés pinceaux, fortent
<l’un tuyau ou racine : j’en ai compté ényiroaYingt »,
« Aux côtés de la gueule, où fe fait le bâillement,
vers le bas, on voit des poils fins qui.
font plus ferrés que les autres. De plus, on ap-
perçoit par-ci par-là fur le corps, quelques poils
rares ; mais il ne s’en trouve prefque point aux
jambes, aux flancs ni fous le ventre. L’extrémité
& les parties tranchantes inférieure & fupérieure
de la queue , étoient garnies de poils ou pinceaux
comme au nez , mais un peu plus longs ».
« La peau du ventre près des pieds de derrière
, avoit un pouce neuf lignes d’épaifleur. La
fubftance de cette peau étoit blanche , cartilagi-
neufe & coriacée. . . . Les doigts étoient garnis
d’ongles, la peau entre les doigts étoit fort ample ,
&- je crois que les pieds de cet animal, lorfqu’il
etoit vivant , étoient plutôt plats qu’arrondis. Le
talon , qui fe retire en arrière & en haut, parok
très-propre à nager ; le fabot , quoiqu’épais êc
durillonné, eft néanmoins flexible ».
« On m’a rapporté , continue M. Klocner, que
cet hippopotame étoit fort avancé dans les terres
du Cap, & même près de l’endroit nommé les
montagnes de neige , lorfqu’il a été tiré.... Si l’on
en croit le chaffeur qui l’a tué , Vhippopotame eft
fort agile à la courfe, tant dans la bouè & la
fange 9 que fur la terre ferme ; & il court aflez pour
que les payfans n’ofent tirer fur lui lorfqu’il fe
trouve hors de l’eau : mais ils l’épient au foïeii
couchant. Alors cet animal élève la partie fupë-
rieure de la tête hors, de l’eau, tient fes petites
oreilles dans une continuelle agitation , pour écouter
s’il n’entend aucun bruit. Lorfque quelqu’objet
qui peut lui fervir de proie , fe fait voir fur l’eau,
il s élancé fur lui , & part comme une flèche
pour s’en rendre maître. Tandis que Y'hippopo-
tame eft occupé de cette manière à écouter en
nageant ou flottant fur' l’eau , on cherche à le
tirer a la tête... Du refte, je n*ai trouvé nulle part
ailleurs cette particularité touchant la grande agilité
de cet animal.. On afflue , au contraire , constamment
, qu’on l’attaque plus volontiers fur terre
que dans l’eau. Quelquefois on lui coupe le paf*
fage à la rivière par des arbres & des fofîes ,
parce qu on fait qu’il préfère de regagner l’eau ,
plutôt que de combattre ou fuir à terre. Il fe
trouve , a cet égard, plus avantageufement dans
l’eau , où il n’a aucun animal à craindre. Le grand
requin & le crocodile évitent Y hippopotame. , &
n’ofent pas s’engager au combat avec lui».
« La peau de Yhippopotame eft extrêmement
duré fur le d o s la croupe & la partie extérieure
des cuiffes & des feflfes ; de forte que les balles
de -fufil coulent par- defîùs , & que les flèches re-
bondiflent. Mais elle eft moins dure & moins
épaiffe fous le ventre & aux parties intérieures
des cuiffes où l’on cherche à le tirer ou à lui enfoncer
le dard.... Les Nègres ,.qui attaquent les
requins & les crocodiles avec de longs couteaux
&. des javelots a craignent Y hippopotame, qu’ils..
n’oferoient peut-être jamais combattre, s’ils ne
favoient fe dérober à lui par la fuite.
Le Père Labat dit que Y hippopotame , qui eft
très-fanguin, fait fe tirer, lui-même dufang d’une •
manière particulière. « 11 cherche, dit-il, la pointe
tranchante d’un rocher, & s’y frotte jufqu’à ce
ce qu’il fe foit fait une ouverture aflez confidé-
rable pour en laifler couler le fang. Il fe donne
alors beaucoup de mouvement pour le faire fortir
en plus grande quantité ; &. lorfqu’ü juge qu’il
en a perdu aflez , il fe roule dans la fange afin de
fermer.la bleflùre qu’il s’eft faite ».
Ce que dit ici Labat eft répété d’après les anciens
; car on lit dans Galien , au livre de la
faignée ( de phlebotomia ) , que l’opinion commune
étoit que la Médecine en avoit adopté la pratique
d’après l’exemple de cet animal ; & dans les hié-
rogliphes Egyptiens , un hippopotame fe piquant
la veine , figuroit un chirurgien.
Le nom (Yhippopotame eft formé du latin hippo-
pctamus , venant lui-même du grec hippopotamos,
qui veut dire cheval de rivière.
HOITZLACUATZIN ou HOITZLAQUAT-
Z1N , eft le nom mexicain du coendou. Voyeç
COENDOU.
HOMME DES BOIS, nom donné au grand
orang-outan. Voyeç O r a n g - o u t a n g .
H o u r v a r i , ( terme & cri de chajfe ) dont on
fe fert, lorfque le cerf, pour embarraffer les
chiens, s’en retourne par où il eft venu ; alors
on crie hourvari pour faire retourner la meute ,
& faire connoître que les votes font doublées, &
qu’il faut le rechercher fur les arrières.
HUANACUS, même nom que guanacos, &
qui d.éfigne le lama. Voye%_ L a m a .
HUEQUE , CHILLE-HUEQUE, au Chily ,
eft le lama. Voye£ ce mot.
H u r e , nom que l’on donne non feulement parmi
les chafleurs , mais auffl dans l’ufage commun, à la
tête coupée du fanglier. Une hure de fanglier bien
accommodée, eft un morceau eftimé, & qui fait fur
la table un long & bon fervice. Voye£ S a n g l ie r .
H u r l e m e n t , cri lugubre & prolongé que
jettent plufieurs animaux carnaflïers , & fpéciale-
rnent les loups , lorfque la faim les prefle , &
quelquefois lorfque l’amour les tranfporte. Les
loups hurlent fur-tout la nuit, & c’eft durant les
nuits d’hiver qu’on les entend le plus hurler. Le
.chien , îorfqu’il a perdu fon maître, jette aulfi
un gri gémiffant &. douloureux, qui eft une efpèce
de hurlement.
t HURLEURS , SINGES HURLEURS , font
Fouarine & l’alouate. Voyeç ces mots.
HYÈNE, ( 1’ ) eft de la grandeur du loup , &
paroît feulement avoir le corps plus racourci &
plus ramafle ; elle a la tête plus carrée & plus
£<wte , les jambes, fur-tout celles de derrière,
plus hautes, les oreilles- longues, droites & nues ;
les yeux placés comme ceux du chien ; le poil dii
corps & la crinière d’un gris obfcur mêlé d’un peu
de fauve & de noir, avec des>ondes tranfvérfales
noirâtres ; elle n’a que quatre doigts , tant aux
pieds de devant qu’à ceux de derrière ; fon cri ,
refîemble , dit-on, aux fanglots d’un homme qui
vomiroit avec effort, ou plutôt au mugiflement
du veau ; d’autres difent aux gémiflemens d’un
enfant qui pleure.
Cet animal fauvage * folitaire ôc, cruel, demeure
dans les cavernes des montagnes, dans les fentes
des rochers, ou dans des tanières qu’il fe creufe
lui-même fous terre. Il eft d’un naturel féroce ÔL
vit de proie , comme le loup ; mais il eft plus
hardi. ; il attaque quelquefois les hommes , fe
jette fur le bétail, luit de près les troupeaux , &
fouvent rompt dans la nuit la porte des étables.
Ses yeux brillent dans l’obfcurité , Si l’on prétend
qu’il voit mieux la nuit que le jour. Il fe bat
contre le lion, la panthère &. l’once; faute de
proie, il fe nourrit des cadavres des animaux
des hommes qu’il déterre.
On a dit que Yhyène étoit alternativement
mâle & femelle. Ce conte abfurde, comme plufieurs
autres que l’on a fait fur cet animal, eft
fondé fur ce que le mâle a , comme la femelle ,
une ouverture en forme de fente fous la queue ,
mais qui n’eft point un organe de génération.
L'hyène habite les pays chauds de l’Afrique &
de l’Afie.
Dans l’ifle de Méroé, il y a , dit-on, une hyène
beaucoup plus grande & plus grofle que celle de
Barbarie , & qui a auffl le corps plus long à
proportion , & le mufeau plus alongé & plus ref-
femblant à ;celui du chien. Cette grande hyène
eft fi forte qu’elle enlève aifément un homme &
l’emporte à une ou deux lieues fans le pofer à
terre. Elle a le poil très-rude, plus brun que
celui de l’autre hyène , les bandes tranfverfales
font plus noires ; la crinière ne rebroufîe pas du
côté de la tête, mais du côté de la queue. On a
remarqué dans ces animaux un fingulier défaut,
c’eft qu’au moment; qu’on les force à fe mettre en
mouvement, ils font boiteux de la jambe gauche ,
& cela dure pendant environ une centaine d©‘
pas, & d’une manière fi marquée, qu’il femble
que l’animal aille culbuter du côté gauche.
U hyène eft nommée par Ariftote hycena & glu-
nus , d’où quelques écrivains latins modernes ont
formé le nom de ganus. ou gannus. On lit dans
Porphyre que Yhyène s’appelloit aux Indes crocuta,
ce qui revient à ce que Pline dit du leocrocotte.
( Voye^ ce mot. ) L'hyène eft le taxus porcinus feu
hycena veterum de Koempfer.
HYSTRIX, en grec & en latin, porc-épi«*
Voye^ ce. mot»