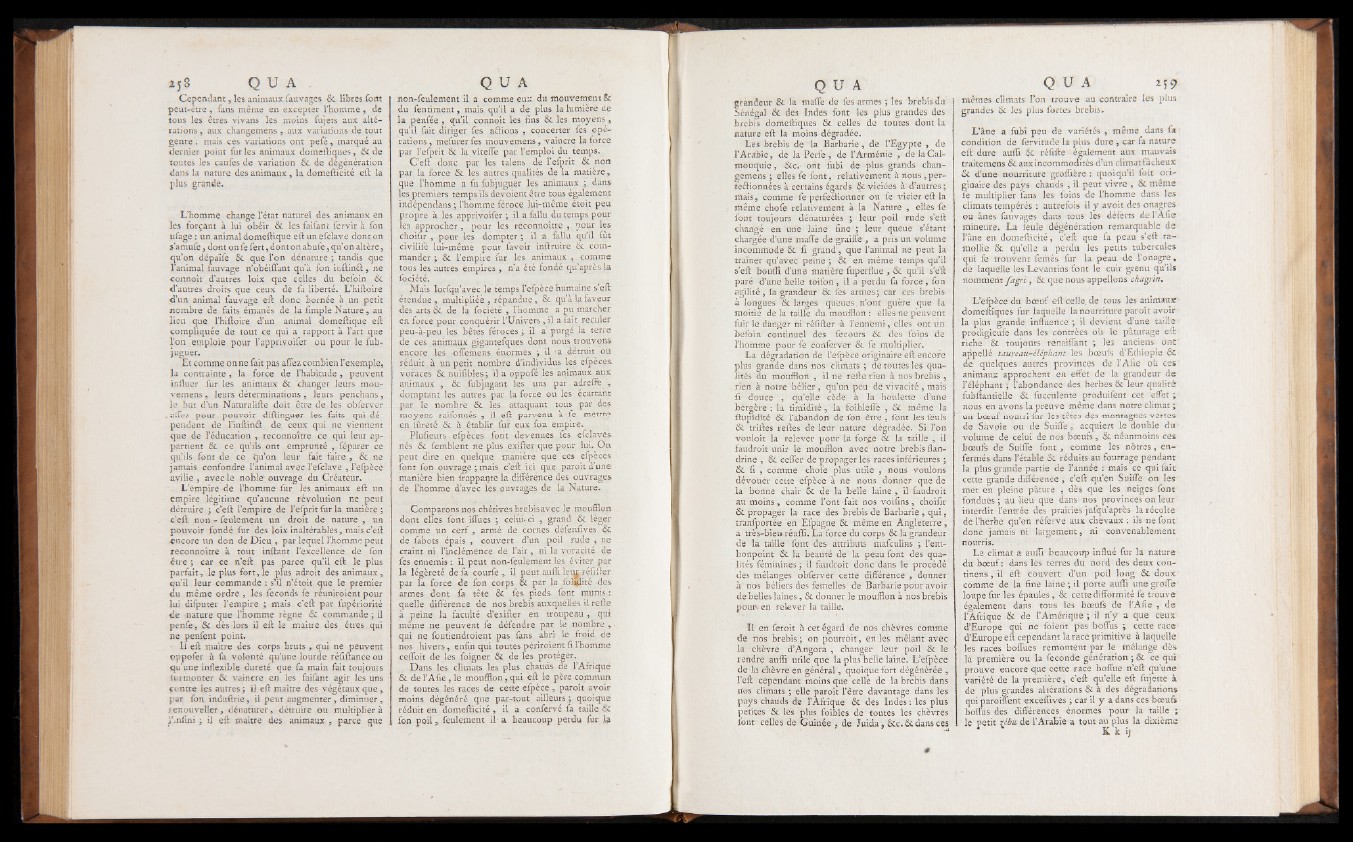
Cependant, les animaux fauvages & libres font
peut-être , fans même en excepter l’homme , de
tous les êtres vivans les moins fujets aux altérations
, aux changemens , aux variations de tout
genre : mais ces variations ont pefé, marqué au
dernier point fur les animaux domeftiques, 8c de
toutes les caufes de variation & de dégénération
dans la nature des animaux, la domefticité eft la
plus grande.
L’homme change l’état naturel des animaux en
les forçant à lui obéir & les faifant fervir à fon
ufage : un animal domeftique eft un efclave dont on
s’amufe y dont on fe fert, dont on abufe, qu’on altère,
qu’on dépaïfe & que l’on dénature ; tandis que
l’animal fauvage n’obéiffant qu’à fon inftinét, ne
connoît1 d’autres loix que celles du befoin &
d’autres droits que ceux dè fa liberté. L’hiftoire
d’un animal fauvage eft donc bornée à un petit
nombre de faits émanés de la ftmple Nature, au
lieu que, l’hiftoire d’un animal domeftique eft
compliquée de tout ce qui a rapport à l’art que
l’on emploie pour l’apprivoifer ou pour le fub-
jueuer. |
Et comme on ne fait pas affez combien l’exemple,
la contrainte , la force de l’habitude , peuvent
influer fur les animaux & changer leurs mou-
vemens, leurs déterminations , leurs penchans ,
le but d’un Naturalifte doit être de-les obferver
. allez pour pouvoir dîftinguer les faits qui dépendent
de l’inftinél de ceux qui ne viennent
que de l’éducation , reconnoîtrè ce qui leur appartient
& ce qu’ils ont emprunté , féparer ce
qu’ils font de ce qu’on leur fait fairey 8c ne
jamais confondre l’animal avec l’efclave , l’efpèce
avilie , avec le noble' ouvrage du Créateur.
L’empire de l’homme fur les animaux eft un
empire légitime qu’aucune révolution ne peut
détruire ; c’eft l’empire de l’efprit fur la matière ;
c’eft non - feulement un droit de nature , un
pouvoir fondé fur des loix inaltérables, mais c’eft
encore un don de Dieu , par lequel l’homme peut
reconnoître à tout inftant l’excellence de fon
être ; car ce n’eft pas parce qu’il eft le plus
parfait, le plus fort, le plus adroit des animaux,
qu’il leur commande : s’il n’étoit que le premier
du même ordre y les féconds fe réuniroient pour
lui difputer l’empire ; mais c’eft par fupériorité
de nature que l’homme règne 8c commande ; il
penfe, 8c dès lors il eft le maître des êtres qui
ne- penfent point.
Il eft maître des corps bruts , qui ne peuvent
oppofer à fa volonté qu’une lourde réfiftance ou
qu’une inflexible dureté que fa main fait toujours
lurmonter & vaincre en les faifant agir les uns
contre les autres ; il eft maître des végétaux que,
par fon induftrie, il peut augmenter , diminuer ,
> enouveller y dénaturer, détruire ou multiplier à
l’infini -3 il eft maître des animaux , parce que
non-feulement il a comme eux du mouvement &
du fentiment, mais qu’il a de plus la lumière de
la penfée , qu’il connoît les fins 8c les moyens ,
qu’il fait diriger fes allions , concerter fes opérations
, mefurer fes mouvemens, vaincre la force
par l’efprit & la vîteffe par l’emploi du temps.
C’eft donc par les talens de l’efprit 8c non
par la force & les autres qualités de la matière,
que l’homme a fu fubjuguer les animaux ; dâns
les premiers temps ils dévoient être tous également
indépendans ; l’homme féroce lui-même étoit peu
propre à les apprivoifer ; il a fallu du temps pour
les approcher, pour les reconnoître , pour les
choifir , pour les dompter ; il a fallu qu’il fût
civilifé lui-même pour favoir inftruire & commander
; & l’empire fur les animaux , comme
tous les autres empires , n’a été fondé qu’après la
fociété.
Mais lorfqu’avec le temps l’efpèce humaine s’eft
étendue , multipliée , répandue, 8c qu’à la faveur
des arts & de la fociété , l’homme a pu marcher
en force pour conquérir l’Univers, il a fait reculer
peu-à-peu les bêtes féroces ; il a purgé la terre
de ces animaux gigantefques dont nous trouvons
encore les offemens, énormes ; il ’a détruit ou
réduit à un petit nombre d’individus les efpèces.
voraces & nuifibles ; il a oppofé les animaux aux
animaux , 8c fubjugant les uns par adreffe ,
domptant les autres par la force ou les écartant
par le nombre & les attaquant tous par des
moyens raifonnés , il eft parvenu à'fe mettre
en lûreté & à établir fur eux fon empire.
Plufieurs efpèces font devenues fes efclaves
nés 8c femblent ne plus exifter- que pour lui. On
peut dire. en quelque manière que ces efpèces
font fon ouvrage ; mais c’eft ici que paroît d’une
manière bien frappante la différence des ouvrages
de l’homme d’avec les ouvrages de la Nature.
Comparons nos chétives brebis avec le moufflon
dont elles font iffues ; celui-ci , grand & léger
comme un cerf, armé de cornes défenfives 8c
de fabots épais , couvert d’un poil rude , ne
craint ni l’inclémence de l’air, ni la voracité de
fes ennemis :, il peut non-feulement les éviter par
la légèreté de fa courfe il peut auffi leiuiréfifter
par la force de fon corps & par la fohgdité des
armes dont fa tête 8c fes pieds font munis.:
quelle différence de nos brebis auxquelles il refte
à peine la faculté d’exifter en troupeau, qui
même ne peuvent fe défendre par le nombre ,
qui ne foutiendroient pas fans abri le froid de
nos hivers, enfin qui toutes périroient fi l’homme
ceffoit de les foigner 8c de les protéger.
Dans les climats les plus chauds de l’Afrique
& de l’A fie , le moufHon, qui eft le père commun
de toutes les races de cette efpèce, paroît avoir
moins dégénéré que par-tout ailleurs ; quoique
réduit en domefticité, il a confervé fa taille &
fon poil y feulement il a beaucoup perdu fur la
grandeur & la maffe de fes armes ; les brebis du
Sénégal 8c des Indes font les plus grandes des
brebis domeftiques 8c celles de toutes dont la
nature eft la moins dégradée.
Les brebis de "la Barbarie, de l’Egypte , de
l’Arabie, de la Perfe, de l’Arménie , de la Cal-
mouquie, &c.- ont fubi de plus grands changemens
; elles fe font, relativement à nous , per-
îêftionnées à certains égards 8c viciées à d’autres;
mais, comme fe perfectionner ou fe vicier eft la
même çhofe relativement à la Nature , elles fe
font toujours dénaturées ; leur poil rude s’eft
changé en une laine fine ; leur queue s’étant
chargée d’une maffe de graiffe , a pris un volume
incommode 8c fi grand, que l’animal ne peut la
traîner qu’avec peine ; 8c en même temps qu’il
s’eft bouffi d’une matière fuperfkte , & qu’il s’eft
paré d’une belle toifon , il a perdu fa force, fon
agilité, fa grandeur 8c fes armes ; car ces brebis
à longues 8c larges queues. n’ont guère que la
moitié de la taille du moufflon : elles ne peuvent
fuir le dknger ni réfifter à l’ennemi, elles ont un
befoin continuel des fecours 8c des foins de
l’homme pour fe conferver 8c fe multiplier.
La dégradation de l’efpèce originaire eft encore
plus grande dans nos climats ; de toutes les qualités
au moufflon , il ne refte rien à nos brebis ,
rien à notre bélier , qu’un peu de vivacité , mais
fi douce , qu’elle cède à la houlette d’une
bergère : la timidité, la foibleffe , 8c même la
ftupidité 8c l’abandon de fon être , font les feuls
8c triftes reftes de leur nature dégradée. Si. l’on
vouloit la relever pour la forge & la taille , il
faudroit unir le moufflon avec notre brebis flan-
drine , 8c ceffer de propager les races inférieures ;
& fi , comme chofe plus utile , nous voulons
dévouer cette efpèce à ne nous donner que de
la bonne chair & de la belle laine , il faudroit
au moins, comme l’ont fait nos voifins, choifir
8c propager la race des brebis de Barbarie , qui,
tranfportee en Efpagne 8c même en Angleterre,
a très-bie» réuffi. La force du corps 8c la grandeur
de la taille font dès attributs mafculins ; l’embonpoint
8c la beauté de la peau font des qualités
féminines ; il faudroit donc dans le procédé
des mélanges obferver cette différence , donner
à nos béliers des femelles de Barbarie pour avoir
de belles laines, 8c donner le moufflon à nos brebis
poiuven relever la taille.
Il en feroit à cet égard de nos chèvres comme
de nos brebis ; on pourroit, en les mêlant avec
la chèvre d’Angora , changer leur poil 8c le
rendre auffi utile que la plus belle laine. L’efpèce
de la chèvre en général, quoique fort dégénérée ,
l’eft cependant moins que celle de la brebis dans
rtos climats ; elle paroît l’être davantage dans les
pays chauds de l’Afrique & des Indes : les plus
petites & les plus foibles de toutes les chèvres
îont celles de Guinée , de Juida, &ç, 8c dans ces
mêmes climats l’on trouve au contraire les plus
grandes 8c les plus fortes brebis.
L’âne a fubi peu de variétés , même dans fa ■
condition de fervitude la plus dure , car fa nature
eft dure auffi & réfifte également aux mauvais
traitemens & aux incommodités d’un climat fâcheux
8c d’une nourriture groffière : quoiqu’il foit originaire
des pays chauds , il peut vivre , 8c même
le multiplier fans les foins de l’homme dans les
climats tempérés : autrefois il y avoit.des onagres
ou ânes fauvages dans tous les déferts de l’Afie
mineure. La ieulè dégénération remarquable de
l’âne en domefticité, c’eft que fa peau s’eft ramollie
& qu’elle a perdu les petits tubercules
qui fe trouvent femés fur la peau de l’onagre,
de laquelle les Levantins font le cuir grenu qu’ils
nomment fagri, 8c que nous appelions chagrin.
L’efpèce du boeuf eft celle, de tous les animauxr
domeftiques fur laquelle la nourriture paroît avoir
la plus grande influence ; il devient d’une taille;
prodigieufe dans les contrées où le pâturage eft
riche 8c toujours renaiffant ; les anciens ont"
appellé taureau-éléphant les boeufs d’Ethiopie 8c
de quelques autres provinces de l’Afie où ces
animaux approchent en effet de la grandeur de
l’éléphant ; l’abondance des herbes 8c leur qualité
fubftantielle 8c fucculente produifent cet effet ;
nous en avons la preuve même dans notre climat ;
un boeuf nourri fur les têtes des montagnes vertes
de Savoie ou de Suiffe, acquiert le double du ■
volume de celui de nos boeufs, 8c néanmoins ces
boeufs de Suiffe font , comme les nôtres, enfermés
dans l’étable ,8c réduits au fourrage pendant
la plus grande partie dé l’année : mais ce qui fait
cette grande différence, c’eft qu’en Suiffe on les
met en pleine pâture , dès que les neiges font
fondues ; au lieu que dans nos provinces on leur
interdit l’entrée des prairies jufqu’après la récolte
de l’herbe qu’on réferve aux chevaux ; ils ne font
donc jamais ni largement, ni convenablement
nourris.
Le climat a auffi beaucoup influé fur la nature
du boeuf : dans les terres du nord des deux con-
tinens, il eft couvert d’un poil long & doux
comme de la fine laine ; il porte auffi une groffe
loupe fur les épaules , & cette difformité fe trouve
également dans tous les boeufs, de l’Afie , de
l’Afrique 8c de l’Amérique ; il n’y a que ceux
d’Europe qui ne foient pas boffus ; cette race
d’Europe eft cependant la race primitive à laquelle
les races boffues remontent par le mélange dès
. la première ou la fécondé génération ; & ce qui
prouve encore que cette race boffue n’eft qu’une
variété de la première, c’eft qu’elle eft fujette à
de plus grandes altérations 8c à des dégradations
qui paroiüent exceffives ; car il y a dans ces boeufs
boffus des différences énormes pour la taille ;
le petit çébu de l’Arabie a tout au plus la dixième
K k ij