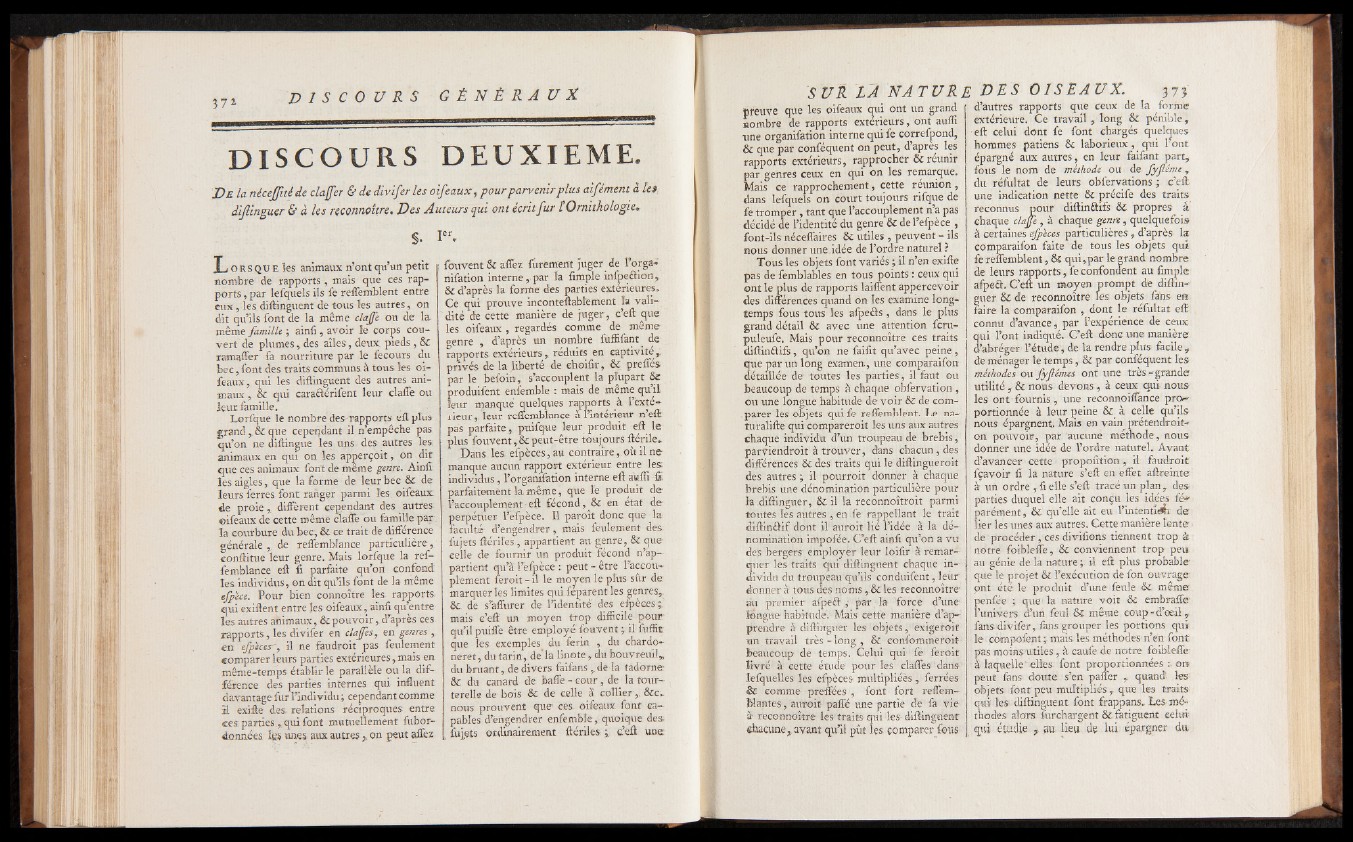
D I S C O U R S DEUXIEME.
De la nécejjitê de clamer & de diviferles oifeaux, pour parvenir plus aifêment à les
dißinguer & à les reconnoitre. Des Auteurs qui ont écrit fur l Ornithologie.
§. l Ctr
L o r sq u e les animaux n’ont qu’un petit
nombre de rapports , mais que ces rapports
, par lefquels ils fe reffemblent entre
eux, les diftinguent de tous les autres, on
dit qu’ils font de la même claffe on de la
même famille ; ainfi, avoir le corps couvert'
de plumes, des ailes, deux pieds, &
ramaffer fa nourriture par le fecours du
bec, font des traits communs â tous les oifeaux,
qui les diftinguent des autres animaux
, & qui caraûérifent leur claffe ou
leur famille.
Lorfque le nombre des- rapports eft plus
grand, & que cependant il n’empêche pas
qu’on ne diftingue les uns des autres les
animaux en qui on les apperçôit, on dit
que ces animaux font de meme genre. Ainfi:
les aigles, que la forme de leur bec & de
leurs ferres font ranger parmi l’es oifeaux
de p ro ie ,. diffèrent cependant des autres:
oifeaux de cette même claffe ou famille par
la courbure du bec, ce trait de différence
générale ,. de reffemblance particulière,,
eonftitue leur genre. Mais lorfque la ref-
femblanee eft fi parfaite qu’on confond,
les individus, on dit qu’ils font de la même
efpïce. Pour bien connoître les rapports,
qui exiftent entre les oifeaux, ainfi qu’entre
les autres animaux, & pouvoir, d’après ces
rapports, les divifer en claffes, en genres ,
en ejpices", il ne fàudroit pas feulement
comparer leurs parties extérieures, mais en.
même-temps établir le parallèle ou la différence
des parties internes qui influent
davantage fur l’individu ; cependant comme
S exifte des; relations réciproques entre
eea parties., qui font mutuellement fubor-
données. lies unes- aux autres,, on peut affez
fouvent & allez fûrement juger de l’orga-
nifation interne, par la fimple infpeÛion,.
& d’après la forme des parties extérieures.
Ce qui prouve inconteftablement la validité
de cette manière de juger, c’eft (pie
les oifeaux, regardés comme de même
genre , d’après un nombre fuffifant de
rapports extérieurs, réduits en captivité ,
privés de la liberté de ehoifir, & prefîes
par le befoin, s’accouplent la plupart Sc
produifent enfemble : mais de même qu’il
leur manqué quelques rapports à l’extérieur,.
leur reffemblance à l’intérieur n’elî:
pas parfaite, puifqwe leur produit eft le
plus fouvent, & peut-être toujours ftérile-
Dans les. efpèces,au contraire ,.où il ne-
manque aucun rapport extérieur entre les;
individus, l’organifetion interne eft aufli fi
parfaitement la même, que le produit de-
l’accouplement-eft fécond, & en état de
perpétuer l’efpèce. Il paroît donc que la.
faculté d’engendrer, mais feulement des.
fujets ftériles., appartient au- genre, & que
celle de fournir un produit fécond n’âp—
partient qu’à l’efpèce : peut-être l’accouplement
feroit - il le moyen le plus sur de
marquer les limites qui feparent les genres,
& de s’affurer de l’identité des efpèces
mais c’eft un moyen trop difficile pour
qu’il puiffe être employé fouvent ; il fuffit
que les exemples du ferin , du chardo-
neret, du tarin, de la linote ■ , du bouvreuil,
du bruant, de divers faifans ,.de la tadorne
& du canard de baffe - cour, de la tourterelle
de bois & de celle à collier,, &c»
nous prouvent que ces oifeaux font capables
d’ëftgendrer enfemble, quoique des,
fujets ordinairement ftériles j. c’eû une
preuve que les oifeaux qui ont un grand
nombre de rapports extérieurs, ont aufli
■ une organifation interne qui fe correfpond,
& que par conféquent on peut, d’après les
rapports extérieurs, rapprocher & reunir
par genres ceux en qui on les remarque.
Mais ce rapprochement, cette reunion,
dans lefquels on court toujours rifque de
fe tromper, tant que l’accouplement n’a pas
décidé de l’identité du genre & de l’efpèce ,
font-ils néceffaires & utiles , peuvent - ils
nous donner une idée de l’ordre naturel ?
Tous les objets font variés ; il n’en exifte
pas de femblables en tous points : ceux qui
ont le plus de rapports laiffent appercevoir
des différences quand on les examine longtemps
fous tous les afpeûs , dans le plus
grand détail & avec une attention fcru-
puleufe. Mais pour reconnoitre ces traits
diftinûifs, qu’on ne faifit qu’avec peine,
que par un long examen-, une comparaifon
détaillée de- toutes les parties , il faut ou
beaucoup de temps à chaque obfervation ,
ou une longue habitude de voir & de comparer
les objets quife reffemblent. Le na-
turalifte qui corapareroit les uns aux autres
chaque individu d’un troupeau de brebis,
parVxendroit à trouver, dans chacun, des
différences & des traits qui le diftingueroit
des autres ; il pourroit donner à chaque
brebis une dénomination particulière pour
la diftingner, & il la reconnoîtroit parmi
toutes les autres , en.fe rappellant le trait
diftinftif dont i l auroit lie l’idée à- la dénomination
impofée. C’eft ainfi qu’on a vu
des bergers employer leur loifir à remarquer
les traits qui diftinguent chaque individu
du troupeau qu’ils conduifent, leur
donnera tous des noms, & les reconnoitre-
au premier afpeft ,- p a r - la force d’une-
longue habitude. Mais cette manière d’apprendre
à diftinguer les objets, exigeroit
un travail très - long , & eonfommeroit
beaucoup de temps. Celui qui fe feroit
livré à cette étude pour les elaffes- dans
lefquelles les efpèces multipliées , ferrées
& comme- preuees , font fort reffem-
blantes , auroit paffé une partie de fa v ie
à- reconnoitre- les traits qui les diftinguent
chacune,, avant qu’il pût les comparer fous-
37?
d’autres rapports que ceux de la forme
extérieure. Ce travail , long & pénible,
eft celui dont fe font chargés quelques
hommes patiens & laborieux, qui l’ont
épargné aux autres , en leur faifant part,
fous le nom de méthode ou de fyftéme,
du réfultat de leurs obfervations ; c’eft
une indication nette & précife des traits
reconnus pour diftinétifs & propres à
chaque claffe , à chaque genre, quelquefois
à certaines efplces particulières, d’après la
comparaifon faite de tous les objets qui
fe reffemblent, & qui,par le grand nombre
de leurs rapports, fe confondent au fimple
afpeû. C’eft un moyen prompt de diftinguer
& de reconnoitre les objets fans en
faire la comparaifon , dont le réfultat eft
connu d’avance, par l’expérience de ceux
qui l’ont indiqué, C’eft donc une manière
d’abréger l’étude, de la rendre plus facile,
de ménager le temps ,■ & par conféquent les
méthodes ou fyfémes ont une très--grande
utilité, & nous devons , à ceux qui. nous
les ont fournis , une reconnoiffance prc*-
portionnée à leur peine & à celle qu’ils
nous épargnent. Mais en vain prétendrait-
on pouvoir, par aucune méthode, nous
donner une idée de l’ordre naturel. Avant
d’avancer cette propofrtion, il fàudroit
fçavoir fi la nature s’eft en effet aftremte
à- un ordre , f i elle s’eft tracé un plan, des
parties duquel elle ait conçu les idées fé*
parément, & qu’elle ait eu l’intentirfr de
lier les unes aux autres. Cette manière lente
de procéder, ces divifions tiennent trop à
notre fcibleffe, & conviennent trop peu
au génie de la nature ; il eft plus probable
que le projet & l’exécution de fon ouvrage
pnt été le produit d’une feule & même
penfée ; que la nature voit & embraffe
l’univers d’un feul & même coup -d’oe i l,.
fans divifer, fans grouper les portions qui
le compofent mais les méthodes n’en font:
pas moins-utiles,. k caufe de notre foibleffe-
à laquelle' elles, font proportionnées :. ort
peut fans- doute s’en paffer , quand les:
objets-font peu multipliés , que les traits;
qui les diftinguent. font frappans. Les- méthodes
alors furchargent & fatiguent celui
qui étudie | au. lieu de lui épargner du.